"L'art tragique tient les âmes en alerte." - Robert Kemp
Le registre tragique fait partie des genres littéraires les plus anciens.
Les plus grands dramaturges de l'histoire, à savoir Sophocle, Euripide et Eschyle ont vu le jour en Grèce bien avant le commencement de notre ère.
Ainsi, au même rang que le registre comique, le registre épique ou encore le registre dramatique, le tragique trouve ses origines dans l'Homme et sa représentation.
Qu'il s'agisse d'une idéologie religieuse, politique, polémique, sociétale ou tout simplement sentimentale, le registre tragique va donner une tonalité fataliste, inexorable à une situation donnée se traduisant par la mort, la peine et le chagrin.
Afin d'approfondir vos connaissances littéraires classiques et contemporaines, nous allons étudier plus précisément quelle est la place du registre tragique en français à travers les époques.

Définition du registre tragique
Le registre tragique emploie des procédés littéraires et un champ lexical précis.

Loin de vouloir susciter le rire chez le spectateur ou le lecteur, le tragique, à distinguer de la tragédie, ne cherche pas forcément à provoquer que tristesse et larmes.
Bien que l'issue de l'histoire racontée soir forcément malheureuse, on retrouve d'autres émotions à travers le registre tragique comme :
- L'effroi face à la puissance du destin,
- La pitié et la compassion envers les personnages concernés,
- La colère face au sort inexorable du protagoniste.
Le tragique déchaîne les passions, réveille les sentiments, le tout placé sous le signe de la fatalité.
Il vise à susciter réflexion et introspection chez le lecteur via différentes étapes et différents rythmes dans l'épopée du héros : le combat, la défaite puis le deuil.
Il met en scène une situation tragique centrée sur un héros en proie aux malheurs, aux difficultés et bien souvent confronté à faire des choix décisifs voire impossibles pour son plus grand malheur.
Si le dénouement d'une tragédie est malheureux et se traduit le plus souvent par la mort du héros, c'est qu'elle doit inspirer crainte et pitié aux spectateurs.
Pour se faire, les figures de style et les procédés d'écriture les plus souvent employées sont :
- La métaphore,
- Les comparaisons, le parallélisme,
- L'antithèse et l'antiphrase,
- Le chiasme pour mettre en évidence un choix impossible,
- Les hyperboles pour dépeindre les sentiments comme la souffrance ou la colère,
- Un langage soutenu,
- Une ponctuation forte (exclamation, interrogation),
- L'apostrophe et les invocations.
Le héros tragique se caractérise en général par sa grandeur : noble, hors du commun, il possède le courage et la lucidité qui lui permettent d’affronter le destin tout en prenant conscience de son impuissance évidente.
Profondément résilient il fini bien souvent par accepter sa destinée, le caractère inéluctable de l'échec, voire sa fin programmée.
C'est en ça que réside tout son caractère héroïque, détonnant ainsi avec l'atmosphère pesante qui l'entoure et l'accable.
Dans la tragédie grecque, la situation tragique prend son origine à l'extérieur du héros car ce dernier est soumis à la volonté des dieux.
Cependant, il garde une part de culpabilité et son destin fatal répond le plus souvent à une faute commise par lui-même, sa famille ou par son peuple que lui seul se doit de réparer en sacrifiant sa propre vie.
La tragédie classique quant à elle tend à intérioriser davantage la situation tragique dans le héros lui-même, car celui-ci s'individualise de plus en plus. Ainsi, le dilemme auquel il est confronté le renvoie à son devoir moral ou à sa passion inaccessible.
Plus récemment dans la tragédie contemporaine, le processus d'intériorisation est complètement abouti. Si bien que le tragique s'exprime davantage dans la méditation, la prise de conscience de l'homme sur sa condition mortelle et sur l'absurdité du monde qui l'entoure.
Vous trouverez de nombreux cours de français un peu partout en France pour progresser en la matière.
Connaissez-vous le registre lyrique ?
Les grands écrivains tragiques français
De nombreux auteurs et écrivains français se sont essayés au registre tragique au fil des siècles.
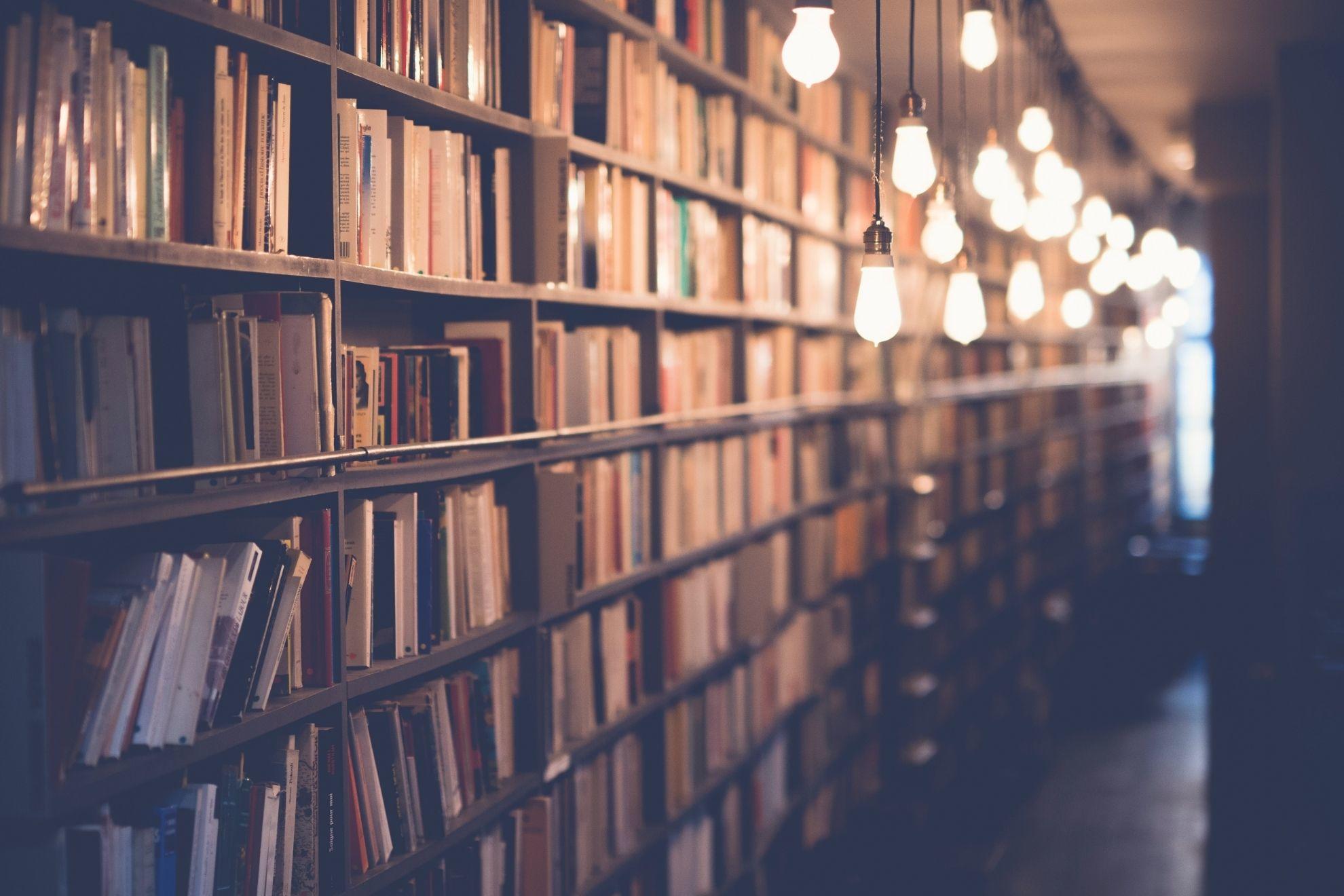
Parfois pour exprimer des sentiments personnels, d'autres fois pour émouvoir le lecteur et enfin quelques fois pour réveiller les interrogations et les consciences au travers des vices des personnages représentés.
Ce genre littéraire encore très répandu chez les contemporains a parfois révélé les plus grands écrivains de notre époque.
Découvrez tous les cours de français disponibles pour progresser.
Pierre Corneille
Reconnu comme l'un des plus flamboyants dramaturges du XVIIème siècle, Corneille est devenu l'un des pères de la tragédie classique.
Ces œuvres les plus célèbres sont :
- Le Cid,
- Médée,
- Cinna,
- Horace,
- Nicomède.
D'abord auteur de tragédie mythologique (Médée) il sera l'un des derniers poètes dramatiques à écrire des tragédies historiques (Cinna, Nicomède, Rodogune, etc.).
Il a marqué de son empreinte indélébile ce courant littéraire grâce à ses personnages forts, confrontés à des dilemmes épiques ou moraux, d'où naquit l'expression dilemme cornélien.
En voici une représentation avec un extrait du Cid qui met en lumière le choix impossible de Rodrigue quant à son amour pour Chimène :
"Mourir sans tirer ma raison !
Rechercher un trépas si mortel à ma gloire !
Endurer que l’Espagne impute à ma mémoire
D’avoir mal soutenu l’honneur de ma maison !
Respecter un amour dont mon âme égarée
Voit la perte assurée !
N’écoutons plus ce penser suborneur,
Qui ne sert qu’à ma peine.
Allons, mon bras, sauvons du moins l’honneur,
Puisqu’après tout il faut perdre Chimène." - Le Cid - Acte 1 Scène 6
A la fois poétique et dramatique, cette œuvre majeure est un véritable éloge à l'amour sans blâme ni raillerie.
Saurez-vous détecter les fautes de cette phrase avec un cour de francais ?
Jean Racine
Digne successeur de Corneille, Racine, plébiscité par Louis XIV a donné vie à 7 œuvres tragiques considérées aujourd'hui comme des références du genre :
- Andromaque,
- Britannicus,
- Bérénice,
- Bajazet,
- Mithridate,
- Iphigénie,
- Phèdre.
Il s'oppose malgré tout à son prédécesseur dans la construction du tragique. Là où Corneille déborde d'héroïsme et d'actions complexes Racine préfère une intrigue épurée qui révèle toute l'intensité psychologique et l'expression des sentiments de chaque personnage.
La passion, en particulier féminine, est au cœur de ses propos. Elle détruit les politiques, soumets les rois, rend fou les empereurs.
Le tragique racinien reprend la structure du triangle amoureux causant ainsi souffrances et sentiment de perdition à l'ensemble des personnages.
On frôle parfois même l'irrationnel, donnant ainsi une dimension presque humoristique à certaines scènes.

Jean Anouilh
Né en 1910, ce dramaturge et scénariste français se distingue grâce à sa réécriture moderne de la pièce du tragédien grec Sophocle : Antigone.
La pièce est inspirée du mythe antique d'Antigone, la fille d'Oedipe, mais est écrite en rupture avec les codes de la tragédie grecque.
Anouilh a réadapté ce mythe en adéquation avec la tragédie de l'époque : la Seconde Guerre Mondiale et l'occupation nazie.
Pour résumer :
Le roi Créon interdit que l'on enterre Polynice, le frère d'Antigone après que celui-ci ai combattu à mort son propre frère inhumé quant à lui avec les honneurs. Il condamnera à mort quiconque enfreindra cette règle.
Antigone refuse de laisser pourrir la dépouille de son propre frère, désobéit au roi et se fait prendre.
Après un long débat avec son oncle sur le but de l'existence même, celle-ci est condamnée à être enterrée vivante.
En voici un extrait :
"Antigone : Et vous l'avez fait tout de même.et maintenant vous allez me faire tuer sans le vouloir.
Oui c'est cela être roi!
Créon : Oui, c'est cela !
Antigone : Pauvre Créon. Avec mes ongles cassés, et plein de terre et les bleus que tes gardes m'ont fait aux bras, avec ma peur qui me tord le ventre, moi je suis reine." - Antigone
Cette scène se déroule avant qu'Antigone soit emmurée vivante par le roi Créon.
Mais au moment où le tombeau va être scellé, Créon apprend que son fils, Hémon, fiancé d'Antigone, s'est laissé enfermer auprès de celle qu'il aime.
Lorsque l'on rouvre le tombeau, Antigone s'est pendue avec sa ceinture et Hémon, crachant au visage de son père, s'ouvre le ventre avec sa propre épée.
Suite à la disparition du fils qu'elle adorait, Eurydice la femme de Créon, au sommet du désespoir se tranche la gorge sous les yeux de son mari impuissant.
D'autres auteurs comme Zola, Hugo, Maupassant, Verlaine ou encore Baudelaire et même Molière en son temps ont apporté leur lot de situations tragiques à la littérature française.
Connaissez-vous le registre réaliste ?
Les registres littéraires qui s'inspirent du tragique

Le registre tragique ne s'exprime pas seulement dans le genre de la tragédie : on le rencontre également dans plusieurs registres comme :
- La tonalité poétique,
- Le registre épistolaire,
- Le registre argumentatif.
Les champs lexicaux employés sont sensiblement identiques mais chacun s'octroie certaines tournures et spécificités.
Le registre poétique
On ne peut mentionner dans une même phrase tragique et poésie sans mentionner Charles Baudelaire.
Ce recueil de poèmes paru en 1857 met en lumière des sujets très controversés pour l'époque.
Certaines de ses pièces qui dépeignent le pathétique de l'époque susciteront l'indignation des puissants et seront même censurées.
Baudelaire se retrouvera assigné en justice pour atteinte à la moralité.
Cet ouvrage mêle à la fois langage savant et langage familier, donnant ainsi une vision profonde et crue du désespoir qui lie les textes entre eux, abolissant aux passages les barrières de classe.
Bon nombre de poèmes sont construits sur le même schéma : un mouvement ascensionnel suivi d'une chute brutale embarquant le lecteur dans un spleen profond, un thème récurrent de l'œuvre.
Le registre épistolaire
Le registre épistolaire reprend les correspondances, ou lettres échangées entre les protagonistes.
On reconnaît le genre par son style d'écriture (sous forme de lettre), mais aussi par le contenu du texte qui s'apparente à des confidences.
La distance, le manque, l'absence sont des tonalités tragiques souvent abordés dans ce registre.
Le registre argumentatif
Le registre argumentatif regroupe différents types de textes : contes, discours, fables, articles de presse ou encore l'oraison funèbre peuvent être classifiés comme tel.
Ici le narrateur cherche via une argumentation détaillée à développer des idées, des opinions ou encore des sentiments (parfois avec une légère exagération).
Une oraison funèbre s'apparente au registre tragique de part sa fonction : rendre hommage à une personne défunte, disparue.
La tonalité du discours se veut émouvante afin de mettre en évidence le sentiment de tristesse provoqué par la perte d'un être cher.
Ainsi le tragique se retrouve dans la majorité des écrits et dans différents registres littéraires dans la langue française.
Voilà de quoi épater votre prof de français lors du prochain cours !
Découvrez aussi le registre satirique !
Résumer via IA :
















