Chapitres
- 01. Quelques définitions importantes
- 02. Le potentiel d'oxydo-réduction
- 03. Les liaisons
- 04. Méthodologie
- 05. Exercice

Quelques définitions importantes
Le réducteur cède des électrons : il subit une oxydation. L’oxydant capte des électrons : il subit une réduction. Il faut parvenir à mémoriser correctement ces définitions. On propose un moyen mnémotechnique : Le Réducteur Rend des électrons. L’Oxydant en Obtient. Rappel : une liaison de covalence est la mise en commun par deux atomes d’une paire d’électrons 


Le potentiel d'oxydo-réduction
Le caractère oxydant ou réducteur d'une espèce dépend de la réaction chimique et des espèces qui interagissent entre elles. En effet, l'élément réducteur dans une réaction peut devenir l'oxydant d'une autre réaction. C'est pour cela que l'on construit une échelle de force oxydante (ou de force réductrice selon le sens donné à cette échelle) afin d'obtenir le potentiel d'oxydo-réduction se mesurant en volt. En outre, le potentiel d'oxydo-réduction dépend du contexte chimique, notamment du pH, mais aussi du contexte physique puisque les effets de la lumière peuvent intervenir dans la nature comme ce qui est le cas avec la photosynthèse chez les plantes ou la photographie avec l'Homme.
Les liaisons
Lorsque l’un des atomes participant à la liaison attire davantage le doublet commun que l’autre, celui-ci ce déplace vers l’atome le plus attracteur et la partie de la molécule où il se situe admet alors une charge partielle négative notée - d. On dit alors de la liaison qu’elle est polarisée. La molécule reste globalement électriquement neutre mais certaines de ses liaisons sont polarisées. On appelle électronégativité la tendance d’un atome à conserver les électrons par lesquels il se lie ou à attirer ceux qui lui sont communiqués par covalence. 
- le nombre d'oxydation d'un élément à l'état de corps simple est nul.
- Plus généralement, le nombre d'oxydation d'un élément sous forme d'ion monoatomique est égal à la valeur algébrique de la charge de l'ion.

- le nombre d'oxydation d'un élément à l'état de corps simple est nul.
- Plus généralement, le nombre d'oxydation d'un élément sous forme d'ion monoatomique est égal à la valeur algébrique de la charge de l'ion.
- La somme algébrique de tous les nombres d'oxydation de tous les éléments présents dans un ion est égale à la charge de cet ion.
- La somme des nombres d'oxydation de tous les éléments présents dans une molécule est nulle. - Le nombre d'oxydation de l'hydrogène est (+ I)
- .Le nombre d'oxydation de l'oxygène est généralement de (- II)
La somme algébrique des nombres d'oxydation de tous les éléments est nulle dans une molécule ou égale à la charge de l'ion pour un ion polyatomique.Oxydation / Réduction
- Au cours d'une oxydation, le nombre d'oxydation de l'un des éléments composant le réactif et qui constitue l'espèce oxydée augmente.
- Au cours d'une réduction, le nombre d'oxydation de l'un des éléments constituant le réactif et qui constitue l'espèce réduite diminue.
Oxydant / Réducteur
- Un oxydant est une espèce chimique contenant un élément dont le nombre d'oxydation diminue lorsqu'il est réduit.
- Un réducteur est une espèce chimique contenant un élément dont le nombre d'oxydation augmente lorsqu'il est oxydé.
Réaction d'oxydoréduction
- Lors d'une réaction d'oxydoréduction, la diminution totale de nombre d'oxydation de l'espèce oxydante est égale à l'augmentation totale de nombre d'oxydation de l'espèce réductrice.
- Il y a une sorte de conservation du nombre d'oxydation total au cours de la réaction ; Le solde final doit être égal au solde initial.
Il faut redécomposer les réactions d'oxydo-réduction en leurs deux demi-équations électroniques pour bien comprendre la méthode. La réduction se traduit par une diminution du nombre d'oxydation de l'élément mis en jeu. Par exemple : Cu 2+ (+II) + 2e- → Cu (0) Dans ce cas le cuivre passe du nombre d'oxydation +II à 0. Il y a un Δ n.o. de - II. L'oxydation se traduit par une augmentation du nombre d'oxydation de l'élément concerné. Ainsi, Zn (0) → Zn 2+ (+II) + 2e- Ici, le zinc passe de (0) à (+II). Le Δ n.o. est de +II. On constate que la somme des variations de nombres d'oxydation est bien nulle. La somme des variations de nombres d'oxydation est toujours nulle dès lors que l'équation bilan de l'oxydo-réduction est bien équilibrée. Si la somme des variations en l'est pas, c'est qu'il y a une erreur dans l'équation bilan et que celle-ci ne traduit pas réellement la conservation des charges. Par exemple : en prenant deux couples MnO-4 / Mn2+ et CO2 / H2C2O4 . On c'est que l'oxydant MnO-4 réagit avec le réducteur. Pour la réduction, on voit apparaître un Δ no de -V. MnO-4 /(+VII) + 5e- → Mn2+ (+II) Pour l'oxydation, on voit apparaître un Δ n.o.' de +II. H2C2O4 (2*+III) → 2 CO2 (2*+IV) + 2e- Si l'on additionnait les deux demi-équations, on obtiendrait, ce qui est manifestement faux ne serait ce qu'en vertu de la loi de conservation des charges. Si l'on observe les nombres d'oxydations, on constate que pour qu'il y ait égalité, on doit prendre 
Méthodologie

- faire un bilan des espèces en présence, réactifs et produits
- calculer le nombre d'oxydation dans les réactifs et dans les produits.
- observer les variations du nombre d'oxydation de chacun d'eux
- ajuster les coefficients stœchiométriques pour que la somme de toutes les variations soit nulle ( aucun électron n'apparaît ni ne disparaît, aucun 'point' de nombre d'oxydation n'apparaît ni ne disparaît.
Les difficultés de la leçon : Il faut connaître
- les règles de calcul sur les nombres d'oxydation
- maîtriser parfaitement les concepts d'oxydant, réducteur, oxydation et réduction.
Il faut faire très attention :
- lors de l'application des coefficients stœchiométriques pour assurer une conservation des nombres d'oxydations.
- aux signes des nombres d'oxydation sur lesquels on travaille. Il ne faut surtout pas omettre de les prendre en considération dans les calculs.
Exercice
Lorsque l'on souhaite fabriquer du cuivre métallique, on obtient tout d'abord ce qu'on appelle du cuivre noir ou encore blister qui peut contenir entre 98 et 99,5% de cuivre. Cependant, afin d'être utilisable dans l'industrie électrique, il est essentiel que le cuivre soit pur à 99,9%. C'est pour cela que l'on doit procéder au raffinage du blister via le processus d'électrolyse à anode soluble. 
-
- Calcule la concentration molaire volumique des ions cuivres II contenus dans le bain électrolytique.
- Schématise l'électrolyse en veillant à faire apparaître le sens du courant électrique mais également le sens de déplacement et la nature des porteurs de charge.
- Pour chaque électrode, écrit la réaction ne faisant intervenir que le couple Cu2+(aq)/Cu(s). Pouvez-vous en déduire la position de l'anode et la cathode ?
- Pourquoi peut-on utiliser le terme d'anode soluble ?
- Quelle est la réaction de l'électrolyse ?
- Est-ce que la concentration en ions cuivre II varie au cours de l'électrolyse ? Pourquoi ?
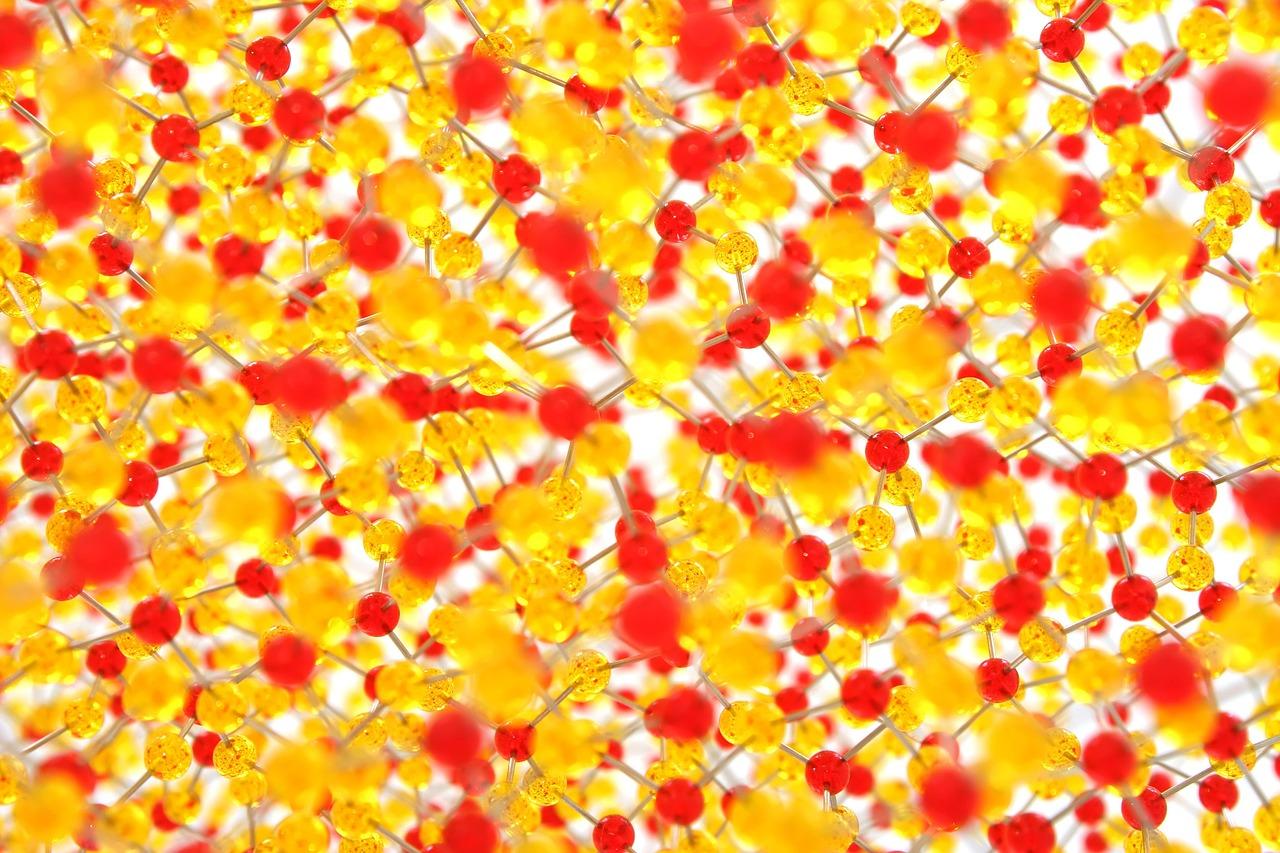















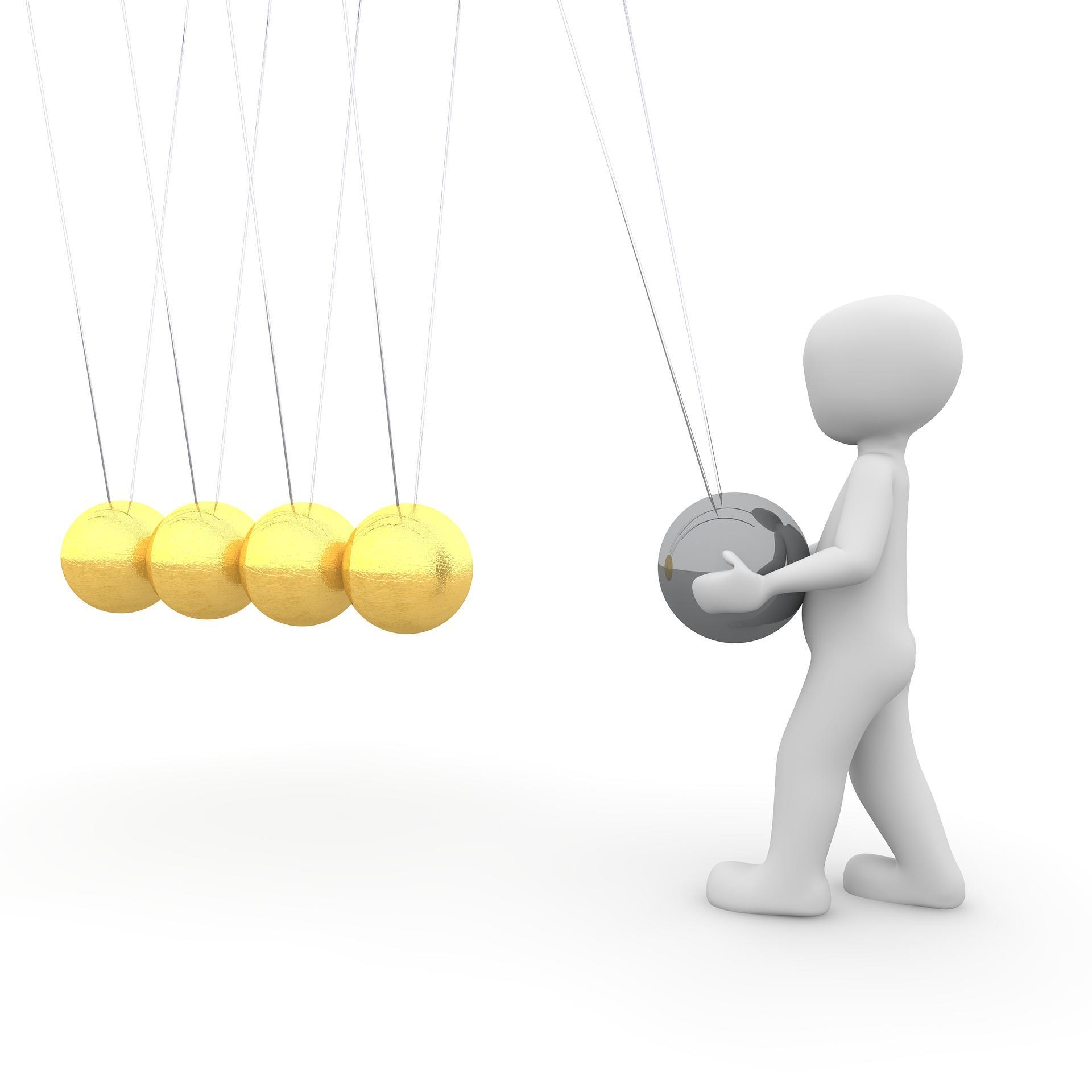






Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !