Chapitres
Voltaire, de son vrai nom François-Marie Arouet, était un écrivain et philosophe français du XVIIIe siècle.
Né en 1694, il a joué un rôle majeur pendant la période des Lumières
Ses écrits étaient souvent satiriques et critiques envers les institutions religieuses et politiques de son époque. Ses œuvres les plus célèbres comprennent :
"Candide"
"Lettres philosophiques"
✊ Voltaire a défendu la liberté d'expression, la tolérance religieuse et les droits de l'homme. Son héritage est celui d'un penseur influent, dont les idées ont façonné le mouvement intellectuel et la société de son temps, ainsi que les générations suivantes.

Voltaire, personnage emblématique des Lumières ?

Une jeunesse intellectuelle ?
François-Marie Arouet est le fils de François Arouet, un notaire du Châtelet de Paris, et de Marie-Marguerite Daumart, qui meurt sept ans après sa naissance. À noter que Voltaire se réclamait plutôt de l'union de sa mère et d'un certain Roquebrune, qui aurait eu l'avantage, contrairement à son père officiel, d'avoir de l'esprit.
Reste qu'en 1696, son père devient conseiller du roi, receveur des épices à la Chambre des comptes
François-Marie rejoint le collège Louis-le-Grand, tenu par les Jésuites, dès l'âge de dix ans. Élève brillant, il y étudie les langues classiques, la réthorique, la versification et le théâtre.
? Il fait d'ailleurs publier dès 1709 un recueil de poèmes, Ode sur saint Geneviève
Il quitte le collège en 1711 à dix-sept ans, annonçant à son père qu'il souhaite devenir un homme de lettres. Son père refuse et il s'inscrit à l'école de droit, où il rencontre la société du Temple, faite de membres de la haute noblesse et de poètes. Là encore, c'est une occasion pour travailler son art du vers.
Enclin à la provocation, il est envoyé dans différents endroits, à l'initiative de son père qui ne supporte pas ses incartades. Il écrit notamment des vers satiriques et irrévérencieux envers le Régent de Louis XV.
Cela qui lui vaut un emprisonnement à la Bastille durant onze mois, rien que ça !
Premier succès littéraire ?
À sa sortie de prison, il ambitionne de devenir célèbre en écrivant de la tragédie et de la poésie épique, qui sont les genres les plus nobles de son époque.
Pour rompre avec son passé, il s'invente son pseudonyme : il devient Voltaire
Sa première pièce représentée sous ce nom sera Œdipe, en 1718
C'est un franc succès : le public apprécie ses vers semblables à des maximes et ses allusions rebelles au roi et à la religion. Il devient vite prisé dans les cercles les plus côtés.
Il connaît un autre immense succès en 1723 avec son poème épique, La Henriade
Long de 4 300 alexandrins, le poème prend pour références les grands classiques (l'Illiade d'Homère et l'Énédie de Virgile). Ses contemporains l'associeront toute sa vie à cette œuvre, qui lui vaut le surnom de « Virgile français ».
Néanmoins, une altercation lui vaut un nouvel « embastillement » : il est roué de coups par des laquais du chevalier Guy-Auguste de Rohan-Chabot, à la suite d'une joute verbale, et cherche à se faire justice lui-même, ce qui agace les cercles nobles avec lesquels il est lié. Les Rohan obtiennent finalement son arrestation en 1726. Il n'est libéré qu'à la condition de son exil - ce qu'il fait.
L'exil ?

À 32 ans, voilà donc Voltaire débarquant en Angleterre. Cette période le marquera pour toute sa vie. Il est fasciné par la découverte de cette culture, en beaucoup de points absolument différente de celles des Français. Il y voit en particulier un esprit de liberté inconnu en son propre pays.
?? Il maîtrise très rapidement l'anglais, ce qui lui permet de fréquenter les grands noms. Il rencontre des écrivains, des philosophes et des naturalistes, ce qui constitue le point de départ de ses intérêts intellectuels. C'est là que s'opère sa mutation d'homme de lettres en philosophe.
Il est finalement autorisé à revenir en France en 1728.
Les protectrices ?♀️
? En 1734, il fait paraître Les Lettres philosophiques, qui font le bilan de ses découvertes anglaises
Entre-temps, il a rencontré Madame du Châtelet, une femme très intelligente, passionnée, comme lui, par les sciences. Effrayé par des poursuites judiciaires, Voltaire se réfugie chez elle, à Cirey, en Champagne, au cours de l'année 1734.
Là, ils mènent une vie de couple, malgré le fait que Madame du Châtelet est mariée. Ils s'adonnent à la science et à la philosophie, et se passionnent en particulier pour les découvertes récentes de Newton, que Voltaire avait rencontré en Angleterre. Ils finiront néanmoins par se brouiller.
? Entre 1744 et 1747, la nouvelle protectrice de Voltaire se nomme alors Madame de Pompadour
Voltaire est en même temps nommé historiographe du roi et élu à l'Académie française en 1746. Malheureusement, Louis XV ne l'aime guère.
La vie à Ferney ??
En 1750, Voltaire est invité par le jeune roi de Prusse, Frédéric II. Il s'y rend plein d'enthousiasme, pensant trouver en lui la figure du « despote éclairé » qu'il fantasme. Mais la déception s'impose rapidement.
À son retour, il trouve refuge aux Délices, près de Genève. En 1760, il se fixe plutôt à Ferney, du côté français de la frontière suisse. Il contribuera à faire de ce petit village une ville prospère. Il y installe des fabriques et se fait seigneur éclairé, ce qui lui vaut à la fin le surnom de « Patriarche de Ferney ».
? Aujourd'hui, vous pouvez vivre à Ferney-Voltaire et découvrir le château au nom de l'intellectuel !
Il se tient au courant de l'actualité et reçoit de nombreuses visites. C'est, en somme, un homme important, qui profite de sa renommée pour prendre position :
- Il défend la cause de Calas (1762)
- De Sirven (1764)
- Du chevalier de La Barre (1766)
Il est considéré comme un redoutable polémiste.
Fin de vie
En 1778 est représentée à Paris sa dernière tragédie : Irène. C'est un nouveau triomphe, on l'acclame littéralement dans les rues.
Mais c'est aussi un voyage éprouvant pour le vieillard, qui souffre depuis 1773 d'un cancer de la prostate. L'effort se révélera donc fatal : il meurt à 84 ans.
Les oeuvres littéraires voltairiennes ?
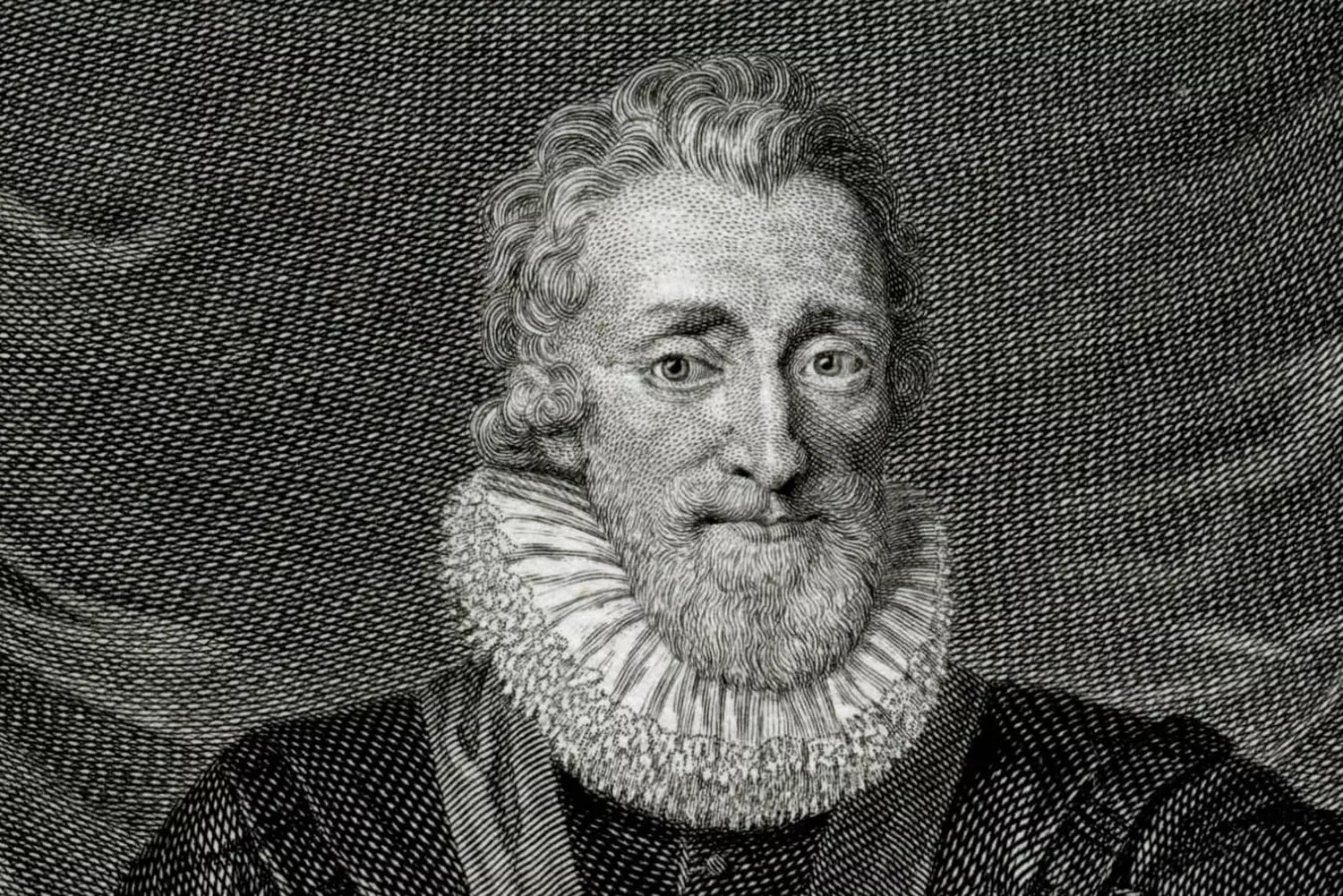
Voltaire s'est donc investi dans différents genres littéraires, avec des succès presque omniprésents - en tout cas, selon les époques.
Voici les 10 oeuvres les plus emblématiques de Voltaire par ordre alphabétique :
| Œuvre | Année | Résumé en une ligne |
|---|---|---|
| La Henriade | 1723 | Une épopée poétique sur la vie du roi Henri IV mettant en avant les idéaux de tolérance et de réconciliation. |
| Lettres philosophiques | 1734 | Une série de lettres dans lesquelles Voltaire aborde divers sujets tels que la religion, la liberté et la tolérance, suscitant le débat intellectuel. |
| Zadig | 1747 | Les tribulations de Zadig, un homme vertueux confronté à l'injustice et au destin révélant les contradictions de la société. |
| Mahomet | 1741 | Une pièce de théâtre traitant du conflit entre le prophète Mahomet et les puissances politiques abordant des questions religieuses et politiques. |
| Micromégas | 1752 | Une satire mettant en scène des géants cosmiques qui visitent la Terre révélant les limites de la connaissance humaine. |
| Candide | 1759 | Un conte satirique qui suit les aventures de Candide à travers le monde remettant en question l'optimisme philosophique. |
| L'Ingénu | 1767 | L'histoire d'un Huron naïf qui découvre la société française et soulève des questions sur les normes sociales et la nature humaine. |
| L'Écossaise | 1760 | Une comédie qui critique les préjugés sociaux et les différences culturelles entre les Écossais et les Français. |
| Traité sur la tolérance | 1763 | Un plaidoyer en faveur de la liberté de religion et contre l'intolérance religieuse inspiré par l'affaire Calas. |
| Dictionnaire philosophique | 1764 | Une collection d'articles portant sur des sujets variés où Voltaire exprime ses idées philosophiques et critiques. |
Voltaire, poète et dramaturge
La poésie et le théâtre sont les deux domaines dans lesquels Voltaire eut le plus de renommée auprès de ses contemporains. Pourtant, aujourd'hui, ces œuvres jadis acclamées sont tombées dans l'oubli.
On peut relever :
- Une épopée, La Henriade (1724), qui prend Henry IV pour héros
- Des poèmes philosophiques, sur les découvertes de Newton, sur le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, sur la religion
- Des poésies diverses en très grand nombre, aux tonalités satiriques, lyriques ou mondaines
- 27 tragédies, dont Zaïre (1732) et Mahomet (1741) sont les plus connues
- 6 comédies
Voltaire l'historien
Dans la lignée de Bayle, de Fontenelle et de Montesquieu, Voltaire met au point des méthodes en histoire qui contribuent à en faire le premier des historiens modernes.
Il fonde ainsi sa démarche sur :
- Une documentation précise qui remonte jusques aux sources
- Une confrontation des thèses
- Le déploiement d'une analyse critique ;
- La simplification et la théorisation.
✍? Néanmoins, l'histoire reste un genre littéraire sous sa plume : on y sent l'importance de la clarté du style, la vivacité des portraits, le sens de la narration
Parmi ses publications, on peut citer :
- Histoire de Charles XII (1731), un roi de Suède qui régna de 1682 à 1718
- Le Siècle de Louis XIV (1751)
- Essai sur les mœurs et l'esprit des nations (1756)
- Précis du règne de Louis XV (1766)
Voltaire le philosophe
Fatalement, Voltaire le philosophe est celui que notre modernité connaît le mieux. Ce sont en effet ses écrits philosophiques, illuminés par ses contes du genre, qui nous sont parvenus de manière décisive.
Voltaire a toujours lutté, dans ses idées, pour la tolérance. Son combat contre l'arbitraire et le fanatisme s'illustre notamment à travers trois œuvres :
- Les Lettres philosophiques (1734)
- Le traité sur la tolérance (1763) qui paraît en pleine affaire Calas et qui correspond à un plaidoyer pour le respect de l'autre, notamment vis-à-vis de son culte religieux
- Le Dictionnaire philosophique (1764) qui explique le combat de l'auteur contre le fanatisme, sous forme d'articles amusants et spirituels
Comme influence philosophique de Voltaire, on relève en particulier le sensualisme de l'Anglais John Locke (1632-1704), qui défendit envers et contre tout l'impératif de l'acquisition des connaissances.
Voltaire le conteur
Voltaire le philosophe est l'esprit le mieux connu parce que ses contes philosophiques se mettent au diapason de sa pensée, et ce sont ces écrits-là que le grand public connaît le mieux. A contrario, ils étaient considérés comme des œuvres mineures par ses contemporains.
Il n'en reste pas moins que Voltaire raconte des histoires amusantes avec beaucoup de talent et de vivacité qui illustrent en même temps de manière très claire ses idées philosophiques.
Relevons, parmi les plus importants, les titres suivants :
- Zadig ou la Destinée (1741)
- Micromégas (1757)
- Candide ou l'Optimisme (1759)
- L'Ingénu (1767)
Voltaire épistolier
Entre 1711 et 1778, Voltaire écrit plus de 20 000 lettres à environ 800 correspondants. Celles-là offrent donc une ressource inestimable quant à sa biographie et ses positions.
Il est d'ailleurs devenu un modèle dans le domaine de la lettre pour ses contemporains et pour les générations qui ont suivi.
L'héritage de Voltaire ?

L'influence durable de Voltaire se manifeste dans les écrits des écrivains et des philosophes ultérieurs. Son style d'écriture incisif, satirique et provocateur a été une source d'inspiration pour de nombreux auteurs.
? Des écrivains tels que Victor Hugo, Gustave Flaubert et Jean-Paul Sartre ont été influencés par son esprit critique et son engagement en faveur de la justice sociale
Ses idées sur la séparation de l'Église et de l'État, la liberté de pensée et la lutte contre l'oppression ont également influencé des figures importantes de l'Histoire, comme Thomas Jefferson et Simon Bolivar.
? La réception de l'œuvre de Voltaire a été diverse, tant de son vivant qu'au fil du temps. Si ses écrits étaient souvent censurés et controversés, ils ont également été largement lus et appréciés. Les élites intellectuelles et politiques de l'époque cherchaient ses conseils et son approbation, tandis que le public plus large trouvait dans ses œuvres une critique acérée de l'injustice et une satire divertissante de la société.
Au fil du temps, Voltaire est devenu un symbole de l'esprit des Lumières et de la lutte contre l'oppression
Ses idées ont été mises en avant pendant la Révolution française et ont influencé les débats politiques et sociaux qui ont suivi. Son plaidoyer en faveur de la tolérance et de la liberté continue d'inspirer les luttes pour les droits de l'homme dans le monde entier.
Résumer avec l'IA :























Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !