Chapitres
ZOLA, Le docteur Pascal (1893)
Chapitre 9 - La mort de Charles

Explication
Charles est un personnage récurrent du roman. Fils bâtard de Maxime
Rougon, présentant une ressemblance étonnante avec son aïeule Adélaïde
Fouque, c’est un enfant retardé à la beauté rare, obsédé sur le plan
sexuel, dont personne ne s’occupe réellement, et qui se retrouve
ballotté de maison en maison. Il se trouve qu’il aime la compagnie de
son aïeule, et qu’on le laisse souvent avec elle.
Laissé sans
surveillance dans la chambre de l’infirme sénile, l’enfant commence à
saigner du nez dangereusement. Seule l’aïeule est présente, mais elle
est impuissante et doit assister à la mort de l’enfant.
I - " Une agonie douce et lente "
A) Une scène naturaliste : dire la mort dans toute sa vérité
Le
terme " agonie " rend ce passage de la vie à la mort plus concret, en
insistant sur le fait que ce trépas ne se fait pas brusquement, mais
obéit à un certain nombre de facteurs physiologiques et médicaux. On
remarque tout d’abord que le rythme est assez lent, pour retranscrire
ces différentes étapes, comme le montre la description de la
décoloration du visage. La réalité de l’hémorragie n’est pas éludée :
" ses veines [...] se vidaient, sans fin, à petit bruit ". Le résultat
en est aussi donné : " la tête couchée dans le sang ".
B) Rendre la mort supportable au lecteur
La
mort de Charles est " douce " pour ne pas traumatiser le lecteur outre
mesure. Zola élimine donc la souffrance : il insiste sur l’idée de
douceur, avec le superlatif " très " ; il précise aussi que les
symptômes de la souffrance sont absents : " sans une secousse ",
" silencieux ". De même, il utilise toute une série d’euphémismes pour
adoucir la mort, celui du sommeil (" comme rendormi "), celui de la
source tarie pour la fin de l’hémorragie (" comme une source dont toute
l’eau s’est écoulée "), celui de la lumière (" ils s’éteignirent ").
C) La beauté du mort
Charles
n’est pas enlaidi par la mort, il reste " divinement beau ", avec sa
" royale chevelure blonde ", sa " peau délicate ". Seules les couleurs
de son visage se sont modifiées. La mort n’en a pas fait un cadavre,
puisque vivant déjà, " sa beauté inquiétante avait une ombre de mort "
(p. 113).
En outre, le texte joue avec les couleurs et y ajoute ce
rouge qui fait contraste avec la pâleur et la blondeur, comme pour en
faire un tableau.
II - Une scène d’horreur
A) Un témoin involontaire
Cette scène est imposée à Tante Dide : " elle dut tout voir ". La mort de
Charles devient pour elle un " spectacle ", qu’elle doit " voir ",
qu’elle peut " suivre ". On peut mesurer l’horreur d’une telle vision,
à la compassion que ce " pauvre corps " inspire au narrateur, lors de
son " affreux combat ". Elle est enfermée dans une " prison " et dès
lors ce spectacle devient une torture.
B) Un retour tragique à la conscience
L’horreur
est d’autant plus grande que Tante Dide, apparemment sénile, est rendue
à la conscience par l’agonie de Charles. Elle se rend compte de ce qui
se passe : " une dernière plainte la ranima toute ". Elle retrouve des
sensations (" senti son crâne éclater "), des sentiments intenses (" la
face bouleversée "), des intentions (" pour crier à l’aide "). Mais ce
retour à la vie est tragique, puisqu’il ne permet pas de sauver
Charles, comme l’indiquent les négations des verbes d’action, mais
seulement de souffrir intensément.
C) Une vision quasi fantastique
De
même que la mort de Charles constitue un tableau, la vision de Tante
Dide offre un spectacle étrange, extraordinaire. On a d’abord
l’impression de la résurrection d’une morte (" la ranima "), suivie de
l’apparition d’un mort-vivant, qui " port[e] ses mains de squelette à
ses tempes ". Puis, le cri qui ne sort pas crée encore un sentiment
fort d’étrangeté.
III - Une scène symbolique
A) La malédiction
Cette
scène est une répétition du passé, puisque Tante Dide y assiste " la
mémoire éveillée ". Elle apparaît comme une punition (" prison "),
voire comme une sorte de sortilège, puisque Tante Dide est dans une
" prison de sénilité et de démence " qu’elle ne peut " rompre ".Enfin,
le participe passé passif, " clouée ", pourrait laisser entrevoir une
lecture christique de cette scène.
B) La boucle bouclée
Zola
fait mourir le résultat final des Rougon face au point de départ.
L’effet de miroir est important, puisque Charles ressemble à Tante
Dide. Elle revient à la conscience pour le voir mourir, et lui meurt en
la regardant : " [...] il ouvrit ses grands yeux, il les fixa sur la
trisaïeule, qui put y suivre la lueur dernière ". Les yeux avec leur
" limpidité ", leur " clarté " peuvent alors suggérer ce miroir. On se
rappelle d’ailleurs que tante Dide avait été qualifiée de " figure
spectrale de l’expiation et de l’attente " (p. 167). Voilà l’expiation
attendue qui va lui permettre de mourir.
C) Charles, symbole d’apothéose et de destruction de la lignée
Charles
est " pareil [...] à ces petits dauphins ". Il fait donc des
Rougon-Macquart une famille royale, il en symbolise l’ascension
sociale, le rapport au pouvoir aussi. Mais il en symbolise les fautes
sa mort étant due au fait qu’il n’a pu en " porter l’exécrable
héritage ". En outre, on retrouve l’idée que par leurs appétits
extraordinaires, les Rougon-Macquart ont usé la " race " :
paradoxalement, Charles s’éteint de " vieillesse " dès ses " quinze
ans ".
Scène attendue du roman, car annoncée à plusieurs
reprises. Sa valeur symbolique est d’autant plus forte que cette mort
s’inscrit dans une série, après celle de l’oncle Macquart et avant
celle de Tante Dide qu’elle provoque directement. Ces trois morts
débarrassent Félicité et vont permettre d’espérer un renouveau de la
famille.
© Stéphanie LASSABE - reproduction interdite
Résumer avec l'IA :













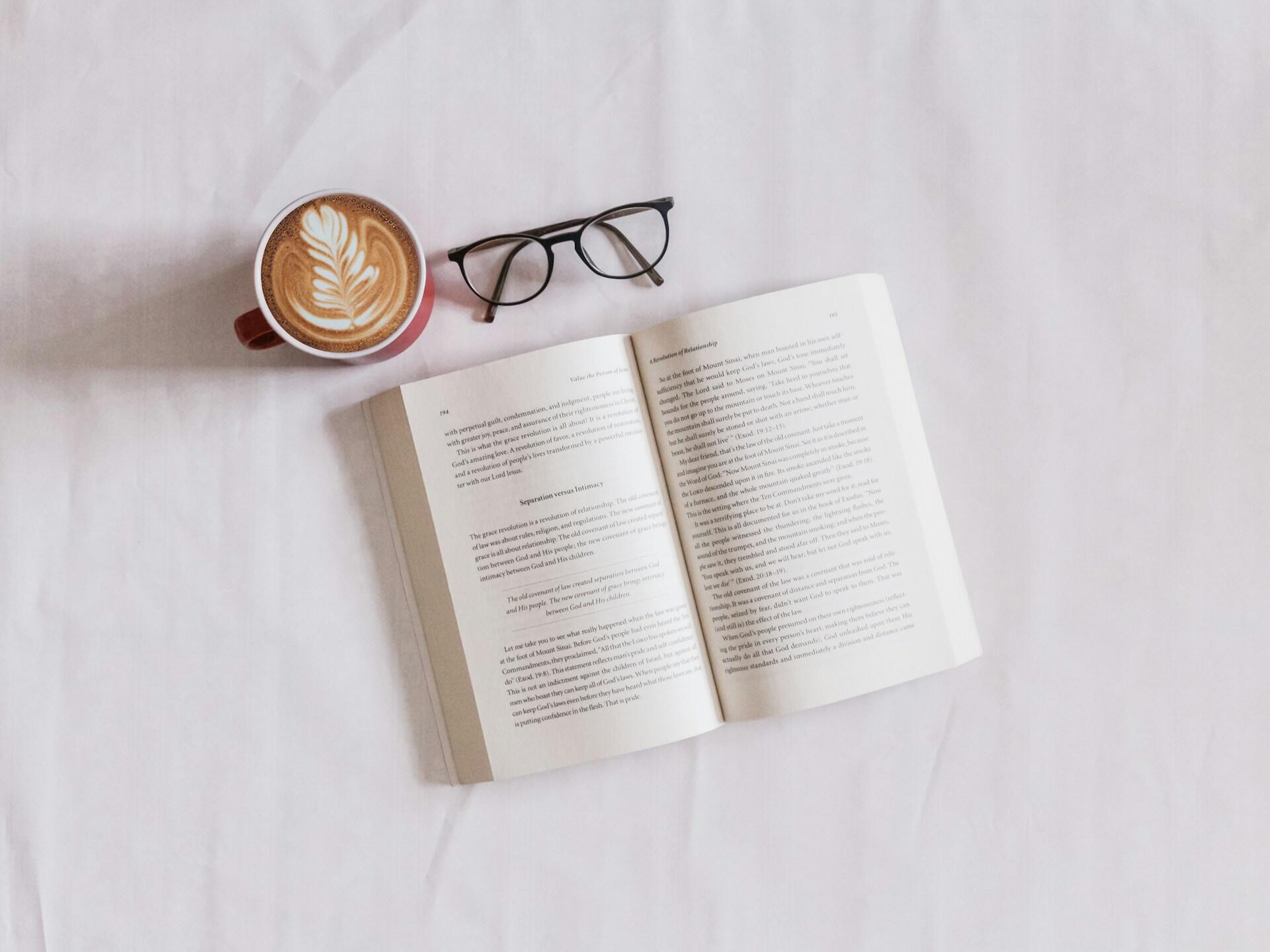


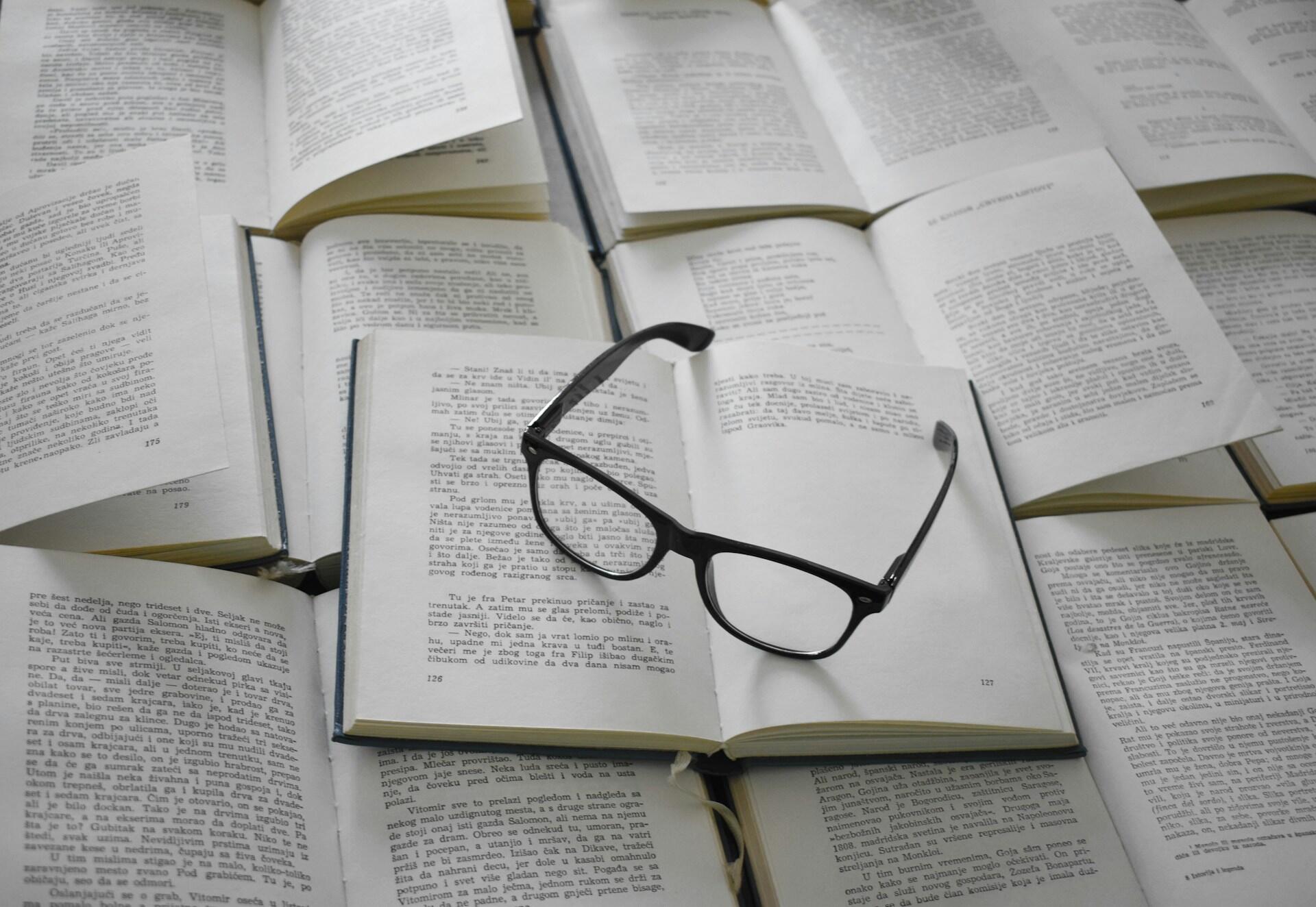
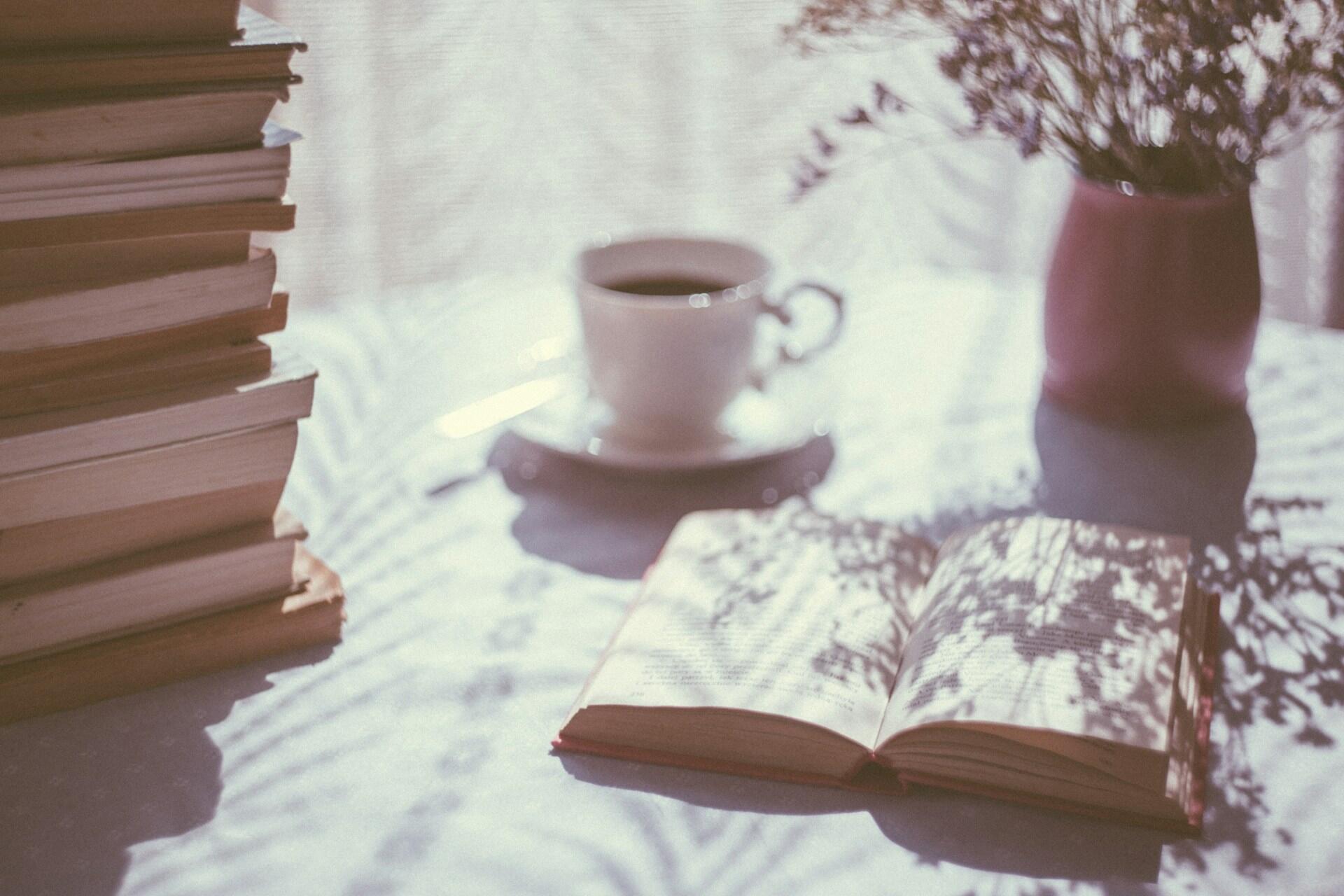



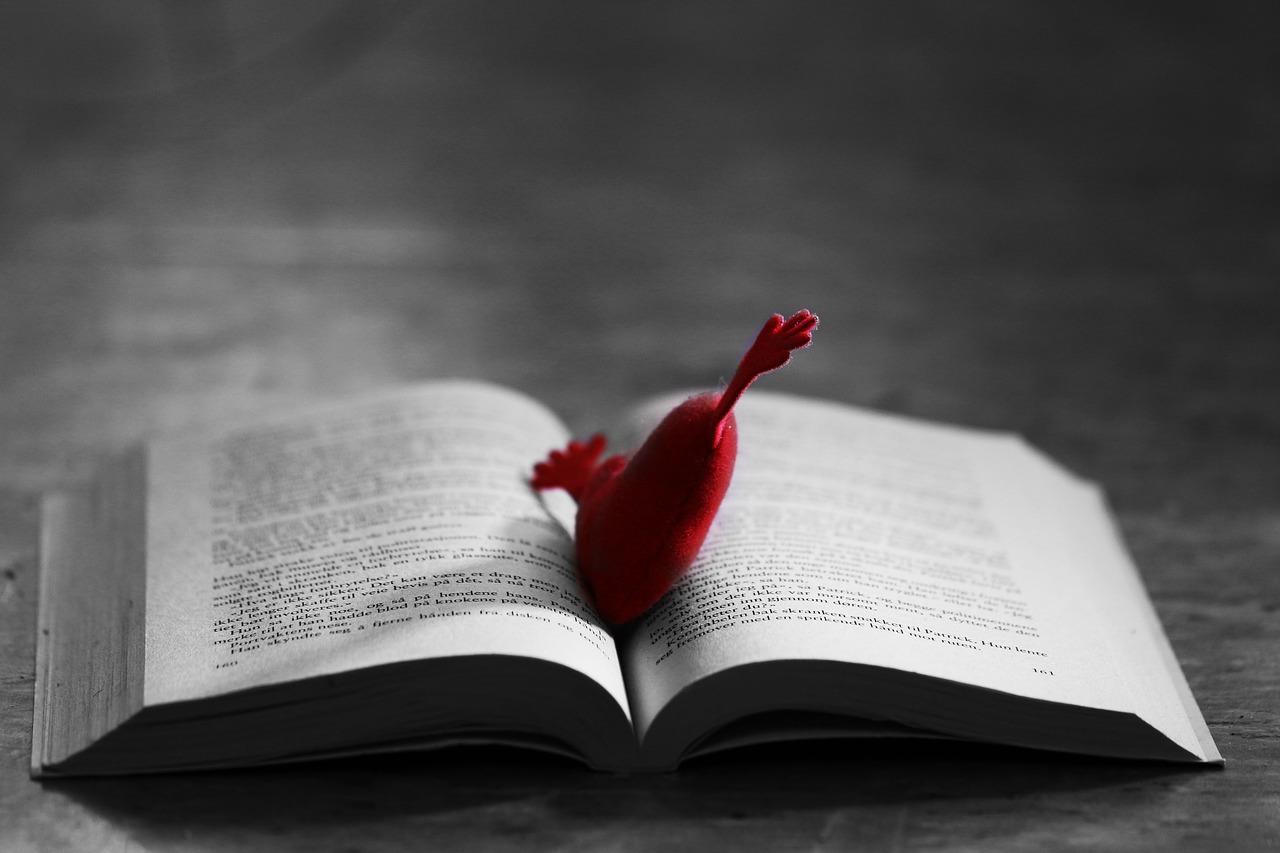
Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !