Chapitres

La fable
Le Chêne un jour dit au roseau :
Vous avez bien sujet d'accuser la Nature ;
Un Roitelet pour vous est un pesant fardeau.
Le moindre vent qui d'aventure
Fait rider la face de l'eau,
Vous oblige à baisser la tête :
Cependant que mon front, au Caucase pareil,
Non content d'arrêter les rayons du soleil,
Brave l'effort de la tempête.
Tout vous est aquilon ; tout me semble zéphir.
Encor si vous naissiez à l'abri du feuillage
Dont je couvre le voisinage,
Vous n'auriez pas tant à souffrir :
Je vous défendrais de l'orage ;
Mais vous naissez le plus souvent
Sur les humides bords des Royaumes du vent.
La Nature envers vous me semble bien injuste.
Votre compassion, lui répondit l'Arbuste,
Part d'un bon naturel ; mais quittez ce souci.
Les vents me sont moins qu'à vous redoutables.
Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici
Contre leurs coups épouvantables
Résisté sans courber le dos ;
Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots,
Du bout de l'horizon accourt avec furie
Le plus terrible des enfants
Que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs.
L'Arbre tient bon ; le Roseau plie.
Le vent redouble ses efforts,
Et fait si bien qu'il déracine
Celui de qui la tête au ciel était voisine,
Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts.
Fables, Livre I, Jean de la Fontaine
Lexique :
1 Roitelet : oiseau insectivore d’Asie et d’Europe. C’est l’un des oiseaux les plus petits de France.
2 Aquilon : terme uniquement poétique pour désigner le vent du Nord réputé froid et violent.
3 Zéphir : à l’inverse, vent léger, doux et agréable.
4 Sur les humides bords des Royaumes du vent : les marécages.

Méthode du commentaire composé en poésie
Avant la lecture
Il faut étudier le paratexte, c'est-à-dire le titre, l'auteur, la date, etc. Ces informations doivent être recoupées avec vos connaissances émanant du cours (courant littéraire, poète, recueil, etc.).
Le titre engage également à des attentes. Il donne des indices sur la nature du poème que le lecteur s'apprête à lire.
En poésie, la forme est décisive : regarder le texte « de loin » permet d'avoir déjà une idée de la démarche du poète :
- Vers, strophes ?
- Si vers : vers réguliers, vers libres ?
- Si vers réguliers : quel type de rimes ?
- Le nombre de strophes...
Comment trouver des cours de français afin de réviser ?
Pour la lecture
Nous vous conseillons de lire le poème plusieurs fois, avec un stylo à la main qui vous permettra de noter ou souligner une découverte, une idée.
1ère lecture :
- Identifier le thème général du poème,
- Identifier le registre : comique ? pathétique ? lyrique ? etc.,
- Identifier les procédés d'écriture pour diffuser le sentiment du registre choisi : l'exclamation ? La diérèse ? etc.
2ème lecture :
- Dégager le champ lexical,
- Place des mots : un mot au début du vers n'a pas la même valeur qu'un mot placé en fin de vers,
- Déceler les figures de style (généralement très nombreuses dans un poème),
- Travail sur les rimes : lien entre des mots qui riment, rimes riches ou faibles, etc.,
- Analyse du rythme avec les règles de métriques.
En filigrane, vous devez garder cette question en tête pour l'analyse des procédés d'écriture : comment le poète diffuse-t-il son thème général et comment fait-il ressentir au lecteur ses émotions ?
Rédaction du commentaire
| Partie du commentaire | Visée | Informations indispensables | Écueils à éviter |
|---|---|---|---|
| Introduction | - Présenter et situer le poète dans l'histoire de la littérature - Présenter et situer le poème dans le recueil - Présenter le projet de lecture (= annonce de la problématique) - Présenter le plan (généralement, deux axes) | - Renseignements brefs sur l'auteur - Localisation poème dans le recueil (début ? Milieu ? Fin ? Quelle partie du recueil ?) - Problématique (En quoi… ? Dans quelle mesure… ?) - Les axes de réflexions | - Ne pas problématiser - Utiliser des formules trop lourdes pour la présentation de l'auteur |
| Développement | - Expliquer le poème le plus exhaustivement possible - Argumenter pour justifier ses interprétations (le commentaire composé est un texte argumentatif) | - Etude de la forme (champs lexicaux, figures de styles, rimes, métrique, etc.) - Etude du fond (ne jamais perdre de vue le fond) - Les transitions entre chaque idée/partie | - Construire le plan sur l'opposition fond/forme : chacune des parties doit contenir des deux - Suivre le déroulement du poème, raconter l'histoire, paraphraser - Ne pas commenter les citations utilisées |
| Conclusion | - Dresser le bilan - Exprimer clairement ses conclusions - Elargir ses réflexions par une ouverture (lien avec un autre poème, un autre poète ? etc.) | - Les conclusions de l'argumentation | - Répéter simplement ce qui a précédé |
Ici, nous détaillerons par l'italique les différents moments du développement, mais ils ne sont normalement pas à signaler. De même, il ne doit pas figurer de tableaux dans votre commentaire composé. Les listes à puces sont également à éviter, tout spécialement pour l'annonce du plan.
En outre, votre commentaire ne doit pas être aussi long que celui ici, qui a pour objectif d'être exhaustif. Vous n'aurez jamais le temps d'écrire autant !
Commentaire composé
Introduction
Jean de La Fontaine est un fabuliste du XVIIème siècle. Ses fables ont vocation à plaire tout en instruisant. A cette fin, il use de la métaphore pour dépeindre le royaume des hommes.
« Le chêne et le Roseau », la fable qui nous occupe ici, occupe la vingt-deuxième position du Livre I, édité pour la première fois en 1668.
Elle est originale en deux points : elle met en scène des végétaux (alors qu'en général, La Fontaine utilise les animaux) et elle ne possède pas de morale explicite. Elle semble ne contenir qu'un récit, construit en trois étapes :
- Vers 2 à 17 : le chêne parle au roseau sur un ton condescendant
- Vers 18 à 24 : le roseau invite le chêne à la patience
- Vers 25 à 32 : l'intervention du vent comme mise à l'épreuve des discours
Annonce de la problématique
De fait, malgré l'apparence spéciale de la fable, en quoi est-elle malgré tout un apologue ?
On rappellera la définition d'apologue, d'après le CNRTL : « Court récit imaginaire ou parfois réel dont se dégage une vérité morale. ».
Annonce des axes
Dans un premier temps, nous verrons comment les discours des deux arbres participent de la construction morale du récit ; dans un second temps, il s'agira de montrer comment, implicitement, l'auteur suggère cette morale à son lecteur.

Développement
Deux discours annonciateurs
La première partie de la fable est construite sur un récit, opposant le chêne et le roseau. Cette situation dialogique rend la scène vivante en même temps qu'elle établit des profils bien spécifiques pour le Chêne et le roseau.
Un chêne arrogant
La fable comporte des rythmes ainsi que des rimes variés, contribuant à la vivacité de l'histoire.
Les irrégularités des vers permettent d'en mettre certains en valeur.
Dans le discours du chêne, les alexandrins, vers nobles par excellence, sont là pour souligner la grandeur du Chêne et l'arrogance dont il fait preuve ; au contraire, les vers courts, les octosyllabes, sont là pour témoigner du dédain qu'il manifeste à l'égard du Roseau, qui lui semble insignifiant.
Ainsi, dans le groupe de vers 4 à 9 :
Le moindre vent qui d'aventure
Fait rider la face de l'eau,
Vous oblige à baisser la tête :
Cependant que mon front, au Caucase pareil,
Non content d'arrêter les rayons du soleil,
Brave l'effort de la tempête.
Les trois premiers octosyllabes font référence au Roseau et à sa fragilité supposée. On notera également le champ lexical de la soumission et de l'insignifiance : « moindre vent », « oblige » et « baisser ».
Au contraire, les deux alexandrins qui constituent les vers 7 et 8 sont là pour asseoir la prétendue puissance du Chêne, posée comme le contraire du Roseau (contraire marqué par l'adverbe « cependant »). Et cette fois, le champ lexical est celui de la grandeur et de la toute-puissance : le Chêne se compare au Caucase (une chaîne de montagne de 700 kms de long et culminant à 5633 m) et se fait l'adversaire du soleil !
En outre, l'octosyllabe du vers 9 sert cette fois sa puissance, puisque le caractère abrupt de cette conclusion veut faire penser à la facilité avec laquelle il résiste à la tempête.
Les irrégularités métriques tendent également à la dramatisation du récit : on imagine un Chêne grandiloquent, fier de lui-même.
Dans ce discours du Chêne, tout est fait en opposition, pour suggérer sa surpuissance par rapport au minuscule roseau. Ainsi de l'antithèse, qui est renforcée par le parallélisme syntaxique et rythmique du vers 10 :
Tout vous est aquilon ; tout me semble zéphir.
Et au cours des vers suivants, il profite d'une apparente compassion pour se mettre à nouveau en valeur. Entre les vers 11 et 16, il se dit en effet capable de le protéger, mais la chose est impossible puisque le roseau ne pousse pas au bon endroit.
Ce discours, bien qu'il soit empli d'arrogance, a une valeur argumentative. On en voudra pour preuve les deux articulations logiques : « Cependant que » au vers 7 qui marque la comparaison, conclue par la remarque sentencieuse du vers 10 ; « mais » au vers 15 qui marque l'opposition, conclue à son tour par une nouvelle sentence au vers 17.
Ce vers 17 fait d'ailleurs écho au vers 2 qui constituait le point de départ de son discours. Tout l'enjeu de l'argumentation du Chêne était de démontrer au Roseau, d'une manière certes condescendante, qu'il était bien mal doté par la nature. Et le vers 17 arrive comme la conclusion supposée logique d'une démonstration qui lui semble irréfutable.
Mais le discours du Roseau lui montre qu'il ne l'a en rien convaincu.

Un roseau passif
Formellement, le Roseau semble répondre à l'image que le Chêne s'en fait. Sa réponse est bien plus courte que le discours de l'arbre : elle ne fait que six vers (18 à 24).
Mais dans le texte, le roseau fait preuve d'une confiance que l'on aurait pas soupçonnée, et dément le chêne, d'une manière péremptoire :
« Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. »
Ce vers est le seul décasyllabe de la fable et a en ceci une valeur spéciale : par ces dix syllabes seulement, le Roseau réfute intégralement toute la (si longue) thèse du Chêne. En outre, il a une valeur prophétique puisque cette affirmation, au moment où elle est dite, n'est pas prouvée, mais elle le sera.
Le vers 21 vient justifier cette confiance : le Roseau peut se permettre de plier, c'est là l'assurance qu'il ne rompra pas ; cela signifie, par antithèse implicite : puisque vous ne pliez pas, vous romprez.
C'est à l'image de ce qu'est le roseau : son discours repose sur le mode ironique et la confiance en sa force (puisque l'ironie et la dérision sont permises par une certaine confiance de celui qui parle). Ainsi en est-il de ces premières vers qu'il donne en guise de réponse : la « compassion » qu'il nomme ne le dupe pas, mais en l'invitant à « quitter » ce faux « souci », il prend lui-même le parti de la moquerie. On notera par ailleurs la diérèse sur ce « compassion », ce qui relève l'attention vers l'ironie.
Et son propos repose également sur deux connecteurs logiques, les « mais » aux vers 19 et 24, qui lui permettent d'arriver à la réfutation.
L'hémistiche du vers 24, avec la coupure qui marque la fin de sa réplique ('« Mais attendons la fin ») montre ainsi le Roseau comme celui qui préfère couper court (comme le fait l'hémistiche pour le rythme du vers) à la joute verbale. Il préfère attendre « la fin » de la fable et le vent qui arrive…
De fait, le roseau semble bien plus attaché aux faits que le Chêne, qui se complait dans sa rhétorique.
Qui exposent une morale implicite
La fin de la fable donne raison au Roseau, puisque c'est le Chêne qui s'écroule
Il convient de souligner le caractère diluvien (relatif au Déluge) du vent responsable de la chute du Chêne :
« Le plus terrible des enfants / Que le Nord eût portés jusque-là dans ses flancs »
On notera encore la maîtrise de l'art narratif par La Fontaine, qui crée un effet de suspense au vers 28 par la symétrie : « L'arbre tient bon ; le roseau plie ». Et le vent redouble d'effort jusqu'à faire tomber le Chêne.
Il faut alors relire les deux discours à la faveur de cette issue.
La présence sous-jacente du narrateur
Du fait de la présence de deux discours directs, l'auteur fait preuve d'une grande discrétion entre les vers 2 et 24. Il utilise néanmoins le mot « arbuste » au vers 18 pour qualifier le Roseau (qui n'en est pas un) pour le mettre sur le même plan que le Chêne.
A partir du vers 24 néanmoins, c'est le narrateur qui raconte. Il relate l'effet du vent sur les deux végétaux au présent de narration pour rendre l'action plus vive.
C'est lui qui nomme la tempête qui arrive comme « la plus terrible des enfants/Que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs ».
Les deux derniers vers, qui doivent être la place de la morale dans une fable traditionnelle, sont ceux où le narrateur se laisse le plus de latitude. En décrivant le Chêne comme « Celui de qui la tête au ciel était voisine / Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. », il critique explicitement la teneur de son discours puisqu'il ne dit rien d'autre que la mégalomanie du Chêne malgré son caractère profondément terrestre.
De fait, ce que veulent dire ces alexandrins, c'est : le Chêne s'est cru divin, alors qu'il était mortel : antithèse ciel/terre, ou dieu/homme.
En utilisant les alexandrins pour parler du Chêne, copiant la manière dont l'arbre parlait de lui-même, c'est une manière de les porter en dérision.
En critiquant donc explicitement l'arrogance du Chêne, La Fontaine invite à relire sa fable avec cette information : le Chêne serait responsable de son sort.
On peut, à l'aune de cette idée, analyser la fable sous deux rapports.
Une morale sociale
Le Chêne, par son arrogance et son verbe, est aisément identifiable aux puissants de ce monde, qui s'enorgueillissent du mépris qu'ils ont à l'égard de ceux qu'ils estiment plus faibles.
Le vent est celui qui a le dernier mot, l'arbitre moral des prétentions de chacun. En cela, il porte implicitement la morale : il est le Sort, le Hasard, ou la fatalité de la Mort.
En lisant cette leçon socialement, on peut alors dire : appartenir à la classe sociale aisée ne fait pas de soi un homme supérieur à la Nature. Il importe en cela de rester humble.

Une leçon autobiographique
En outre, connaissant la vie de La Fontaine, on peut envisager la morale d'une manière autobiographie.
Le Chêne représenterait Fouquet, qui est l'ancien protecteur de La Fontaine et financier du Royaume. Il fut emprisonné par le Roi (le Vent, ici, « Le plus terrible des enfants ») pour avoir détourné (volé) de l'argent du Royaume. Louis XIV l'a notamment puni pour avoir manifesté sa richesse en construisant son château de Vaux-le-Vicomte.
A contrario, La Fontaine est représenté par le Roseau, lui qui est habile et adaptable au milieu des courtisans. Il fait preuve des mêmes qualités langagières que La Fontaine utilise dans ses fables : l'ironie, l'efficacité, la patience.
Conclusion
Avec l'absence de morale explicite, La Fontaine encourage son lecteur à chercher le sens de l'histoire par lui-même. Mais en tant que fabuliste averti, il lui laisse de nombreuses pistes stylistiques et lexicales pour qu'il parvienne malgré tout à saisir les leçons d'un tel récit.
C'est là la force de l'écrivain : plutôt suggérer que montrer, et faire comprendre sans y paraître.
Résumer avec l'IA :














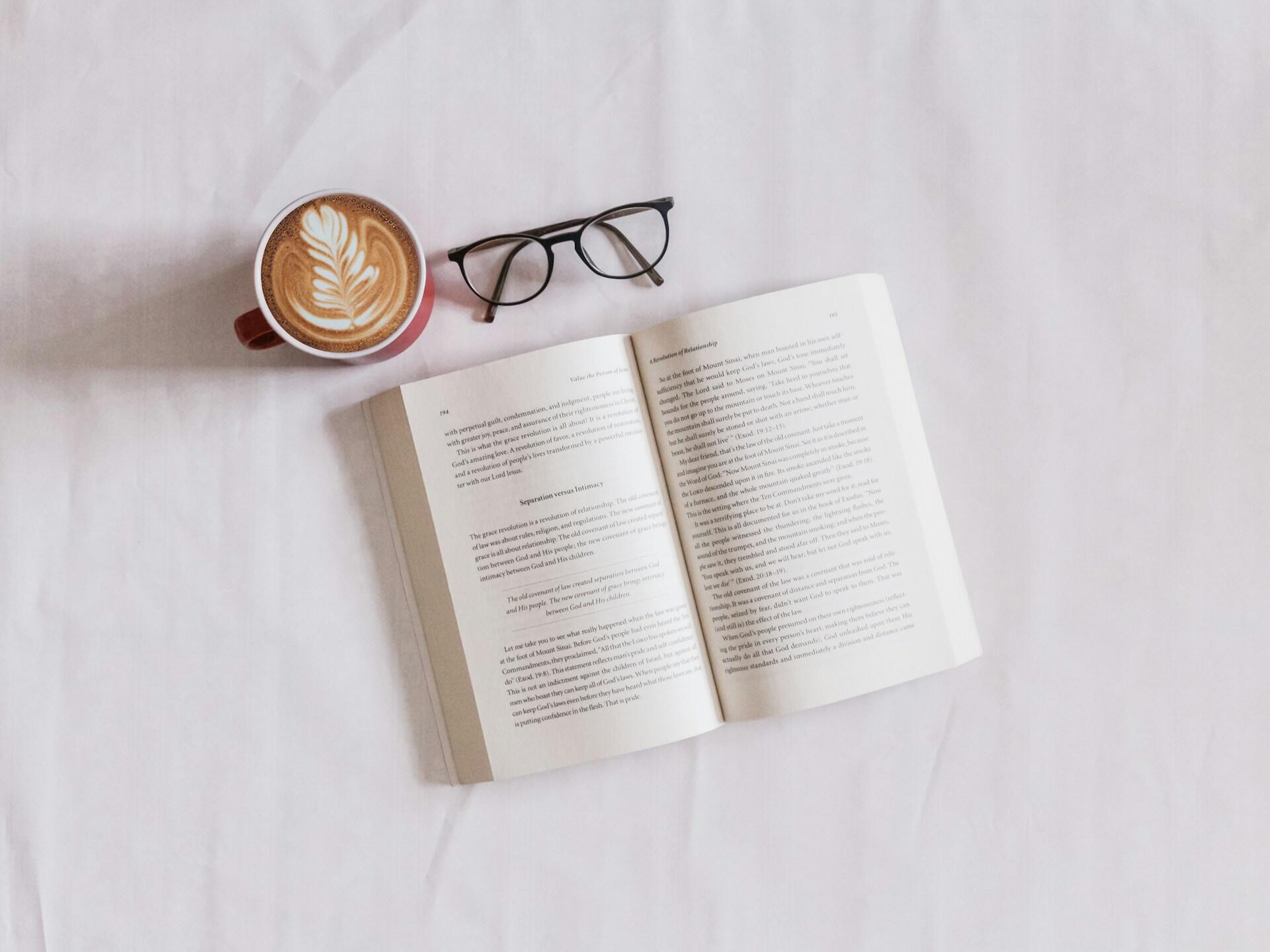


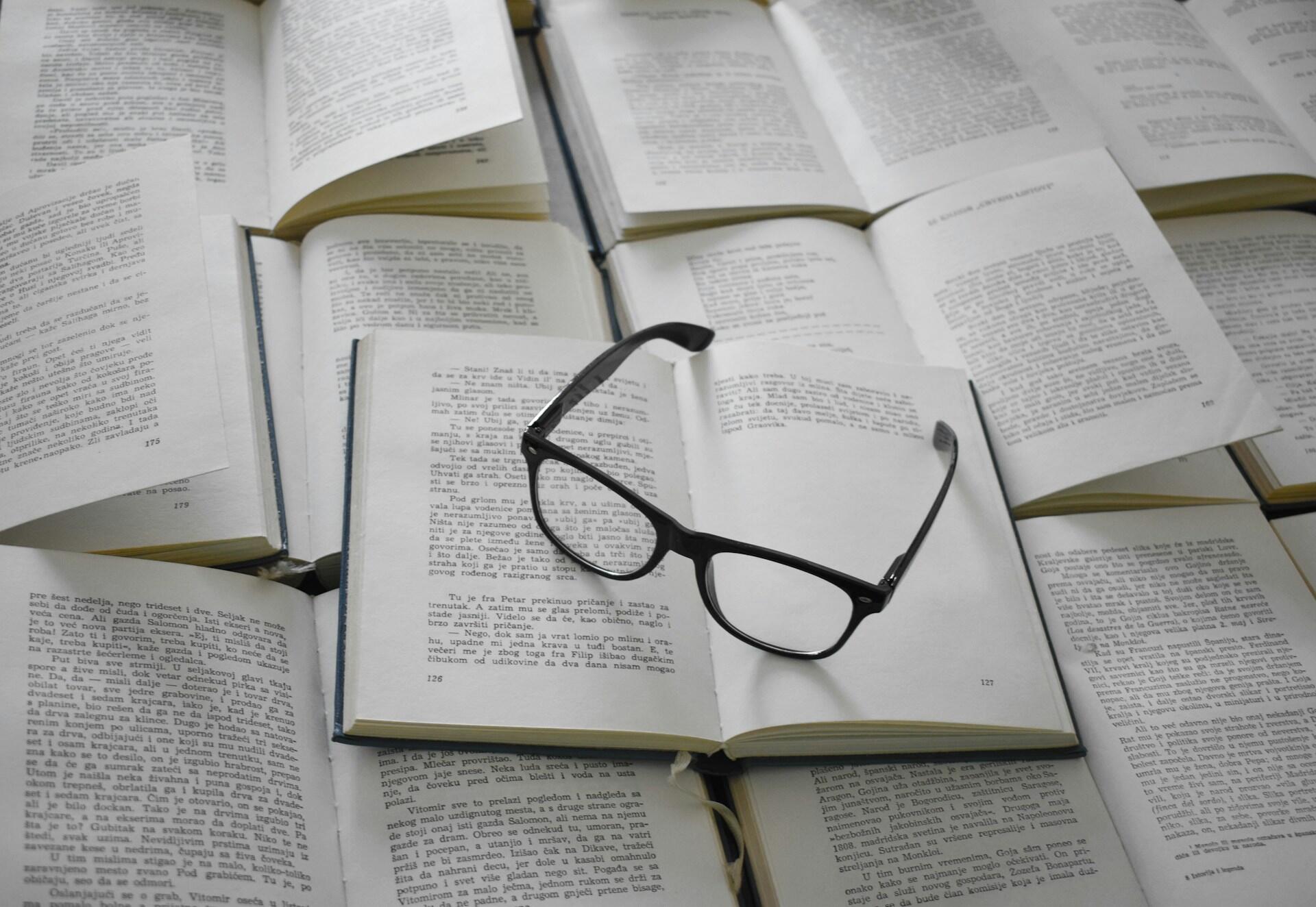
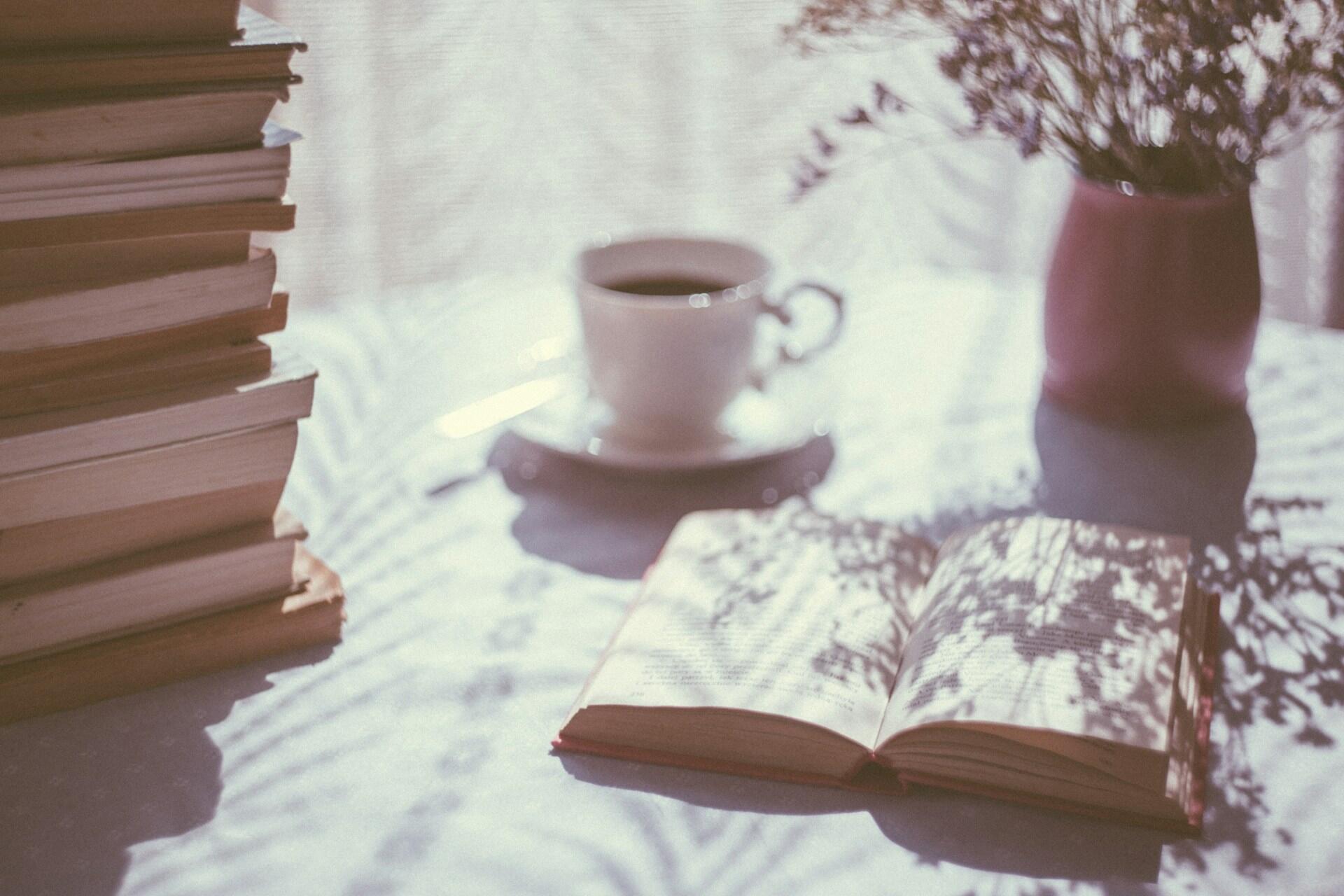



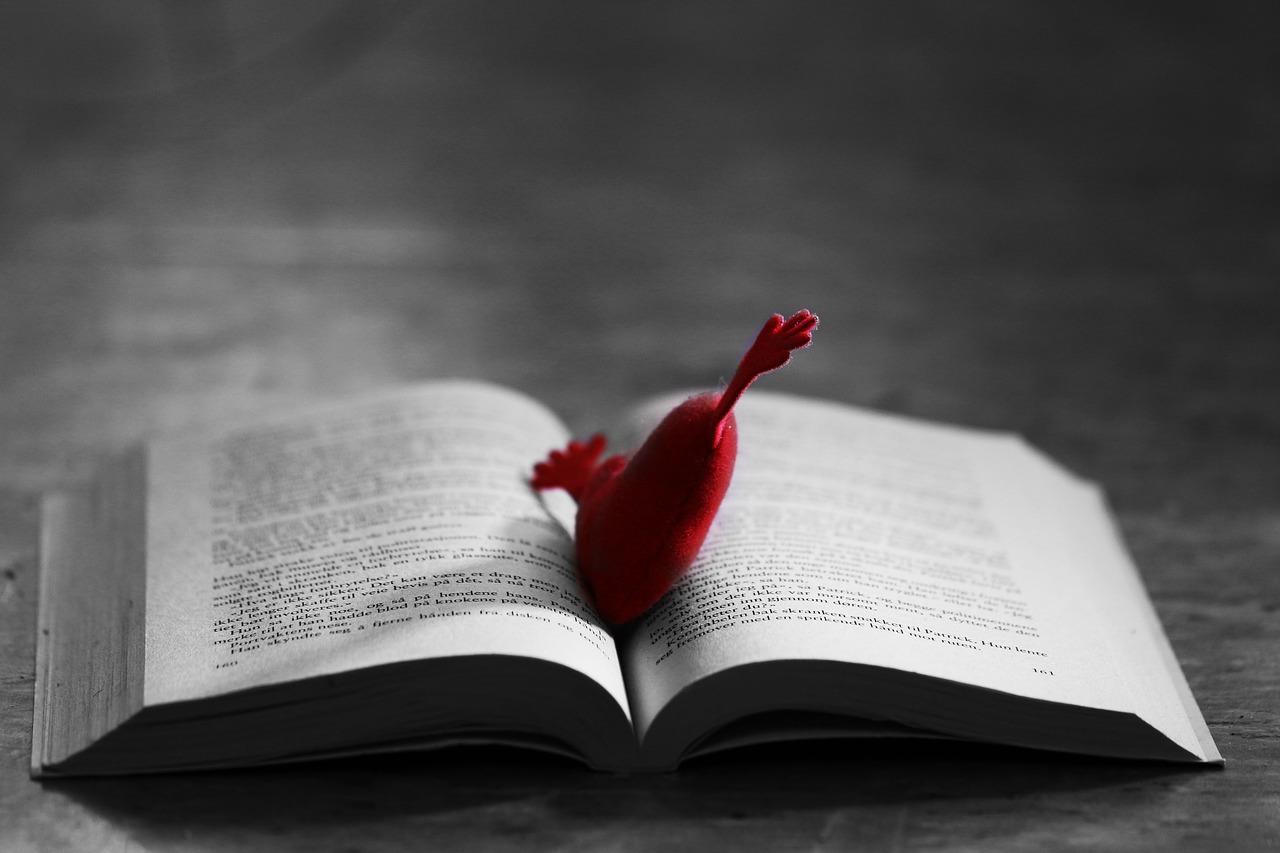
Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !