Chapitres
De nombreux principes qui gouvernent l’instance ont une valeur fondamentale.
Ils sont prévus soit par les traités ou la constitution.
C’est le cas du droit à un tribunal impartial et du droit à un tribunal indépendant et le droit à un procès équitable. Ou encore le droit à un procès publique ou le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
Ces principes ne concernent pas que le procès civil, nous allons les mettre de coté.
Nous allons étudier les principes directeurs du procès civil, le premier à avoir contenu ces principes.
Ce sont les premiers articles du CPC. Ces principes ont la même valeur juridique que les autres dispositions du code, autrement dit ils n’ont pas une valeur mais surtout ils n’ont pas une valeur supérieur. Ils sont au même niveau.
Ce sont des principes pour trois raisons :
- C’est à cause de leur généralité: ils s’appliquent devant toutes les juridictions et dans toutes la matières.
- En raison de leur légitimité : car ils garantissent le bon déroulement de la justice, ils traduisent l’idée que ce fait el législateur de ce procès civil.
- Ce sont des principes parce qu’ils ont une vertu directive, c’est à dire qu’ils indiquent à l’interprète la direction à suivre dans la mise en œuvre du CPC.

Le principe accusatoire
C’est le principe en vertu duquel les parties ont l’initiative de l’instance, de son déroulement, et de son instruction.
Ce principe vient de la doctrine italienne et ont été intégrés en droit Français par le doyen vizioz, dans la doctrine italienne ont l’appel le principe d’impulsion (les parties donnent l’impulsion au procès).
Les parties ont un rôle actif au procès à l’inverse du principe inquisitoire ou le juge a un rôle actif.
Le pouvoir d’impulsion reconnu aux parties
Les parties sont à l’origine du procès et de son déroulement, et sont responsables.
Article 1er du CPC :
Il prévoit que :
« seules les parties introduisent l’instance hors le cas ou la loi en dispose autrement ».
Le pouvoir d’impulsion est accordé aux parties et non pas aux juges. En principe dans le procès civil, il n’y a pas de saisine d’office du juge.
Il y a des cas ou la loi va donner le pouvoir au juge de se saisir d’office :
- en matière de procédure collective
- en matière d’assistance éducative
Jusqu’à 2007 il y avait une autre hypothèse : celle de la tutelle.

Suite de l’article 1ER « Les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi ». Les parties maîtrisent le début mais aussi la fin du procès, elles peuvent renoncer aux voies de recours.
Où trouver des cours de droit pénal ?
Article 2 CPC :
« Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent ».
En cours de droit, cela signifie que les parties maitrisent le déroulement de l’instance mais elles doivent supporter une charge particulière : elles doivent accomplir les actes de procédure. Des que les parties sont libres en fait elles deviennent responsables.
Exception au principe : les pouvoirs accordés au juge
En cours droit administratif, le juge a certains pouvoirs dans deux cas :
En 1 er lieu le juge dispose de pouvoirs important dans l’instruction du procès.
(L’instruction en procédure c’est toute la phase de recherches des preuves.)
Ses pouvoirs : devant certaines juridictions (TGI, CA) il existe un juge de la mise en état, qui est en quelque sorte un juge d’instruction civil. IL n’a absolument pas les pouvoirs d’un juge d’instruction pénal.
- Il veille à la ponctualité de l’échange des conclusions.
- IL fixe les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire.
- IL peut inviter les avocats à fournir des explications nécessaires à la solution du litige.
Il ne recherche pas les preuves amis c’est une espèce de chef d’orchestre, c’est normal car ce sont les parties qui sont à l’origine du procès et de son déroulement.
Le juge a un pouvoir très important : le pouvoir d’astreinte = condamnation pécuniaire qui s’ajoute à la condamnation principale pour le cas ou celle-ci ne serait pas exécuté dans le délais prescrit par le juge.
Le juge veille au bon déroulement de l’instance (article 3). Cela signifie que le juge peut imposer des délais, et il peut ordonner certaines mesures (pouvoir d’injonction du juge = il oblige quelqu’un à faire quelque chose).
En cours de droit en ligne, cette injonction c’est la limite principale au principe accusatoire, puisque là c’est le juge qui va obliger une partie à agir.
Résumé : principe d’impulsion (maitrise des parties) le juge contrôle que tout se passe bien, posture assez passive.
Le principe dispositif
C’est le principe directeur en vertu duquel le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Ce principe il détermine les rôles attribués aux parties et au juge dans la détermination de la matière litigieuse.
DA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS (« donne moi le fait je te donnerai le droit »)
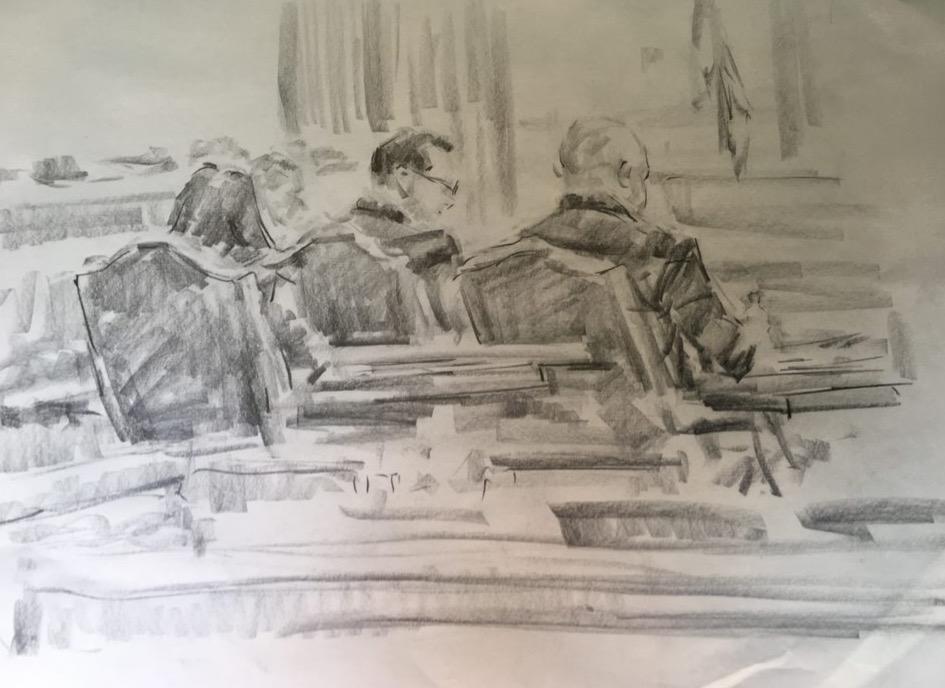
Les faits du procès : la primauté accordée aux parties
Le principe :
En principe les parties on la maître des faits du procès mais elles doivent assumer une responsabilité elles ont la charge de l’allégation.
C’est ce qu’il ressort de l’article 6 du CPC : « A l’appui de leur prétention, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’Allégation c’est le fait d’introduire dans le débat.
Cette charge pèse sur le demandeur et sur le défendeur.
Cette charge dispense le juge de rechercher des faits non allégués mais susceptibles pourtant de justifier la prétention d’une partie.
Si pendant le procès civil, si le juge ce rend compte que la personne pourrait perdre car elle n’a pas allégué les faits qui pourraient justifier leurs prétentions, il ne doit pas combler les lacunes.
Les parties doivent uniquement alléguer les faits concluant, c’est à dire qui justifie leur prétention par application d’une règle de droit.
Les parties peuvent invoquer de nouveaux faits à tout moment, sauf devant la cour de cassation.
En retour il est interdit au juge de s’échapper de ces faits.
L’article 7 pose cette règle :
« Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qu’ils ne sont pas dans le débat ». (Sur des faits non allégés).
Mais l’article 7 rajoute :
« Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoquées au soutient de leur prétention ».
Le juge peut aussi sur des faits allégé non invoqué (dans le débat mais pas invoqué), c’est ce que l’on appel des fait ADVENTICES.
Concernant les faits tirés du dossier c’est à dire des faits issus du dossier de procédure mais non allégué par les parties. Le juge peut les prendre en considération, à condition de respecter le contradictoire.
Si les parties ont la primauté en ce qui concerne les faits elles n’en ont pas l’exclusivité, autrement dit le juge se voit reconnaître certaines pouvoirs :
- Selon l’article 8, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaire à la solution du litige. Le juge fait ce qu’il veut ici.
- Selon l’article 179, le juge peut afin de les vérifier lui même prendre une connaissance personnelle des faits litigieux. (Vérifications personnelles).
Où trouver des cours droit des sociétés ?
Le droit applicable au procès : la primauté accordée au juge
Selon l’article 12 du code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Cela semble logique, mais on va voulu en fait exclure les jugements en équité (jugement selon son jugement personnel).
Selon l’article 12 le juge doit donner ou restituer leurs exactes qualifications, aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.
Ce pouvoir du juge c’est un pouvoir de requalification, soit les parties proposent une qualification qui n’est pas la bonne et le juge modifie la qualification, soit les juges n’ont proposé aucune qualification et c’est donc au juge de la fournir.
Ce pouvoir de qualification ne doit pas être confondu avec le pouvoir du juge de relever d’office les moyens de pur droit : c’est un moyen qui peut être relevé quelque soit le fondement juridique invoqué par les parties.
Ce sont les moyens que l’on peut relever parce qu’il se fondent sur des faits qu’ils sont déjà allégé.
Ce qui signifie que la cour de cassation a le droit de relever des moyens de pur droit puisqu’elle va se fonder sur des faits qui sont déjà allégé.
Ces moyens de pur droit on les oppose au moyens mélangés de fait et de droit : ils sont fondés sur des faits qui ne sont pas allégés.
La cour de cassation ne connaît pas de moyens mélangés de fait et de droit puisqu’il manque des faits.
Cette règle était prévue par l’article 12-3, or cette règle a été annulée par le CE car le juge été dispensé de respecter le contradictoire lorsqu’il relevé d’office un moyen de pur droit. En dépit de cette annulation la règle fait toujours partie du droit positif.
A l’heure actuelle le juge peut relever les moyens de pur droit mais il doit respecter le contradictoire.
Ce relevé d’office est-il une faculté pour le juge ?
Réponse rendue le 21 décembre 2007 en assemblée plénière, la cour de cassation nous dit : « si parmi les principes directeurs du procès l’article 12 oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties, il ne lui fait pas obligation sauf règle particulière de changer la dénomination, ou le fondement juridique de leur demande.
Il y a donc une obligation qui pèse sur le juge, c’est la qualification des faits.
Le juge dispose d’une faculté, c’est le fait de relever d’office les moyens de pur droit.
Arrêt fortement critiqué, les critiques proposent un autre solution , il faudrait distinguer les moyens de pur droit que le juge aurait l’obligation de relever d’office, et les moyens mélangés de fait et de droit (fondés sur des faits non invoqués) que le juge aurait la facule de relever d’office.
Simple primauté accordée au juge, donc les parties ont certains pouvoirs sur la règle de droit.
La primauté accordée au juge, ne signifie pas que les parités ne jouent aucun rôle en la matière.
4 hypothèse ou les parties influencent grandement le droit applicable :
- L’article 13 laisse entendre que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige. (cela n’arrive jamais)
- L’article 1 laisse entendre que les parties peuvent qualifier les faits à charge pour le juge de les requalifier si nécessaires.
En pratique ce n’est pas une faculté mais c’est une obligation. Les parties ont l’obligation d’invoquer les règles de droit dans leur assignation et dans leur conclusion. (Annulation si elles ne le font pas).
- Selon l’article 12 les parties peuvent lier le juge par les qualifications et point de droit auxquelles elles entendent limiter le débat.
Il faut deux conditions : D’abord que les droits soient disponibles et ensuite il faut un accord écrit des parties. (Accord procédural). Cet accord est très fréquent dans les litiges internationaux, car il permet d’écarter la règle de conflit rendant compétente la loi étrangère.
- Les parties peuvent enfin conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur.
Il faut que les droits soient disponibles, il faut un accord écrit, et surtout il faut que le litige existe déjà.
A l’heure actuelle, une partie de la doctrine estime que le principe dispositif n’existe plus et qu’il a été remplacé par le principe de coopération. , autrement dit le procès civil est la chose commune des parties et du juge.
Principe très important, seul principe directeur qu’on trouve que en matière civile.
Le principe du contradictoire
Définition de ce principe :
C’est le principe directeur du procès en vertu duquel aucune partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelé.
On lui donne également ne nom du principe de la contradiction : dans ce cas la contradiction c’est la situation juridique qui naît lorsque les parties adverses peuvent faire valoir leur moyen de défense et leurs prétentions respectives dans l’instance qui les opposent.
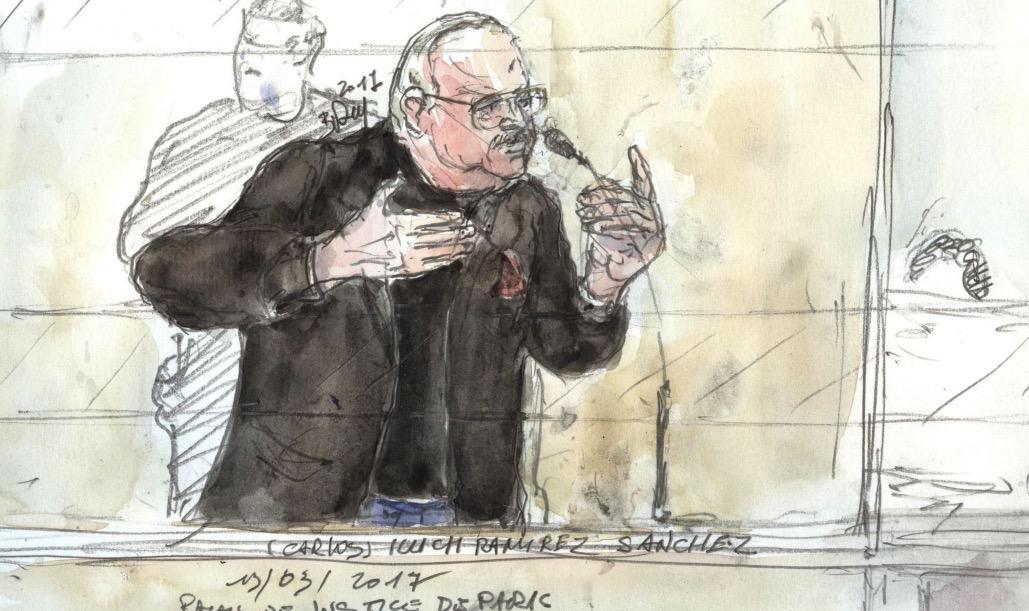
- 1. Le contradictoire au sens large : le respect des droits de la défense (sujet exam)
Au sens large le contradictoire renvoi au principe du respect des droits de la défense. Les droits de la défense englobent le contradictoire mais ils vont au delà du contradictoire. Le contradictoire c’est une partie des droits de la défense.
Dans les droits de la défense on met d’abord :
- Le droit d’être informé de l’introduction d’une instance à laquelle on est partie.
- Le droit d’être entendue par la juridiction compétente. (droit au juge, droit d’aller devant le juge).
- Le droit de discuter les prétentions de l’adversaire. C’est cela au sens propre que l’on appel le contradictoire.
- Le droit de bénéficier et d’exercer les voies de recours.
Des obligations vont peser sur le juge dans les droits de la défense :
- Obligation de garder sa neutralité : l’indépendance et l’impartialité
- Obligation de motiver ses décisions (au niveau de la cour d’assise il y avait des difficultés)
- Obligation de faire respecter la loyauté de la procédure.
Ce principe tend à devenir un principe autonome. Deux arrêts vont dans ce sens : arrêt 1 ère chambre civile 7 juin 2005, la cour de cassation a considéré que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats.
=> Arrêt confirmé dans un arrêt du 4 octobre 2006, ici la cour de cassation a visé le principe de loyauté procédurale.
Ce qui peut poser difficulté : la valeur juridique des droits de la défense
Les droits de la défense ne sont pas prévus par le code de procédure civile. La doctrine a toujours a toujours considéré qu’il s’agissait d’un principe de droit naturel. La jurisprudence confirme cette analyse dans un arrêt de la chambre civile du 7 mai 1828 dans lequel al cour a estimé que la défense est un droit naturel.
La plupart des auteurs estime que les droits naturels ça n’existe pas. Ces droits ont été consacrés. La cour de cassation dans un arrêt assemblée plénière 30 juin 1995 a jugé que « la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ». Tout le contentieux judiciaire est soumis à ce principe constitutionnel. C’est une des rares fois où la cour se fonde sur la constitution.
Cet arrêt a été confirmé par une décision du CC qui considère que les droits de la défense constituent un PFRLR. LA CEDH estime que les droits de la défense font partie du droit à un procès équitable.
- 2. Le contradictoire au sens strict : le droit de discuter les prétentions de son adversaire
Le contradictoire ici renvoi à la contradiction : la possibilité de discuter les éléments du procès.
Le contradictoire est prévu par l’article 14 du CPC : « nul partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Le contradictoire implique le droit d’être entendu, cela veut dire que chaque partie doit être en position de discuter les prétentions de l’adversaire. On est entendu dans sa défense. Le procès civil doit poser le cadre dans lequel va se développer la discussion.
Il y a des hypothèses où le contradictoire va être sacrifié :
- D’abord la procédure sur requête. C’est une procédure non contradictoire. Dés l’instant qu’une difficulté va surgir, le contradictoire va être réintroduit dans le procès. Par nature pas contradictoire mais peut le devenir.
- La procédure par défaut, c’est lorsque l’une des parties est absente de son procès. Dans ce cas là, dans le 1 er jugement il n’y aura pas de contradictoire mais si la parité absente se plein on rétablira le contradictoire.
- Les obligations pesant sur les parties
Les règles sont posées par l’article 15 du CPC, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile : les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. » Chaque partie doit communiquer à l’autre tous les éléments du procès : éléments de fait de droit et de preuve.
Les conclusions déposées et les pièces produites très peu de temps avant l’ordonnance de clôture peuvent être sanctionnées sur le fondement de l’article 15. L’ordonnance met fin à l’ordonnance de mise en l’état qui intervient avant la phase du procès.
En pratique le juge ne sanctionne jamais le retard et reporte l’audience de façon à ce qu’il y ait une véritable discussion des éléments.
- Le juge
La règle est posée par l’article 16 « Le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ».
D’abord le juge doit faire observer le principe du contradictoire, le juge doit veiller à ce que les parties se communiquent en temps utile les moyens de fait, de droit et de preuve. Ici on demande au juge de faire respecter l’article 15.
Le juge doit observer lui même le contradictoire.
- D’abord si le juge ordonne une mesure à l’insu d’une partie celle-ci bénéficie d’un recours pour combattre la décision qui porterait atteinte à ses intérêts. Toujours la même logique, au départ on ne respecte pas le contradictoire.
- Si le juge relève d’office les moyens de droit il doit solliciter les observations des parties.
- Si le juge relève d’office des moyens de fait, il doit mettre les parties en position d’en débattre.
Le contradictoire impose donc une discussion systématique.
Résumer avec l'IA :
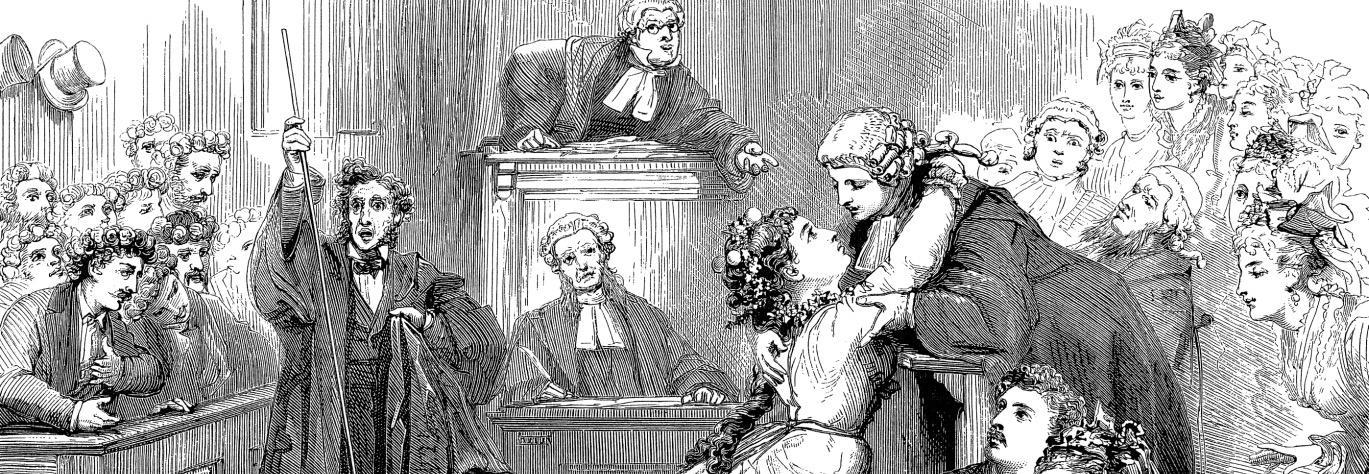





















Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !