Chapitres
📚 Fiche du livre
Boule de Suif est une nouvelle réaliste de Guy de Maupassant parue en 1880. On y découvre l'histoire sordide arrivée à la dénommée Boule de Suif durant la guerre de 1870.
Maupassant en profite pour dénoncer l’hypocrisie de la haute société comme du clergé. Boule de Suif, qui est une prostituée, y apparaît bien plus respectable que les bourgeois, plutôt monstrueux qu'honnêtes.

Résumé de la nouvelle
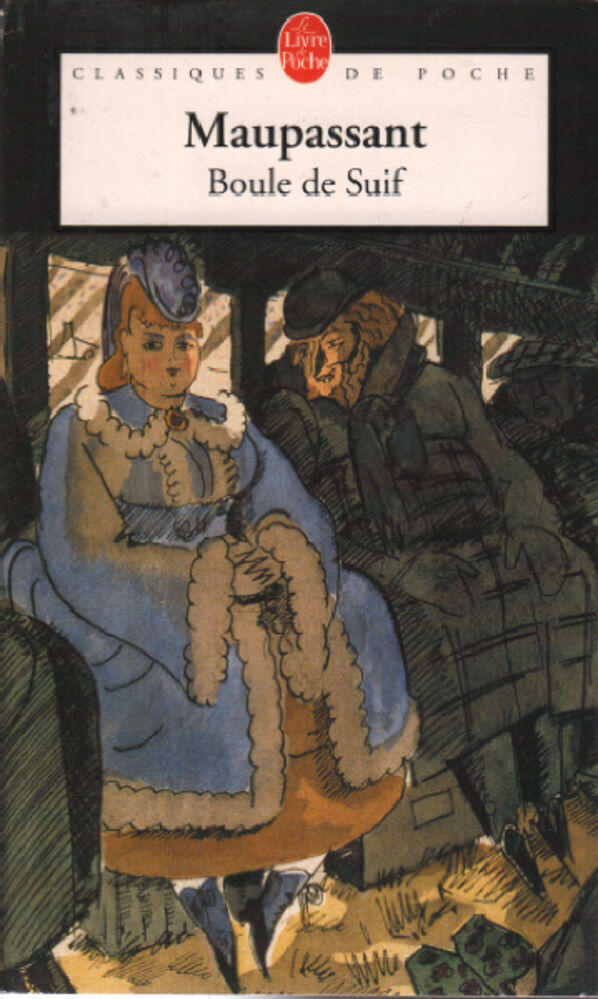
L'histoire se déroule durant la guerre franco-prussienne de 1870 : c'est l'hiver, les troupes françaises se replient et les Prussiens envahissent Rouen.
Boule de Suif, une prostituée jadis ainsi surnommée pour son embonpoint, se retrouve dans une diligence tirée par six chevaux en compagnie de neuf autres voyageurs. S'y trouvent :
- Un couple de commerçants
- Deux couples de la bourgeoisie et de la noblesse
- Deux religieuses
- Un démocrate
Tous s'inquiètent d'une manière ou d'une autre de la présence de cette prostituée avec eux.
La diligence s'enfuit vers Dieppe mais la neige ralentit sa progression. En plus du froid qui se fait sentir, les voyageurs commencent à avoir faim. Boule de Suif est la seule à avoir emporté des provisions et elle n'hésite pas à les partager avec ses compagnons de voyage. Ceux-ci oublient volontiers leurs préjugés pour le temps du repas, trop heureux de sentir leurs appétits satisfaits. On parle beaucoup, de la guerre surtout ; et on s'impressionne même de Boule de Suif pour les actes de bravoure dont elle fait le récit.
Lorsque le soir arrive, la diligence fait une halte à l'auberge de Tôtes, dans laquelle dorment aussi des Prussiens. Avant le souper, l'officier prussien fait des avances à Boule de Suif mais c'est une bonapartiste ; pour cette raison, elle refuse de coucher avec l'ennemi. Le militaire interdit alors à la diligence de repartir tant que Boule de Suif n'aura pas couché avec lui.
Le lendemain, les passagers restent donc bloqués à Tôtes. Le soir, quand l'aubergiste vient demander à la femme, de la part du militaire, si elle n'a pas changé d'avis, tous comprennent qu'il faudra forcer la prostituée à s'offrir au Prussien. Au déjeuner du jour suivant, le groupe entier met en place une stratégie commune afin de la convaincre de se sacrifier pour le bien de tous.
Au dîner, c'est la plus vieille des religieuses qui explique innocemment qu'elle doit se rendre au Havre pour soigner des malades de la vérole. Au soir du quatrième jour, Boule de Suif finit par accepter et passe la nuit avec l'homme d'abord éconduit.
La diligence peut repartir.
Or, seule Boule de Suif n'a pas eu le temps de se faire préparer des petits plats, trop occupée par la charge que le groupe lui confia. Quand arrive l'heure du repas, tous se régalent, hormis la pauvre femme. En guise de nourriture, elle n'aura droit qu'au mépris de la part des gens qu'elle a nourris puis libérés.
Personne ne la regardait, ne songeait à elle. Elle se sentait noyée dans le mépris de ces gredins honnêtes qui l’avaient sacrifiée d’abord, rejetée ensuite, comme une chose malpropre et inutile. Alors elle songea à son grand panier tout plein de bonnes choses qu’ils avaient goulûment dévorées, à ses deux poulets luisants de gelée, à ses pâtés, à ses poires, à ses quatre bouteilles de Bordeaux ; et sa fureur tombant soudain, comme une corde trop tendue qui casse, elle se sentit prête à pleurer. Elle fit des efforts terribles, se raidit, avala ses sanglots comme les enfants, mais les pleurs montaient, luisaient au bord de ses paupières, et bientôt deux grosses larmes, se détachant des yeux, roulèrent lentement sur ses joues. D’autres les suivirent plus rapides, coulant comme des gouttes d’eau qui filtrent d’une roche, et tombant régulièrement sur la courbe rebondie de sa poitrine. Elle restait droite, le regard fixe, la face rigide et pâle, espérant qu’on ne la verrait pas.
Les personnages principaux

Les personnages de Boule de Suif fonctionnent comme des symboles : ils représentent les plus hautes sphères de la soi-disant moralité au sein de la société. On trouve :
- Des religieuses
- Des petits bourgeois issus du commerce,
- Des nobles de l'ancien monde (le comte et la comtesse)
- Un noble du nouveau monde (le « democ »)
Il est donc clair que Maupassant a voulu mettre en scène les diverses classes sociales de son époque ainsi qu'un riche éventail de types humains.
| Personnage | Description |
|---|---|
| Boule de Suif | Prostituée généreuse, courageuse et patriote, prête à sacrifier son honneur pour aider les autres. |
| Cornudet | Démocrate et républicain idéaliste, opposé à la guerre, moqué par les autres voyageurs. |
| M. et Mme Loiseau | Marchands de vins, opportunistes et vulgaires, souvent comiques par leur attitude triviale. |
| M. et Mme Carré-Lamadon | Bourgeois aisés, prétentieux et préoccupés par leur statut social. |
| Le Comte et la Comtesse de Bréville | Nobles conservateurs, attachés à leurs privilèges, hypocrites dans leur comportement. |
| L'officier prussien | Antagoniste imposant des conditions humiliantes, incarne l’occupant sans scrupule. |
Boule de Suif
Tout au long de la nouvelle, elle est désignée par son surnom, « Boule de Suif », qui fait allusion à son physique rond et gras (« suif » signifie graisse). Il faudra attendre plusieurs pages pour apprendre son vrai nom, Elisabeth Rousset.
Ce simple détail indique qu’elle n'a pas sa place parmi la société « honnête » car c'est le patronyme qui fait l'identité et le respect. Or, le sien n’est prononcé que trois fois au cours de l’histoire, qui plus est dans un contexte déshonorant, puisque c'est toujours lorsqu'on lui demande si elle accepte de coucher avec l'officier.
Pourtant, Boule de Suif n’est pas une prostituée de bas étage : elle a une maison à Rouen et une domestique. Elle est plutôt une « demi-mondaine » car ses clients semblent être des bourgeois. C'est dire qu'elle vit de cet ordre social et de ses vices privés.
Elle est petite, ronde de partout, grasse à lard, avec des doigts bouffis, étranglés aux phalanges, pareils à des chapelets de courtes saucisses, avec une peau luisante et tendue, une gorge énorme qui saillait sous sa robe, elle restait cependant appétissante et courue, tant sa fraîcheur faisait plaisir à voir.
Sa figure était une pomme pivoine prêt à fleurir, et là-dedans s’ouvraient, en haut, deux yeux noirs magnifiques, ombragés de grands cils épais qui mettaient une ombre dedans ; en bas, une bouche charmante, étroite, humide pour le baiser, meublée de quenottes luisantes et microscopiques.
Maupassant ne la présente pas comme tout à fait stupide ; elle est plutôt naïve et inconsciente - au moins jusqu’à la dernière scène - de la malveillance fondamentale des autres voyageurs. En outre, cette naïveté est plutôt la conséquence de sa nature généreuse, qui la pousse à faire confiance aux autres, et à vouloir les aider. Pour preuve, elle offre sans rechigner toutes ses provisions à ses compagnons dès le premier jour de voyage. Or, ce sacrifice n’est pas superflu pour elle, puisque tout dans son physique indique une extrême gourmandise.
De même, lorsqu’elle cède finalement à l’officier, c’est pour satisfaire les autres voyageurs. Seule, il ne fait aucun doute qu'elle aurait résisté jusqu'au bout. Le Prussien l’a bien compris, et c’est pour cela qu’il retient tous les voyageurs. Il compte sur la présence de ces êtres faibles et lâches pour faire fléchir la jeune femme.
Il faut également préciser que Boule de Suif a un respect sincère pour la patrie, pour l'Église et pour le trône, un triptyque qui devrait représenter cette société « honnête » et qui la méprise. Elle a dû fuir Rouen car elle a agressé physiquement un militaire prussien qui était venu réquisitionner son domicile. Cet acte montre son amour pour la France et met en relief la lâcheté de ses compagnons pourtant remplis d'orgueil.
Notons également un paradoxe amusant : son respect pour la religion. Dans la diligence, elle propose de la nourriture aux deux religieuses d’une voix « humble et douce ». Ce sont également les arguments de la religieuse, habillements sollicités par Mme de Bréville, qui semblent finalement faire céder Boule de Suif. Enfin, elle se rend à l’église et explique à ses compagnons que « c’est si bon de prier quelquefois ». Sa piété, malgré sa profession, apparaît donc sincère. Par là, elle contraste avec les prières mécaniques des religieuses et la religiosité hypocrite de la comtesse, qui n’hésite pas à abuser de l'argument pieux pour pousser Boule de Suif dans les bras du prussien.
En somme, son personnage est construit sur une apparente contradiction entre sa vie de prostituée et son attachement au patriotisme, à l’Eglise et à l’Empereur. Boule de Suif est une victime qui doit nous inspirer la pitié et la compassion, car cette fille soit-disant corrompue paraît bien plus honnête que les bourgeois de la société dite « honnête ».
Cornudet
Cornudet est essentiellement défini par ses opinions politiques. C’est un démocrate, ennemi du régime impérial et de la bourgeoisie qui s’y est ralliée, d’où son surnom « Cornudet le démoc ». A priori, il apparaît plus sympathique que les autres personnages et le fait qu’il soit lui aussi marginal le rapproche de Boule de Suif - notons aussi que si celle-ci s’appelle Elisabeth Rousset, Maupassant a doté Cornudet d’une barbe rousse. Mais en définitive, Cornudet est un faible qui finira également par trahir Boule de Suif.
Maupassant insiste en effet sur le côté vain et ridicule de Cornudet. Il est détesté la bourgeoisie, alors qu’il est lui-même un fils de bourgeois, qui a hérité d’« une assez belle fortune ». Ses actes révolutionnaires se résument surtout à de grands discours ; sa bravoure devant l’ennemi est relative. Il s’est contenté de pièges et de barricades, pour finir par s’enfuir comme les autres dès l'arrivée des Prussiens.
À la fin de la nouvelle, au lieu de défendre Boule de Suif et d’affronter directement les bourgeois qui la laissent pleurer dans son coin, il se contente de narguer tout le monde en chantant La Marseillaise.
Lorsque Maupassant écrit : « Les démocrates à longue barbe ont le monopole du patriotisme comme les hommes en soutane ont celui de la religion », il veut ainsi montrer que la foi républicaine de Cornudet se situe au même niveau d'hypocrisie que la foi religieuse du clergé.
La preuve finale de son prosaïsme et de sa lâcheté, c'est le peu de solidarité de Cornudet envers Boule de Suif, sachant que cette absence de solidarité se justifie par le fait qu’elle a refusé ses avances. Celle-ci, en effet, lui interdit l’entrée de sa chambre par « pudeur patriotique ». Autrement dit, la femme « facile » ne veut pas se prostituer en présence de l’occupant prussien.
Ainsi, malgré son sentiment de supériorité morale, Cornudet est certainement aussi égoïste que les bourgeois qu’il hait, et facilement corruptible.
Les Loiseau
Monsieur Loiseau est un homme du peuple, sans dignité ni éducation. Il n'est bourgeois que parce qu'il est « parvenu ».
On voit notamment lors du dîner final son goût pour les plaisanteries sexuelles, qui révèle sa nature vulgaire. On remarque aussi qu’il ne sait pas se tenir : il est le premier à crier famine dans la diligence. C’est par ailleurs le seul moment de la nouvelle où il se montre amical. En effet, il exprime sans honte cette faim que tous les autres voyageurs ressentent, et son côté simple, qui contraste avec l’attitude hautaine des autres bourgeois, l’amène à accepter le premier la nourriture et le rhum que les autres dédaignent.
Maupassant insiste donc sur sa bassesse morale. Même ses amis le considèrent comme un « fripon madré ». Le vin qu’il vend est plusieurs fois qualifié de médiocre. Il n’a aucun scrupule patriotique, et compte bien exiger au Havre le paiement, par l’armée française, de l’infâme piquette qu’il lui a vendue.
Il se montre particulièrement infect lorsque, bouillant de rage et d’impatience devant le refus de Boule de Suif face à l'officier, il propose aux voyageurs de la livrer « pieds et poings liés » à l’officier prussien. La ruse et la malhonnêteté font à ce point partie de son caractère qu’il ne peut s’empêcher de tricher aux cartes avec la complicité de son épouse.
Et pour cause, sa femme est d’un caractère aussi méprisable que lui, bien qu’elle soit différente. Si Loiseau est, dans ses meilleurs moments, bon vivant et convivial, Mme Loiseau est dure et sèche. Son « âme de gendarme » (p.32) ne contient pas une once de générosité ni d’humour. Quand son mari, par plaisanterie, dit aux voyageurs que sa faim est telle qu’il paierait cent francs pour un simple jambonneau, Mme Loiseau a un geste de dépit que lui oblige son avarice.
La différence de caractère entre les deux époux se reflète dans leur physique : alors que Loiseau est petit, gras et rougeaud, sa femme est grande et tout son corps n’est qu’une « dure carcasse ».
Sans surprise, les Loiseau participeront activement à la « conspiration » pour faire capituler Boule de Suif et se réjouiront de voir Boule de Suif soi-disant souillée par l'acte sexuel.
Les Carré-Lamandon
Plus riche que les Loiseau, les Carré-Lamandon sont aussi, comme dit Maupassant, d’une « caste supérieure ». Ce sont de « vrais » bourgeois, avec toute l’éducation et la tenue que ce statut implique. Mais là encore, ce n’est qu’une apparence, ou une affaire d'hypocrisie.
Industriel normand riche et respecté, M. Lamandon-Carré est un homme qui vit constamment dans la dissimulation. Durant le régime impérial, il a fait figure d’opposant politique, mais, comme l'écrit Maupassant, c’est uniquement pour faire « payer plus cher son ralliement » au parti impérial.
Il n’a donc pas de véritables et honnêtes convictions politiques. Ses seuls intérêts sont l’argent et le prestige social.
Cette absence de convictions provoque de flagrantes contradictions internes. Si, d’une part, il admire le panache militaire, ce grand industriel déplore, d’autre part, que l’armée coûte aussi cher à l’Etat, et emploie de manière « improductive » quantité de bras que l’on pourrait utiliser pour « de grands travaux industriels ».
À travers lui, Maupassant critique l’ambiguïté idéologique de la grande bourgeoisie marchande.
Quant à sa femme, l’auteur la décrit comme jeune et jolie. Et si elle montre beaucoup de dédain à l’égard de Boule de Suif, elle n’est guère plus vertueuse que la prostituée. En effet, la « jolie Mme Carré-Lamandon » est « la consolation des officiers de bonnes familles envoyées à Rouen en garnison ». C'est dire qu'elle trompe allègrement son mari, qu’elle n’a sans doute épousé que pour son argent, avec des hommes plus jeunes que lui.
Sa faiblesse pour les jeunes officiers se confirme quand elle affirme que l’officier prussien lui paraît « pas mal du tout ». Malgré sa façade de respectabilité bourgeoise, elle se révèle aussi légère, sinon plus, que Boule de Suif.
Le couple Carré-Lamandon participera également activement à la stratégie visant à forcer Boule de Suif.
Le comte et la comtesse de Bréville
Avec le comte et la comtesse de Bréville, Maupassant introduit le plus haut niveau social de l'époque, celui de l’aristocratie. Mais, sans surprise, ces nobles de sang sont aussi hypocrites et lâches que les bourgeois.
M. de Bréville n’a pas ni courage ni honneur, puisqu'on nous le présente comme un « diplomate », il est issu de « trois générations d’ambassadeurs ». Ce trait, qui n’est pas négatif en soi, équivaut pourtant chez le comte à une attitude lâche et soumise. Loin d’approuver le courage de Boule de Suif, il encourage celle-ci à céder au prussien car, dit-il, « il ne faut jamais résister au plus forts ».
Cette lâcheté érigée en philosophie est d’autant plus méprisable que le comte se vante d’être un descendant de Henri IV, à qui il s’efforce même de ressembler physiquement. Mais la seule marque de supériorité qu'il possède réside dans le contrôle qu’il a de lui-même.
C’est lui qui s’impose naturellement à la tête de la « conspiration » destinée à faire fléchir Boule de Suif. Il possède également l’art de la réthorique, que ce soit pour parler à l’officier prussien ou à ses compagnons ou à Boule de Suif. C'est dire qu'il n’est qu’un homme de discours. Chez lui, comme dans ses mots, la noblesse n’est que forme et apparence.
La comtesse excelle aussi dans l’art de paraître. Elle a un « grand air », comme le précise Maupassant, ce qui lui a permis d’être acceptée par l’aristocratie normande, malgré son statut de non-noble de naissance. Vis-à-vis de Boule de Suif, elle sait aussi se montrer aimable, mais cette attitude trahit avant tout de la condescendance et un énorme complexe de supériorité.
Comme le comte, elle a le sens de l’initiative, et c’est elle qui aura l’idée d’utiliser des arguments religieux pour faire céder Boule de Suif. Très rusée, elle amène ainsi la nonne à dire que Dieu serait tout à fait disposé, au vu des circonstances, à pardonner à Boule de Suif son « péché ».
Enfin, cette grande dame finit par s’amuser « comme une folle » des plaisanteries obscènes de Loiseau, lors du dîner final.
Les deux religieuses
À travers les deux religieuses, Maupassant fait une caricature de la dévotion hypocrite à la religion. Pour Maupassant, la religion est une idéologie qui vient justifier la domination des classes supérieures, représentées par les trois couples déjà évoqués. C’est la « bonne » société qui a « de la Religion et des Principes ».
La plus âgée des religieuses est présentée comme très masculine, alors que la plus jeune, sa « chère sœur Saint-Nicéphore » est « mignonne » et fragile, d’un aspect maladif. Elles forment donc presque un couple.
Lorsqu’elles récitent leur prière, elles ressemblent à des automates et semblent déshumanisées. Elles ont des réflexes d’esclaves quand le prussien fait descendre les voyageurs de la diligence, elles descendent en première, en « saintes filles habituée à toutes les soumissions ». La plus âgées des deux est très masculine car elle a passé sa vie dans l’armée à soigner les blessés sur le champ de bataille. C’est « une vraie bonne sœur Ran-tan-plan » (p.36), avec une âme de soldat.
C’est elle qui achève de vaincre la résistance de Boule de Suif en affirmant qu’un péché est vite pardonné s’il est accompli pour des motifs louables. Sa philosophie morale est donc très habile : c'est une casuistique typique et très pratique.
L’officier prussien
L’officier est un symbole de la « goujaterie naturelle du militaire victorieux » (p.29). Toute son attitude représente la tyrannie arbitraire. Il ne prend même pas la peine d’expliquer son refus :
che ne feux pas… foilà tout.
Maupassant fait de lui une caricature impitoyable à travers différents traits de personnalité :
- il imite son accent allemand
- il est ridiculement guindé
- il est serré dans son uniforme « comme une fille dans son corset »
- sa moustache est « démesurée » comme son arrogance
Les pistes d'analyse de Boule de Suif de Maupassant

L’argent
L’argent joue un rôle capital dans cette nouvelle, en tant qu'il s'agit d'une satire des classes supérieures de la société. Quoique très différents par leur éducation et leurs opinions politiques, Loiseau, Carré-Lamandon et Bréville sont unis par la valeur « argent ».
Cet argent les rend donc frères, alors que ces trois homme unis par « un instinct conservateur » constituent une alliance anormale ; pendant la Révolution, soit quatre-vingt ans plus tôt, ils auraient plutôt été ennemis, le comte représentant l’aristocratie de sang et les deux autres la bourgeoisie commerçante.
Maupassant prouve ainsi que les idées et les valeurs de chaque classe passent après la fortune, qui constitue le seul véritable critère distinctif entre les individus. Ils appartiennent tous les trois à « la grande franc-maçonnerie de ceux qui possèdent ».
Cependant, Maupassant nous présente des attitudes différentes par rapport à l’argent :
- Cornudet est le plus généreux, il a dépensé son argent pour ses amis républicains.
- Mme Loiseau est d’une extrême avarice, et ne supporte même pas que l’on plaisante de l’argent
- Mr Loiseau est plus généreux car c’est lui qui offre le champagne lorsque les voyageurs célèbrent la capitulation de Boule de Suif
- M. Carré-Lamandon donne l’image d’un gestionnaire prudent comme il convient de l'être pour un homme d’affaire respectable : il a constitué un capital au cas où la guerre l’oblige à se réfugier en Angleterre
En somme, Maupassant présente la bourgeoisie normande comme très lâche et très avare. « Emasculés par le commerce », les Rouennais n’osent refuser de payer le tribut de guerre qu’exigent les prussiens, mais plus ils sont riches, plus ils souffrent de voir leur argent passer entre les mains des vainqueurs.
La nourriture
La nourriture et les repas sont importants dans Boule de Suif pour deux raisons :
- ils font le lien social
- ils permettent de symboliser Boule de Suif
La nourriture comme un lien social
Ce sont avant tout les repas qui permettent aux voyageurs de communiquer. Dès le premier voyage en diligence, c’est la faim qui pousse les voyageurs à parler entre eux. Plus tard, quand Boule de Suif partage ses provisions, ils se sentent obliger de lui parler, malgré le mépris qu’ils éprouvent pour elle. On notera également le temps que l'auteur prend pour décrire chacun des mets emportés par la prostituée.
En outre, Maupassant insiste beaucoup sur ce premier repas en diligence afin de préparer le contraste avec le repas final durant lequel les voyageurs très ingrats dégusteront leurs repas froids, sans en proposer à la malheureuse Boule de Suif.
Enfin, à l’auberge, c’est au cours des repas que les voyageurs fomentent pour pousser Boule de Suif à céder au caprice du Prussien. Les repas en commun forment un rendez-vous parfait pour leur entreprise : ils parlent autour de la table sans s’adresser à Boule de Suif en particulier. Cette technique est très efficace car elle permet d’influencer la courtisane sans pour autant la confronter directement.
Boule de Suif comparée à de la nourriture
Symboliquement, Boule de Suif est de la nourriture car elle est comparée à un objet à consommer quand ils la livrent « en pâture » à l’officier. Surtout, le narrateur la décrit à l'aide d'un vocabulaire culinaire :
- elle est « grasse à lard » et « appétissante »
- ses doigts sont pareils à « de courtes saucisses »
- sa figure ressemble à « une pomme rouge »
La métaphore de Boule de Suif qui la compare à de la nourriture est confirmée par l’une des plaisanteries de Loiseau, qui, affamé, proposera de « manger le plus gras des voyageurs ».
Ces comparaisons enlèvent toute dignité à cette victime.
La guerre
Maupassant consacre les premières pages de son récit à une description très réaliste de la guerre et plus particulièrement de la défaite française.
Surtout, au niveau métaphorique, toute la « conspiration » des voyageurs pour amener Boule de Suif à céder au désir du prussien est comparée à un combat militaire.
Chacun convint du rôle qu’il jouerait, des arguments dont il s’appuierait, des manœuvres qu’il devrait exécuter. On régla le plan des attaques, les ruses à employer, et les surprises de l’assaut pour forcer cette citadelle vivante à recevoir l’ennemi dans la place.
Cette métaphore file jusqu'à la capitulation de cette « citadelle vivante » qu’est Boule de Suif. Aussi les arguments de la religieuse font-ils « brèche » dans sa résistance. C'est dire que cette résistance fut comparée aux remparts d’une forteresse qui s’effondre sous les coups de l’ennemi.
Notons l'ironie de cette métaphore guerrière : les compagnons de voyages sont plutôt des lâches qui s’abaissent devant l’ennemi et qui deviennent des grands stratèges lorsqu'il s’agit de combattre Boule de Suif, malheureuse isolée.
Enfin, le « viol » de Boule de Suif est un symbole du « viol » de la France par les Prussiens. L'absence de consentement de la prostituée, qui agit sous le coup de la pression, rend tout à fait licite l'utilisation de ce terme. La fin du récit laisse bien voir Boule de Suif comme une femme violée : elle est « troublée, honteuse », se sentant « souillée par les baisers de ce Prussien ».
Le réalisme
Boule de Suif est caractérisée par son réalisme :
- Le récit a pour cadre un événement de l’Histoire (la guerre de 1870).
- Les villes sont décrites fidèlement.
- Les événements s’y déroulent dans un ordre logique.
- Les actions de chaque personnage y sont justifiés par des mobiles précis et intelligibles. Nous savons par exemple pourquoi les voyageurs ont quitté Rouen.
- Il y a de nombreuses descriptions, toutes très détaillées.
- Les individus sont définis par rapport à leur milieu social, leur profession et leur place dans la société.
- Chaque personnage représente un échantillon d’un type social.
Ajoutons encore que, fidèle à lui-même, Maupassant donne à voir une vision très pessimiste de la société. Il dénonce ici la bassesse des « bonnes » classes sociales, plutôt égoïstes, lâches, hypocrites, privées d'honneur et de sens patriotique. La crise qu’ils viennent de subir n’a pas changé leur caractère.
Quant à Boule de Suif, elle reste exclue et méprisée malgré son sacrifice moral et physique. Cela vient affirmer que le niveau social ne fait pas la hauteur morale. Aussi Boule de Suif apparaît-elle bien plus respectable que la société dite « honnête ».
Et cela aussi, n'est-ce pas réaliste ?
Résumer avec l'IA :














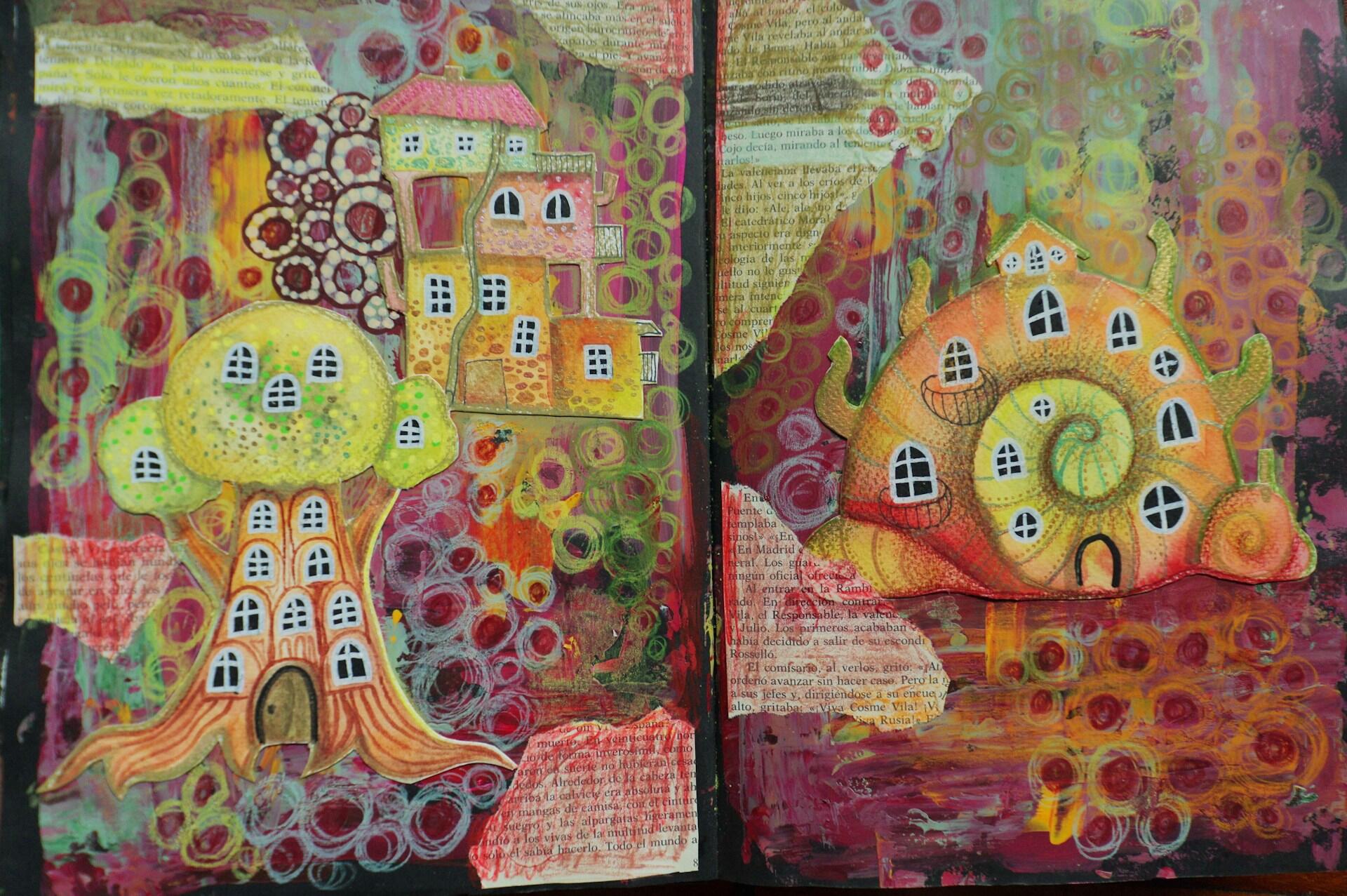








Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !
Merci beaucoup ça ma beaucoup aidé pour mon devoir!
vraiment trop bien le résumer j’avais pas trop compris quand j’ai lu le livre mais maintenant que j’ai lu le livre j’ai très bien compris
Super moment pour rester avec ses compagnons
merci beaucoup cela ma vraiment aidé
Wow incroyable franchement j’ai tout compris sans lire le livre merci beaucoup
Très bons commentaires
Formidable analyse de l’œuvre de Guy de Maupassant l’analyse psychologique de chacun des personnages de la nouvelle est remarquablement ciselé , Cette œuvre reste d’une troublante et cruelle actualité Yvon
Analyse pleine de finesse. J’aime beaucoup.