Chapitres

L’extrait commenté
ACTE I
Scène 1
Madame Pernelle, Elmire, Cléante, Damis, Dorine, Flipote.Madame PernelleAllons, Flipote, allons ; que d’eux je me délivre.
ElmireVous marchez d’un tel pas, qu’on a peine à vous suivre.
Madame PernelleLaissez, ma bru, laissez ; ne venez pas plus loin ;
Ce sont toutes façons dont je n’ai pas besoin.ElmireDe ce que l’on vous doit envers vous on s’acquitte.
Mais, ma mère, d’où vient que vous sortez si vite ?Madame PernelleC’est que je ne puis voir tout ce ménage-ci,
Et que de me complaire on ne prend nul souci.
Oui, je sors de chez vous fort mal édifiée :
Dans toutes mes leçons j’y suis contrariée ;
On n’y respecte rien, chacun y parle haut,
Et c’est tout justement la cour du roi Pétaud.DorineSi…
Madame PernelleVous êtes, ma mie, une fille suivante,
Un peu trop forte en gueule, et fort impertinente ;
Vous vous mêlez sur tout de dire votre avis.DamisMais…
Madame PernelleVous êtes un sot en trois lettres, mon fils ;
C’est moi qui vous le dis, qui suis votre grand’mère ;
Et j’ai prédit cent fois à mon fils, votre père,
Que vous preniez tout l’air d’un méchant garnement,
Et ne lui donneriez jamais que du tourment.MarianeJe crois…
Madame PernelleMon Dieu ! sa sœur, vous faites la discrète,
Et vous n’y touchez pas, tant vous semblez doucette ;
Mais il n’est, comme on dit, pire eau que l’eau qui dort,
Et vous menez sous chape un train que je hais fort.ElmireMais, ma mère…
Madame PernelleMa bru, qu’il ne vous en déplaise,
Votre conduite, en tout, est tout à fait mauvaise ;
Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux ;
Et leur défunte mère en usait beaucoup mieux.
Vous êtes dépensière ; et cet état me blesse,
Que vous alliez vêtue ainsi qu’une princesse.
Quiconque à son mari veut plaire seulement,
Ma bru, n’a pas besoin de tant d’ajustement.CléanteMais, madame, après tout…
Madame PernellePour vous, monsieur son frère,
Je vous estime fort, vous aime, et vous révère ;
Mais enfin si j’étais de mon fils son époux,
Je vous prierais bien fort de n’entrer point chez nous.
Sans cesse vous prêchez des maximes de vivre
Qui par d’honnêtes gens ne se doivent point suivre.
Je vous parle un peu franc ; mais c’est là mon humeur,
Et je ne mâche point ce que j’ai sur le cœur.DamisVotre Monsieur Tartuffe est bien heureux, sans doute…
Madame PernelleC’est un homme de bien qu’il faut que l’on écoute ;
Et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux,
De le voir querellé par un fou comme vous.DamisQuoi ! je souffrirai, moi, qu’un cagot de critique
Vienne usurper céans un pouvoir tyrannique ;
Et que nous ne puissions à rien nous divertir,
Si ce beau monsieur-là n’y daigne consentir ?DorineS’il le faut écouter, et croire à ses maximes,
On ne peut faire rien, qu’on ne fasse des crimes ;
Car il contrôle tout, ce critique zélé.Madame PernelleEt tout ce qu’il contrôle est fort bien contrôlé.
C’est au chemin du ciel qu’il prétend vous conduire :
Et mon fils à l’aimer vous devrait tous induire.DamisNon, voyez-vous, ma mère, il n’est père ni rien,
Qui me puisse obliger à lui vouloir du bien :
Je trahirais mon cœur de parler d’autre sorte.
Sur ses façons de faire à tous coups je m’emporte :
J’en prévois une suite, et qu’avec ce pied-plat
Il faudra que j’en vienne à quelque grand éclat.DorineCertes, c’est une chose aussi qui scandalise
De voir qu’un inconnu céans s’impatronise ;
Qu’un gueux, qui, quand il vint, n’avait pas de souliers,
Et dont l’habit entier valait bien six deniers,
En vienne jusque-là que de se méconnaître,
De contrarier tout, et de faire le maître.Madame PernelleEh ! merci de ma vie, il en irait bien mieux
Si tout se gouvernait par ses ordres pieux.DorineIl passe pour un saint dans votre fantaisie :
Tout son fait, croyez-moi, n’est rien qu’hypocrisie.Tartuffe ou l’Imposteur, Molière, 1664

Méthode du commentaire composé
On rappellera ici la méthode du commentaire composé vu en cours francais :
| Partie du commentaire | Visée | Informations indispensables | Écueils à éviter |
|---|---|---|---|
| Introduction | - Présenter et situer le texte dans le roman - Présenter le projet de lecture (= annonce de la problématique) - Présenter le plan (généralement, deux axes) | - Renseignements brefs sur l'auteur - Localisation du passage dans l'œuvre (début ? Milieu ? Fin ?) - Problématique (En quoi… ? Dans quelle mesure… ?) - Les axes de réflexions | - Ne pas problématiser - Utiliser des formules trop lourdes pour la présentation de l'auteur |
| Développement | - Expliquer le texte le plus exhaustivement possible - Argumenter pour justifier ses interprétations (le commentaire composé est un texte argumentatif) | - Etude de la forme (champs lexicaux, figures de styles, etc.) - Etude du fond (ne jamais perdre de vue le fond) - Les transitions entre chaque idée/partie | - Construire le plan sur l'opposition fond/forme : chacune des parties doit impérativement contenir des deux - Suivre le déroulement du texte, raconter l'histoire, paraphraser - Ne pas commenter les citations utilisées |
| Conclusion | - Dresser le bilan - Exprimer clairement ses conclusions - Elargir ses réflexions par une ouverture (lien avec une autre œuvre ? Événement historique ? etc.) | - Les conclusions de l'argumentation | - Répéter simplement ce qui a précédé |
Ici, nous détaillerons par l'italique les différents moments du développement, mais ils ne sont normalement pas à signaler. De même, il ne doit normalement pas figurer de tableaux dans votre commentaire composé. Les listes à puces sont également à éviter, tout spécialement pour l'annonce du plan.
Commentaire de l’extrait
Introduction
Le Tartuffe ou l’Imposteur est une pièce en cinq actes écrite par Molière et représentée pour la première fois en 1664.
Dans cette œuvre théâtrale, le fameux dramaturge prend pour cible ce qu’on appelle les « directeurs de conscience », qui sont, dans la religion catholique, ceux qui guident les personnes selon des principes religieux et moraux. L’auteur se moque de ceux qui, faux croyants, profitent plutôt de leur influence pour obtenir toutes sortes de privilèges.
Cette pièce était si offensive qu’elle fut censurée par le pouvoir royal, influencé par les compagnies religieuses de sa cour. Une nouvelle pièce sera représentée en 1665, dans laquelle Tartuffe, l’imposteur, n’est plus un religieux mais un laïc.
La scène que nous lisons ici est celle qui introduit toute la pièce, puisqu’il s’agit de la scène 1 de l’acte I. On l’appelle la « scène d’exposition ».
On y trouve différents personnages dont on comprend qu’ils sont liés par des liens familiaux, et qu’il y a une querelle entre eux. Cette dispute semble due à la personne de Tartuffe, un homme que Madame Pernelle, l’aïeule, écoute aveuglement.
Annonce de la problématique
Aussi, en quoi cette première scène est-elle représentative de la suite de la pièce ?
Annonce des axes
Nous montrerons d’abord toute l’originalité de cette scène d’exposition. Elle révèle et use en même temps d’un type de comique particulier qu’il convient de mettre en lumière. Enfin, nous verrons la manière dont elle tisse déjà l’intrigue à venir.
Développement
Une exposition originale
Il faut d’abord dire que cette scène d’exposition a quelque chose d’original. Son début in media res ne laisse pas de temps d’acclimatation au spectateur tandis que la présence de six personnages différents provoque une discussion forcément mouvementée.
Débuts in media res
La première réplique, comme la marche des personnages, indique d’emblée au spectateur qu’il débarque au milieu de quelque chose déjà commencé sans lui.
En effet, Madame Pernelle désigne à son domestique les autres personnages en utilisant « eux », sans préciser de qui il s’agit. C’est qu’elle est suivie par toute une foule de gens, qu’elle connaît et qu’elle veut quitter.
Elle veut les quitter car elle s’est irritée de quelque chose, et ce quelque chose, le spectateur l’ignore. Il s’agit typiquement d’un début in media res, c’est-à-dire « au milieu de l’action ».
Cela permet au dramaturge de capter immédiatement l’attention des spectateurs.
Et de manière assez cocasse, cette « entrée en scène » est plutôt une (fausse) sortie, puisque Madame Pernelle quitte ses convives :
ElmireDe ce que l’on vous doit envers vous on s’acquitte.
Mais, ma mère, d’où vient que vous sortez si vite ?
Madame PernelleC’est que je ne puis voir tout ce ménage-ci,
Et que de me complaire on ne prend nul souci.
Oui, je sors de chez vous fort mal édifiée :
Dans toutes mes leçons j’y suis contrariée ;
On n’y respecte rien, chacun y parle haut,
Et c’est tout justement la cour du roi Pétaud.

Une foule de personnages
Une autre caractéristique qui fait l’originalité de cette scène d’exposition, c’est le nombre de ses personnages.
Généralement, une première scène présente un ou deux protagonistes de l’histoire à suivre, ce qui facilite la présentation des choses au spectateur.
Ici, pourtant, il n’y a pas moins de six personnages, comme l’indique le paratexte : « Madame Pernelle, Elmire, Cléante, Damis, Dorine, Flipote ». Mais plus notable encore, ces six personnages constituent l’ensemble des protagonistes de la pièce, à l’exception des deux principaux :
- Orgon, qui est le père de famille manipulé
- Tartuffe, qui est le manipulateur (et qui n’apparaît… qu’au troisième acte !)
Néanmoins, cette interaction à six, pour dynamique qu’elle soit, n’en donne pas moins des informations sur les personnages. Les répliques de Madame Pernelle résume en une phrase son lien avec son interlocuteur, ou le rôle que chacun joue dans le conflit :
- Elmire est sa belle-fille (« Laissez ma bru »)
- Dorinne est une domestique (« vous êtes, ma mie, une fille suivante »)
- Damis est son petit-fils (« c’est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère »)
- Marianne est sa petite-fille, en même temps que la sœur de Damis (« Mon Dieu, sa sœur, vous faites la discrète »)
- Elmire n’est pas la mère de Damis et de Marianne (« Et leur défunte mère en usait beaucoup mieux »)
- Cléante est le frère d’Elmire (« Pour vous, Monsieur son frère »)
Mais surtout, on comprend ce qui a énervé Madame Pernelle :
Et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux
De le voir querellé
Or, ce Tartuffe qu’on critique, il n’est pas là. Son absence crée donc un effet d’attente renforcé encore par l’attention que lui prête toute cette foule de personnages.
Transition
L’interaction des six, en même temps que des indications sur l’intrigue, offre des moments comiques qui révèlent où se concentre l’écriture de Molière.
Le comique de caractère
Au théâtre, le comique de caractère repose sur l’exposition d’un personnage dont les traits de caractère sont si marqués qu’ils finissent par provoquer le rire.
Dans cette pièce, la scène d’exposition semble conférer ce rôle à Madame Pernelle. Son emportement est tel qu’il en devient comique.
Vulgarité et promptitude
Madame Pernelle apparaît très vite comme l’archétype de la vieille femme autoritaire et désagréable.
On remarque ainsi dans ses répliques plusieurs impératifs qui dévoilent sa tendance à l’autorité : « Allons », « Laissez », « Ne venez pas plus loin ».
De même, elle coupe la parole à plusieurs de ses interlocuteurs au cours de la conversation. Cela se remarque d’autant mieux avec la partition en vers : c’est une autre personne qu’elle qui commence le vers qu’elle termine. Un exemple parmi tant d’autres :
DorineSi…
Madame PernelleVous êtes, ma mie, une fille suivante,
Un peu trop forte en gueule, et fort impertinente ;
Vous vous mêlez sur tout de dire votre avis.
L’analyse de son vocabulaire nous donne enfin des indications sur sa classe sociale, ce qui renforce aussi l’archétype qu’elle incarne. On relève en effet les expressions suivantes : « la cour du roi Pétaud », « doucette », « forts en gueule », « je ne mâche pas », … Celles-ci sont caractéristiques de la petite bourgeoisie, plutôt vulgaire. La noblesse, en effet, n’userait pas de termes aussi crus.
Mais malgré ces termes, elle n’hésite pas à se faire garante de la morale, et se ridiculise par une pseudo bien-pensance donneuse de leçons. Par exemple, les reproches qu’elle fait à Elmire :
Ma bru, qu’il ne vous en déplaise,
Votre conduite, en tout, est tout à fait mauvaise ;
Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux ;
Et leur défunte mère en usait beaucoup mieux.
Vous êtes dépensière ; et cet état me blesse,
Que vous alliez vêtue ainsi qu’une princesse.
Quiconque à son mari veut plaire seulement,
Ma bru, n’a pas besoin de tant d’ajustement.
Son attitude devient drôle à partir du moment où, vieille femme offensée par la vulgarité qu’elle trouve chez les autres, elle se montre elle-même vulgaire dans son emportement.
Transition
Mais un autre trait encore renforce son potentiel comique : Madame Pernelle est dévote, et en fait un dogmatisme.
Une femme dogmatique
Une personne dogmatique, c’est une personne qui érige des dogmes, c’est-à-dire des lois, et qui n’autorise pas d’en dériver.

Les répliques de Madame Pernelle vont dans ce sens, puisqu’à chacun des personnages à qui elle s’adresse, elle trouve des reproches à faire qui atteignent sa morale :
- Elmire est dépensière et donne mauvais exemple à ses enfants
- Damis est « sot » en plus d’être un « méchant garnement »
- Marianne aurait des mœurs légères
- Cléante intervient dans les affaires de famille et doit cesser de le faire
- Dorine est ramenée à son statut de domestique
Qui plus est, ces reproches sont toujours adressés sur le mode péremptoire, c’est-à-dire sur un mode qui n’accepte pas la contradiction : « Vous êtes un sot », « Vous êtes dépensière », …
Elle utilise également des présents de vérité générale, qui renforce la dureté de ses mots, et l’impression de son autorité : « Vous vous mêlez », « Vous faites la discrète », …
En somme, son discours accusateur est très négatif, comme le type de formules qu’elle utilise : « Je ne puis voir », « Je hais fort », …
Mais ses vues très dures sur sa propre famille rentrent en contraste avec celles très positives sur ce fameux Tartuffe. Tout à coup, quand elle doit parler de lui, son vocabulaire change : « C’est un homme de bien », « Tout ce qu’il contrôle est contrôlé », …
L’attitude de cette grand-mère acariâtre devenant gâteuse quand il s’agit d’un directeur de conscience prête donc à rire.
Transition
Et cette matière à rire dans le discours de Madame Pernelle est également une manière de présenter aux spectateurs tout l’enjeu de l’intrigue à suivre…
La présentation de l’intrigue
Incidemment, Molière nous présente, avec cette scène de groupe, son intrigue : une opposition de deux clans qui font le portrait de ses deux personnages principaux, pourtant absents.
L’opposition des clans
Toute la scène 1 de l’acte 1 peut se résumer en l’affrontement de deux clans :
- la vieille génération qu’incarne Madame Pernelle et qui se caractérise par ses jugements dogmatiques et sa bien-pensance
- la jeune génération un peu révoltée, incarnée par tous les autres
Cette partition se lit dans l’utilisation de certains mots :
- Madame Pernelle utilise le « je », qui s’oppose à « eux » ou « vous » (par exemple : « que d’eux je me délivre »), ce qui démontre sa position « seule contre tous »
- les autres membres de la famille utilisent les pronoms « on » ou « nous », témoignant ainsi de leur solidarité : « Et que nous ne puissions en rien nous divertir », « On ne peut rien faire qu’on ne fasse des crimes »
Cependant, plus le dialogue avance, plus les répliques de Madame Pernelle deviennent courtes. La vielle femme s’efface devant la solidarité roborative de ses enfants, ce qui laisse présager de la fin de la pièce…
Tartuffe et Orgon
Ce dialogue nous informe également d’emblée que le personnage nommé Tartuffe est sujet à problèmes.

Du côté de Madame Pernelle, il s’agit d’un homme pieux à la parole sage et éclairé. Il serait presque comparé au Messie dans ses mots :
C’est au chemin du ciel qu’il prétend vous conduire.
Mais du côté de tous les autres, il s’agit d’un imposteur plutôt dangereux. Il est à la fois :
- un parasite intéressé par l’argent : « Qu’un gueux qui, quand il vint n’avait pas de souliers »
- un tyran : « Car il contrôle tout, ce critique zélé »
- un faux dévot : « cagot de critique »
- un hypocrite manipulateur : « tout son fait croyez-moi n’est rien qu’hypocrisie »
Cet affrontement de vues si différentes au sujet d’un seul et même homme crée donc nécessairement un effet d’attente chez les spectateurs.
Quant à l’absence d’Orgon, le père de famille, elle est significative : s’il n’est pas là, c’est qu’il ne remplit plus son rôle. De fait, Tartuffe semble s’être arrogé ses prérogatives, comme le sous-entendent ses enfants : « usurper céans un pouvoir tyrannique », « s’impatronise », « fait le maître », etc.
L’intrigue semble donc se tisser sur cette problématique d’un usurpateur faux-dévot, ayant usurpé tout le pouvoir familial au détriment d’un père crédule, et pour son propre compte.
Conclusion
La scène d’exposition de Tartuffe de Molière est une entrée en matière originale. Par le débarquement sur scène de six personnages, le dramaturge joue avec les codes, mais n’en présente pas moins sa pièce.
Il met d’emblée en avant le potentiel comique de Madame Pernelle et l’utilise pour annoncer les forces d’influence mystérieuse dont jouit celui qui brille par son absence, le fameux Tartuffe.
L’enjeu de la pièce sera donc l’affrontement entre les dupes et les non-dupes, lesquels devront notamment œuvrer pour libérer le père de famille de l’emprise du manipulateur hypocrite.














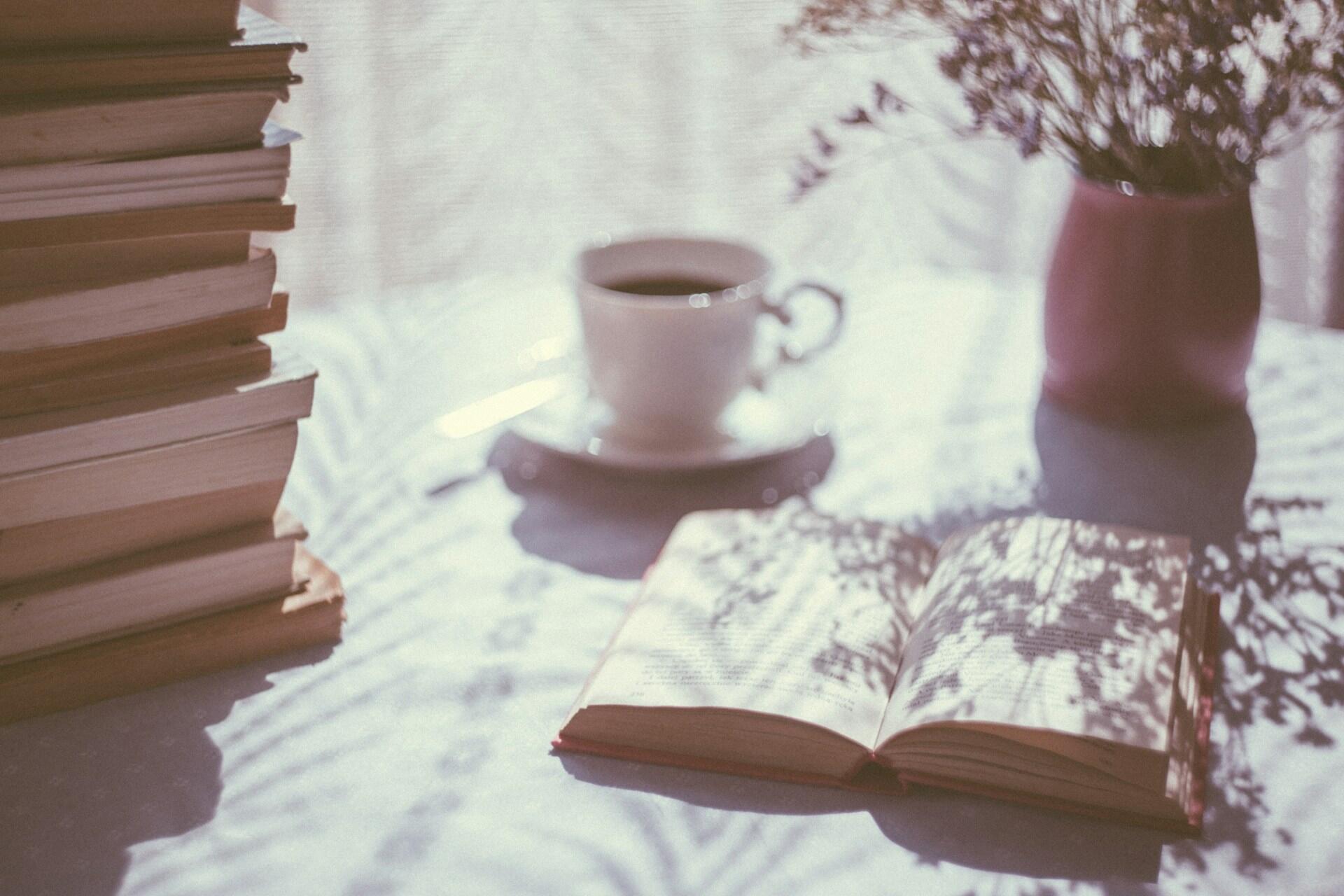



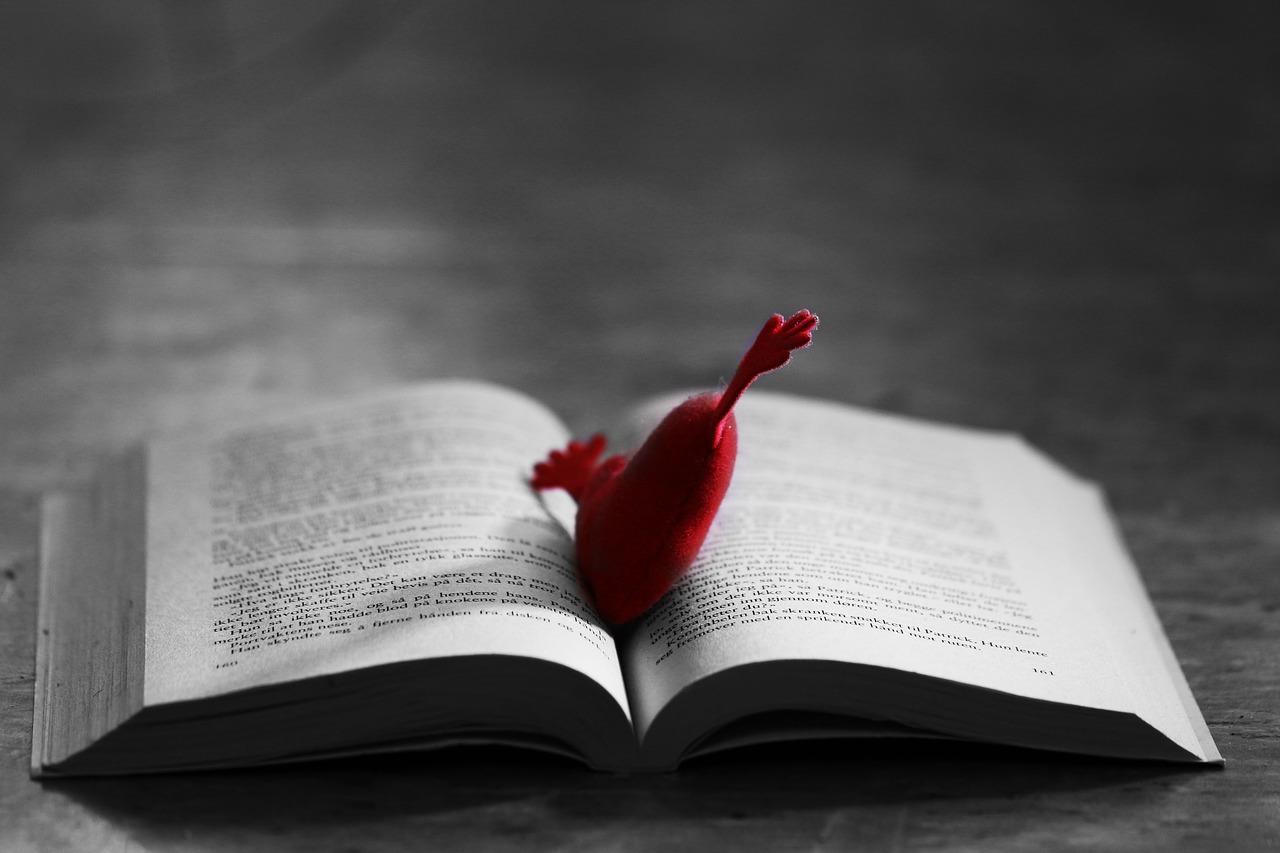




Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !
Bonjour, je souhaiterai connaître la morale qu’il faut retenir de cette pièce s’il vous paît
ok
bonjour , je voudrais un exemple d’analyse pour la scène 4 de l’acte 3 de Tartuffe .
Bonjour,
Il faut retenir que l’hypocrisie n’est pas une certue, mais aussi qu’il faut mesurer ses propos lorsque son discours ne correspond pas aux actes.
Bonne journée !