Chapitres
Le langage théâtral tient compte à la fois du texte de la pièce et de sa représentation sur scène.

1 - Le langage dramatique
Le dialogue. Il est au cœur même de l’action théâtrale et manifeste la présence d’au moins deux personnes sur scène. Il prend différentes formes :
• La réplique : elle constitue la réponse d’un personnage à l’autre.
• La repartie : c’est une réplique brève qui répond à une attaque.
• La tirade : c’est une réplique généralement longue qui argumente sur un sujet dans le registre lyrique ou épique.
• La stichomythie : c’est un dialogue où les personnages se répondent vers par vers et qui donne un style vif à l’échange.
Le monologue. Il manifeste la présence d’un personnage seul sur scène, qui se parle à lui-même, ou éventuellement à quelqu’un d’absent, pour exprimer son trouble ou un dilemme. Il permet également au spectateur de connaître les pensées du personnage.
Les stances. Elles sont différentes du monologue par leur aspect poétique et traduisent l’émotion du personnage.
L’aparté. Ce sont des propos brefs prononcés par un personnage soit pour lui-même, soit à l’adresse du public, à l’insu des autres personnages. C’est un procédé fortement utilisé dans la comédie qui permet de suivre le double jeu des personnages.
Les didascalies. Ce sont toutes les indications scéniques, souvent mises en italique, qui vont permettre de fournir des informations au metteur en scène ou au lecteur. On distingue :
• Les didascalies initiales : elles donnent le titre de la pièce, les listes des personnages, les indications de lieu, le décor...
• Les didascalies internes : elles accompagnent le dialogue.
2 - L’action dramatique
Le théâtre français est resté très longtemps codifié. Les règles ont été élaborées tout au long du XVIIe siècle :
• La règle des trois unités : l’unité de temps (l’action ne doit pas dépasser 24 heures), l’unité de lieu (il faut un décor de palais pour une tragédie, un intérieur bourgeois pour la comédie) et l’unité d’ action (il faut tenir l’intrigue à une action principale).
• La vraisemblance et la bienséance. La vraisemblance vise à montrer sur scène ce que le public peut croire. La bienséance interdit de faire couler le sang sur scène. On doit mourir en coulisses. Le Cid (1636) de Corneille choqua en mettant en scène la confrontation de Rodrigue et de Chimène après l’assassinat du père de celle-ci.
• Le découpage d’une pièce de théâtre : les actes sont en général au nombre de cinq, mais on en trouve parfois trois dans les comédies.
Les scènes structurent l’acte et sont marquées par l’entrée ou la sortie d’un ou des personnages.
La structure interne
• L’exposition. Elle ne doit pas excéder le premier acte. Le spectateur est informé de la situation initiale par des renseignements sur le lieu, le temps, les personnages et l’action.
• Le nœud dramatique. Il met en place la série de conflits et d’obstacles qui empêchent la progression de l’action. Celle-ci peut donc être ponctuée de péripéties (renversement de situation, suite à l’intervention d’éléments extérieurs), de coups de théâtre (renversement brutal), de quiproquos (qui retardent l’action) et de rebondissements (propres à compliquer l’intrigue).
• Le dénouement. Il doit être complet et rapide, de manière à résoudre entièrement les conflits présents dans l’intrigue. Le Deus ex machina est un dénouement qui fait intervenir une action divine.
3 - La scène théâtrale
Un espace de jeu
• La scène à l’italienne : elle trouve son origine à la Renaissance et est prédominante entre le XVIIe et le début du XXe siècle. Le public bénéficie d’une salle composée d’un orchestre, d’un parterre, de galeries et de loges et disposée en demi-cercle, de telle manière qu’elle est séparée de la scène par un rideau qui rappelle les conventions de "l’illusion théâtrale". Les chandelles qui justifient le découpage en actes précèdent les rampes à gaz.
• Les scènes modernes : le XXe siècle invente des nouveaux lieux qui permettent d’atténuer la séparation comédiens/public. Ainsi, en 1970, Ariane Mnouchkine installe son théâtre à la Cartoucherie, située dans le bois de Vincennes et qui est composée de trois hangars.
La scène symbolique. Les décors, les costumes et les maquillages contribuent au symbolisme de la scène en soulignant les choix du metteur en scène. C’est ainsi qu’Alfredo Arias choisit de faire porter aux acteurs des masques de singe lors de sa mise en scène du Jeu de l’ amour et du hasard de Marivaux.
Résumer avec l'IA :














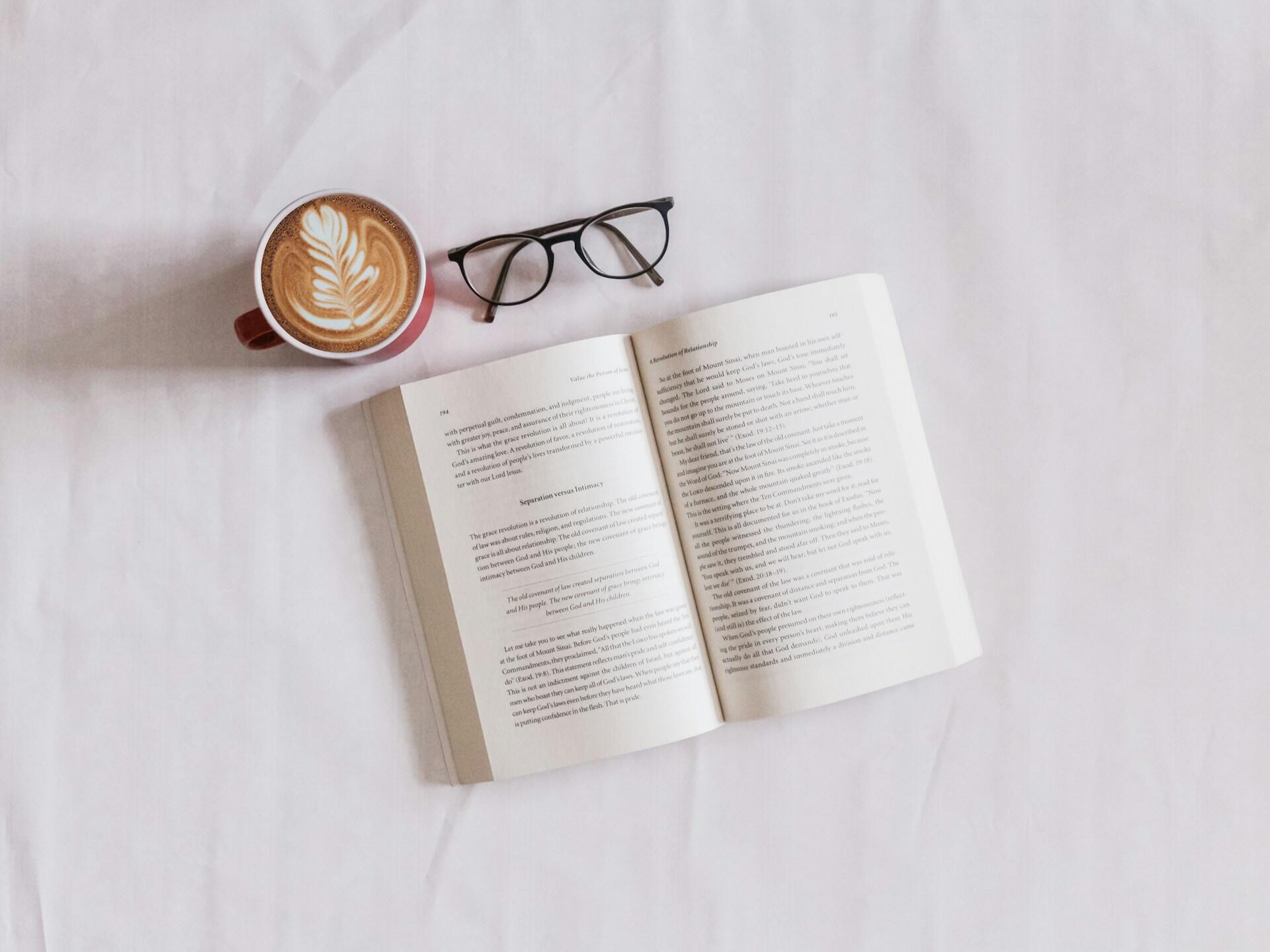


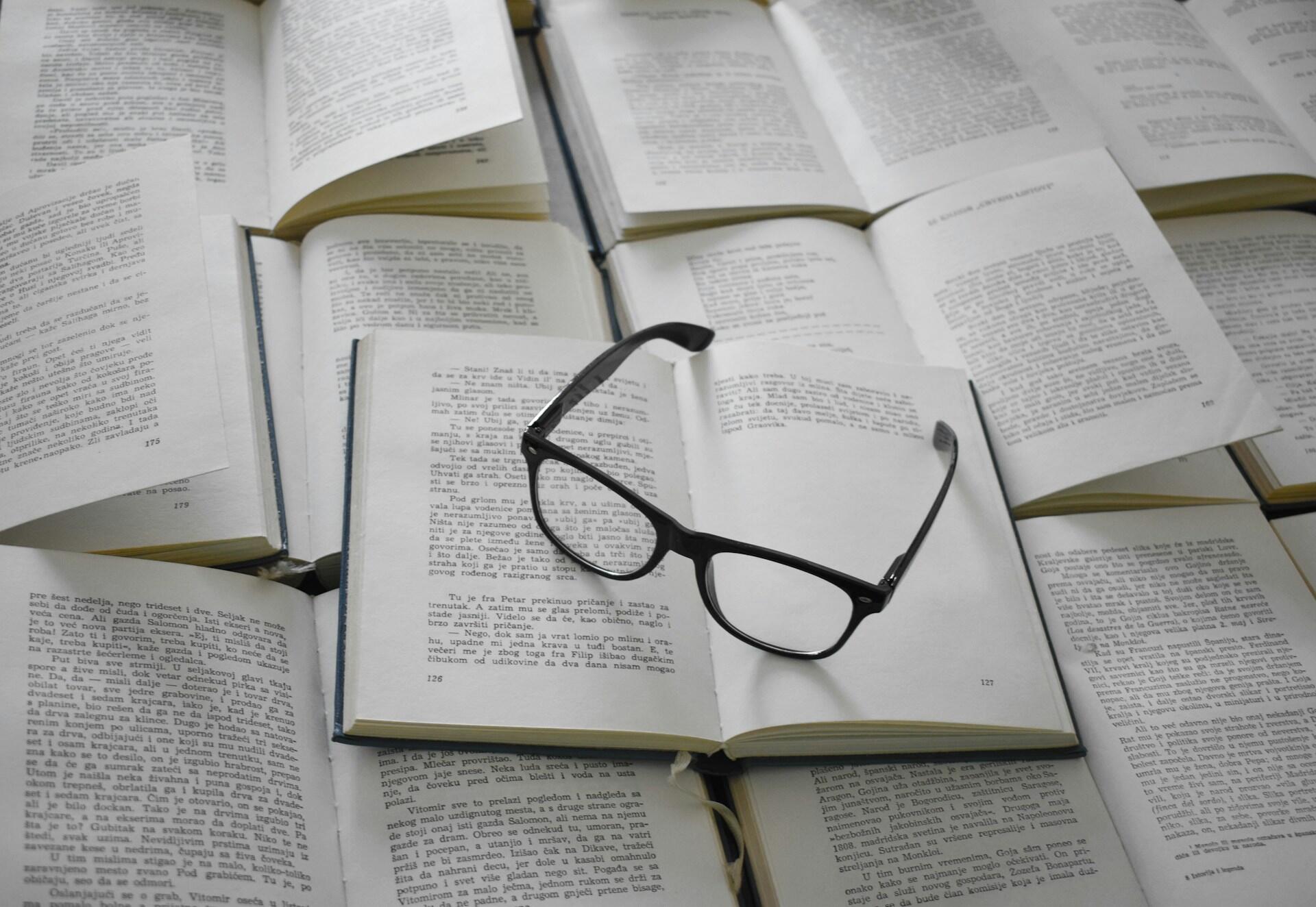
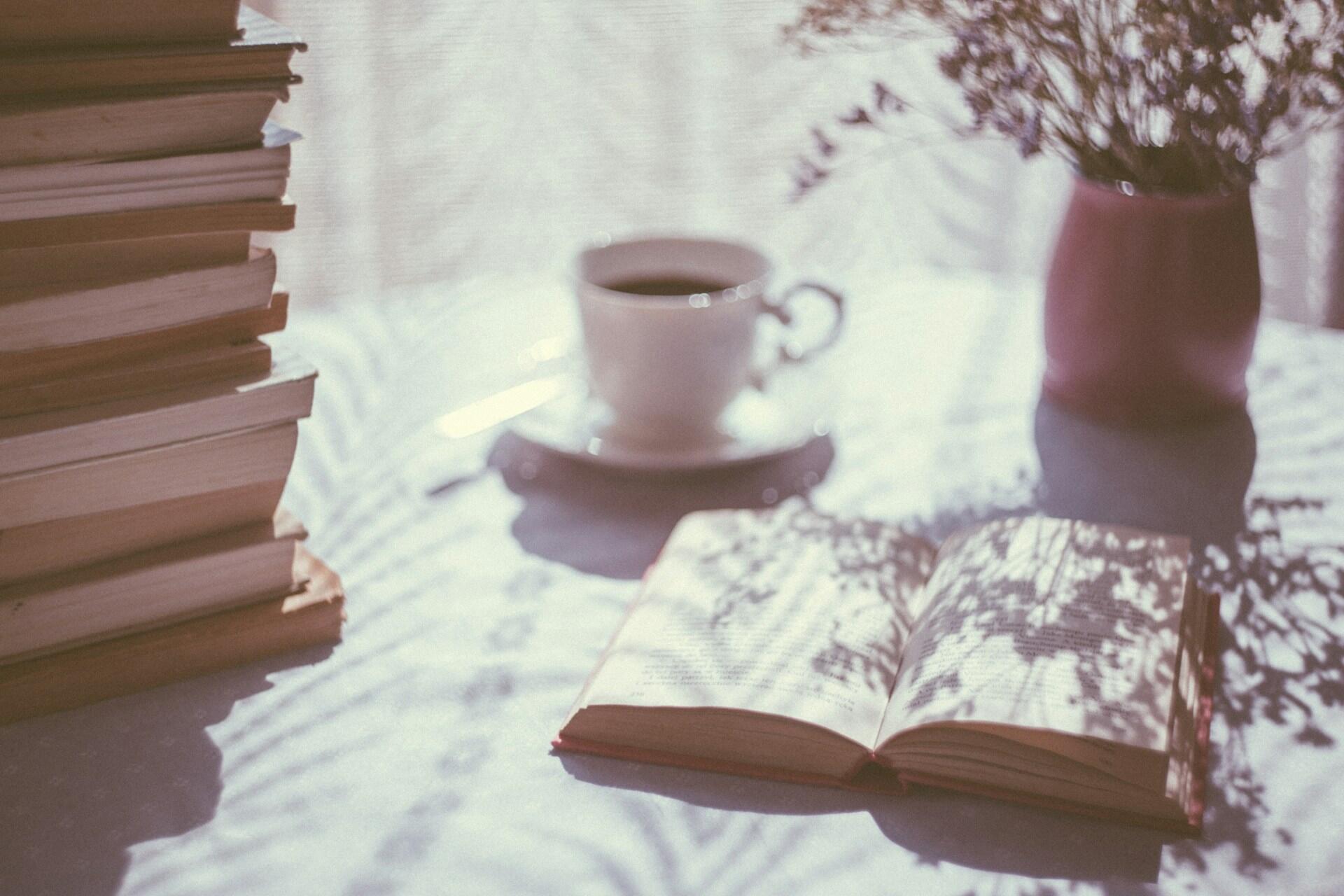



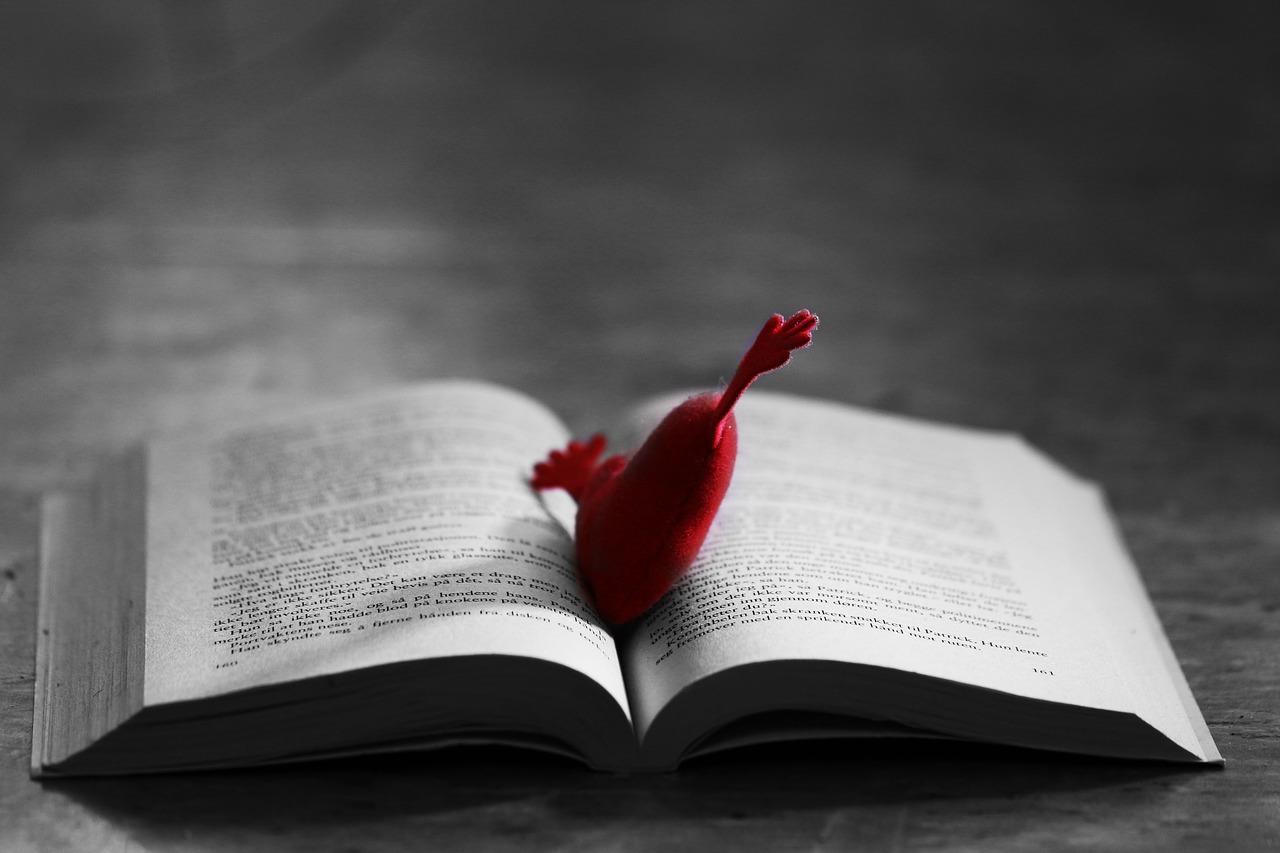
Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !