Chapitres
- 01. Une pièce ancrée dans la mythologie
- 02. Résumé de la pièce
- 03. Les personnages d'Antigone
- 04. Thèmes-clés : fratrie, désobéissance et justice
- 05. La réécriture d'une pièce antique
- 06. Les facettes du personnage d'Antigone : faible et forte à la fois
- 07. Le quotidien de la modernité
- 08. Réception de l'œuvre
- 09. Origine et réécritures
📚 Fiche du livre
Antigone, pièce écrite par Jean Anouilh en 1944, est une réinterprétation moderne de la tragédie antique de Sophocle, mais elle est ancrée dans les dilemmes éthiques et moraux qui résonnent encore aujourd'hui.
En pleine Seconde Guerre mondiale, la pièce d'Anouilh a servi de miroir aux tensions politiques et sociales de l'époque. Elle offre une plateforme pour débattre des questions de résistance, de collaboration et de choix moraux dans des temps troublés. Ce contexte ajoute une couche de complexité à l'œuvre, la rendant non seulement pertinente pour son époque mais aussi pour les générations futures.

Une pièce ancrée dans la mythologie
Dans la mythologie grecque, Antigone est liée à plusieurs personnages :
- Antigone est la fille d'Œdipe, roi de Thèbes. Son mythe s’inscrit donc dans la continuité de celui de son père, pour le moins tragique. En effet rappelons qu’Œdipe avait – sans le savoir – épousé sa mère (avec qui il eut quatre enfants, dont Antigone), et tué son père.
- C’est aussi la fille de Jocaste, qui est donc à la fois sa mère et sa grand-mère. Elle finira par se suicider.
- Elle est la sœur d'Etéocle, de Polynice et d'Ismène, les autres enfants d’Œdipe et de Jocaste. Seule Ismène survivra à la guerre des sept chefs, puis à la rébellion d’Antigone.
Résumé de la pièce

Un prologue autour d'une dispute pour le trône
À la mort de leurs parents ce sont les deux fils, Étéocle et Polynice, qui prennent le gouvernement de la ville de Thèbes. Afin de ne pas créer de jalousie, ils prennent la décision d’être roi tour à tour, une année sur deux.
La première année, c’est Etéocle qui prend les rênes de la ville. Le problème est que son règne se déroule si bien qu’il refuse de céder sa place comme convenu à Polynice lorsque le changement de tour advient.
Furieux, Polynice se réfugie à Argos et épouse la fille du Roi Adraste mais n’oublie pas Thèbes pour autant. Pour retrouver son trône, Polynice déclenche alors la guerre contre Thèbes avec l’aide du roi Adraste. Durant cette guerre, Polynice et Etéocle s'entretuent. La ville de Thèbes a gagné mais n’a plus de roi.
Cette guerre est appelée Guerre des
chefs.
C’est alors Créon, frère de Jocaste et donc oncle d’Antigonec qui prend le pouvoir. Sa première décision est de rendre honneur à Étéocle en lui accordant d'importantes funérailles. Il est même déclaré héros de la ville de Thèbes. En revanche, Polynice est mis du côté des traîtres : sa dépouille devra être laissée comme proie aux corbeaux et aux chacals, sans enterrement possible. Qui osera s'opposer à la décision de Créon sera puni(e) de mort. Sauf qu’Antigone ne supporte pas cette décision.
Pour les Grecs, ne pas avoir de funérailles signifie que son âme va errer toute l'éternité sans pouvoir aller dans le monde des morts et des ancêtres.
L'exposition : Antigone au coeur des embrouilles
L'acte d'ouverture présente le contexte de la pièce. Antigone, fille d'Œdipe et de Jocaste, apprend que ses deux frères, Étéocle et Polynice, se sont entretués lors d'une guerre pour le trône de Thèbes. Le nouveau roi, Créon, décrète que seule la sépulture d'Étéocle sera honorée, tandis que le corps de Polynice restera sans sépulture. Antigone, indignée par cette décision, décide de braver l'interdiction de Créon et d'enterrer son frère.
Antigone avoue alors à sa sœur Ismène ce qu'elle a l'intention de faire : enterrer en secret la dépouille de son frère Polynice. Ismène approuve mais a trop peur de désobéir donc elle n’accompagne pas sa sœur dans son projet. Elle lui dit même :
Je cède à la force, je n'ai rien à gagner à me rebeller.
Polynice, dans Antigone
Antigone est arrêtée par les gardes alors qu'elle tente de donner une sépulture à Polynice. Elle est conduite devant Créon, qui lui reproche d'avoir enfreint la loi. Antigone défend son acte en invoquant les lois divines et la piété envers sa famille. Ismène, sa sœur, tente de se joindre à elle, mais Antigone refuse sa complicité.
Le noeud de la pièce, ordre VS morale
Hémon, le fils de Créon et fiancé d'Antigone, intervient pour plaider en faveur d'Antigone. Il tente de convaincre son père de montrer de la clémence et d'écouter le peuple, qui soutient Antigone. Créon reste inflexible et refuse de céder à la pression. Tiresias, le prophète aveugle, rencontre Créon et lui prédit des malheurs s'il persiste dans sa décision. Tiresias met en garde Créon contre la colère des dieux et l'impopularité de sa décision.
⏰ Finalement, ébranlé par les paroles du prophète, Créon décide de libérer Antigone et de donner une sépulture à Polynice. Malgré ce ravissement, il est déjà trop tard...
Antigone est déterminée : une fois libérée, elle tente une seconde fois de recouvrir de terre le corps de Polynice. Elle est de nouveau arrêtée.
Elle préfère désobéir aux lois des hommes quand celles-ci sont injustes, que désobéir aux lois des dieux.
Elle est alors arrêtée, jugée et enfermée vivante dans le tombeau des Labdacides, destinée à mourir de faim et de soif.

Un dénouement malheureux, une vraie tragédie
Le chœur annonce l'arrivée de la tragédie imminente. Créon arrive trop tard pour empêcher la tragédie de se dérouler : Antigone s'est pendue dans sa cellule, Hémon s'est poignardé en la voyant morte, et Eurydice, la femme de Créon, se suicide par désespoir. Créon est plus seul que jamais.
⚡️ Créon, accablé par la culpabilité et la perte de sa famille, réalise l'ampleur de ses erreurs et accepte sa responsabilité. Il réalise les conséquences dévastatrices de son entêtement et regrette ses actions qui ont conduit à tant de souffrance et de destruction.
Moi, je peux dire ‘non’ encore à tout ce que je n’aime pas et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit ‘oui’
Antigone (à Créon), dans la version de Jean Anouilh
Les personnages d'Antigone
Dans la pièce, les
principaux personnages et leur rôle sont :
- Antigone, qui défie l'édit de Créon en enterrant son frère Polynice. Elle incarne la loyauté envers sa famille et les lois divines, défiant les lois des hommes et acceptant le sacrifice ultime pour ses convictions.
- Créon, qui représente l'autorité et l'ordre, mais sa rigidité et son entêtement le conduisent à des décisions tragiques et à la perte de sa famille.
- Ismène, qui est la soeur d'Antigone, est craintive et soumise. Elle refuse de participer à la désobéissance et plaide pour le respect des lois humaines. Elle représente la prudence et l'opposition à l'acte de défiance d'Antigone.
- Hémon, fils de Créon et fiancé d'Antigone, est tiraillé entre son amour pour Antigone et son devoir envers son père. Sa mort tragique reflète les conséquences dévastatrices des conflits familiaux et de l'entêtement.
Créon
Il incarne l'ordre politique. Il est la représentation de la loi. Il rappelle la suprématie de la loi, la présente comme à respecter. Pour lui, la loi permet à tous les individus de vivre dans l'unité. La position de Créon est à comprendre à partir de la conception grecque de la cité. La cité est conçue comme un tout organique.

Aristote compare la cité au corps. Le corps est vivant, il n'est pas l'addition de plusieurs organes, il constitue un tout. Chacun dans la cité doit pouvoir s'accorder autour de sa différence. S'insurger contre la loi, c'est porter à l'intégrité du tout, c'est donc détruire le tout, c'est détruire la cité en son entier.
Car la loi est fondatrice. Elle est la base même de la cité. Ainsi, Créon est la parole de la loi. Il défend son pouvoir, non pour lui-même, mais pour la cité, pour le pouvoir. Découvrez ce personnage en profondeur durant vos cours de francais !
Antigone
Antigone, contrairement à Polynice, est au cœur de la cité et c'est de l'intérieur qu'elle constitue un danger pour la cité. Pour elle, la loi est intérieure. Antigone pense que l'absolu est dans l'intériorité de sa conscience.
Elle se place dans un rapport immédiat avec l'absolu. Elle a la volonté d'être sous la loi des dieux. Elle veut la fidélité au divin, et une fidélité absolue. Elle revendique la supériorité des lois divines intérieures à la conscience, sur les lois humaines qui lui sont extérieures. Chaque loi à sa légitimité, mais, les lois divines, Antigone les considère comme plus absolues.
Antigone est prête au sacrifice de son individualité, prête à mourir au nom de cet absolu, au nom du respect absolu de cette loi divine qui s'exprime dans son intériorité. Parallèlement, Créon aussi est prêt au sacrifice. Il veut la loi des hommes comme divine. Il la veut absolue, et il lui sacrifie son fils. En condamnant Antigone, il condamne la fiancée de son fils, il condamne son fils, il se condamne lui-même.
Nous sommes là au cœur du tragique. Il y a le tragique, car chacun veut l'absolu, chacun est prêt à l'absolu, absolument. Il y a l'affront de deux héros, de deux grandeurs, de deux puissances égales.

Les personnages appartenant au peuple, comme la nourrice ou les gardes, sont des personnages de comédie. Ce sont aussi des victimes silencieuses comme l'est Eurydice qui, chez Anouilh, est dépourvue de toute grandeur tragique. On retrouve alors :
- Le choeur, qui est présent du prologue au dénouement
- La Nourrice d'Antigone et Ismène
- Eurydice, la femme de Créon (et mère d'Hémon)
- Les trois gardes (qui surveillent le cadavre)
- Le page de Créon
- Le messager
Ils sont là pour faciliter la prise de décision des personnages principaux. Passons maintenant au résumé détaillé de la pièce, puis à l'analyse de pistes de lecture.
Thèmes-clés : fratrie, désobéissance et justice
✅ La pièce présente beaucoup de parallèles entre l'humain et le divin, notamment à travers les interventions du prophète aveugle
La pièce "Antigone" explore les thèmes suivants :
- La justice
- L'autorité
- La loyauté familiale
- Les conflits entre les lois humaines et les lois divines
La pièce soulève des questions éthiques profondes et met en évidence les conséquences tragiques de l'orgueil et de la rigidité face à la morale personnelle, à travers ses nombreux personnages.

La réécriture d'une pièce antique
Antigone est une « pièce noire », réécriture d'une pièce antique du dramaturge Sophocle. Anouilh a néanmoins pris de nombreuses libertés avec le texte de Sophocle. Le dramaturge, pour développer jusqu'à leurs derniers aboutissements les conséquences de son attitude devant la vie, ne pouvait rester sur le plan du quotidien. Il lui fallait l'exceptionnel de la légende antique.
Les facettes du personnage d'Antigone : faible et forte à la fois
Sa faiblesse et son jeune âge
D'abord, par son aspect physique, celui d'« une maigre jeune fille ». Petite fille malgré ses vingt ans, quelque peu infantile (« la petite pelle » utilisée pour recouvrir le corps de Polynice en témoigne), puérile dans les craintes qu'elle exprime à sa nourrice avec laquelle elle se fait enfant alors que, peu à peu, elle aspire à un rôle de mère protectrice, toute-puissante, elle n'appartient pas au monde des grands.
Un peu colérique, elle est butée, rejette les compromis et dit non à ce qu'elle ne comprend pas, ou à ce qu'elle entrevoit : un bonheur sans surprises.
Adolescente typique, elle dit « non » au bonheur commun, comme elle dit « non » à la loi sociale parce qu'elle est celle des adultes, dans une révolte anarchiste contre tous ceux qui la font obéir depuis son enfance. A-t-elle d'autres raisons d'agir que le sentiment orgueilleux d'un devoir à remplir vis-à-vis de soi-même ?
Elle se montre avide de vie, de bonheur et d'amour quand elle révèle son goût sensuel pour le matin où elle est allée voir « le jardin qui ne pense pas encore aux hommes », qui est donc comme l'Éden avant la création d'Adam, le paradis perdu, un moment où l'être humain, étant absent, pourrait être oublié. Elle dit qu'elle « aurait bien aimé vivre », posséder le monde, et rêve de se régénérer en abolissant le temps.
Sa force de caractère et son jusqu'au-boutisme
Cette pièce décrit Antigone comme une figure grave et déterminée, prête à assumer pleinement son rôle tragique. Elle défie sa nourrice et surtout Créon, symbolisant ainsi la cité, le pouvoir et l'autorité. Antigone refuse de se conformer à une existence médiocre et préfère la mort pour s'opposer à l'ordre établi. Elle se montre intransigeante, irrationnelle et refuse la discussion, enfermée dans son entêtement aveugle.
Elle aspire à une vie intense et pure, à un accomplissement sans compromis, rejetant les chaînes de l'autorité et de l'injustice.
Cependant :
- On pourrait dire qu'elle désirait être sacrifiée pour un idéal, mais elle se suicide lorsque cet idéal est perdu, cherchant simplement à rester fidèle à elle-même, même si cela semble absurde
- Cette aspiration absolue est dépourvue de contenu réel et ne peut dire que "non" face à la réalité de la vie et du bonheur
Elle reconnaît qu'elle a voulu mourir, admet que Créon avait raison et avoue ne plus savoir pourquoi elle meurt. Elle réalise alors la simplicité de la vie et regrette sa décision. Finalement, elle meurt "pour rien".

Cela met en évidence la nature passionnée, intransigeante et idéaliste d'Antigone, tout en explorant les contradictions de ses actions et de ses motivations, ainsi que les conséquences tragiques de sa détermination sans compromis.
Le quotidien de la modernité
Antigone est bien censée être une héroïne tragique, qui affirme bien qu'elle est la fille d'Oedipe :
Je suis la fille d'Oedipe, je suis Antigone. Je ne me sauverai pas.
Antigone, dans Antigone
Et les autres personnages reconnaissent aussi cette généalogie. Créon retrouve en elle l'orgueil d'Oedipe. Évoquer ses origines, c'est insister sur le fait qu'elle est la « victime choisie par le destin », qu'elle est soumise à la fatalité, qu'elle est engagée dans une voie toute tracée et qui la dépasse. Mais sa lutte ne cessera pas, dût-elle en mourir.
Mais Anouilh, notamment à travers les motivations de ses personnages, a procédé à une désacralisation. Alors qu'Antigone, chez Sophocle, obéit à deux impératifs d'ailleurs associés, le devoir fraternel et la piété à l'égard des dieux (son geste n'étant donc pas un crime, mais une belle action : elle est « saintement criminelle »), chez lui, toute référence aux dieux est absente.
Si elle est rebelle comme l'autre Antigone, sa révolte ne s'inscrit pas dans un contexte divin, mais bien face aux attitudes des êtres humains (le conflit étant bien aussi du masculin et du féminin). Anouilh eut plutôt la conception d'un destin qui pousse la société à se faire obéir (« Lui, il doit nous faire mourir »). Et elle est aussi une jeune amoureuse, la fiancée d'Hémon.

À ses derniers instants, Antigone, en présence du garde, en exprimant ses désillusions, se montre plus humaine, fait ressortir la dimension psychologique qui est plus importante dans la version moderne du mythe, fait apparaître une autre forme du tragique : l'erreur sur soi-même.
Le goût de la mort
L'action, d'une intense sobriété, est lancée par la promulgation de Créon. Puis, étroitement menée par le destin, elle court implacablement à son terme fatal. Dans cette tragédie de l'absolu, Antigone n'est pas contrainte au refus de la vie et du bonheur par un passé enchaînant.
❌ Rien ne motive son acte. Elle dit non à la vie simplement par vocation, par goût intime de la mort. La fatalité, jusqu'alors, conduisait dans les pièces d'Anouilh le ballet tragique de la vie. Antigone est à elle-même sa propre fatalité. Elle refuse de pactiser avec la vie, au nom d'une pureté dont l'unique royaume est celui de l'enfance.
C'est donc une tragédie, comme le choeur définit la pièce en l'opposant au drame qu'il préfère, étant le porte-parole de l'auteur : la tragédie impose un mécanisme inexorable qui empêche l'espoir.
Réception de l'œuvre
La pièce fut composée sous sa forme quasi-définitive en 1942, et reçut à ce moment l'aval de la censure hitlérienne. Sans doute à cause de difficultés financières, elle ne fut créée que deux ans après, le 4 février 1944, au théâtre de l'Atelier, dans un Paris encore occupé, dans une mise en scène d'André Barsacq, avec Suzanne Flon dans le rôle d'Ismène (afin de faire face au froid, elle portait sous sa robe blanche des pantalons de ski).
Elle connut un triomphe, ayant plus de
représentations.
Mais elle engendra une polémique, des réactions passionnées et contrastées. Le journal collaborationniste Je suis partout la porta aux nues :
- Créon est le représentant d'une politique qui ne se soucie guère de morale
- Antigone est une anarchiste (une « terroriste », pour reprendre la terminologie de l'époque) que ses valeurs erronées conduisent à un sacrifice inutile, semant le désordre autour d'elle
Mais simultanément, on entendit dans les différences irréconciliables entre Antigone et Créon le dialogue impossible de la Résistance et de la collaboration, celle-là parlant morale, et celui-ci d'intérêts.
L'obsession du sacrifice, l'exigence de pureté de l'héroïne triomphèrent auprès du public le plus jeune, qui aima la pièce jusqu'à l'enthousiasme. Les costumes qui donnaient aux gardes des imperméables de cuir qui ressemblaient fort à ceux de la Gestapo aidèrent à la confusion.
Origine et réécritures
La pièce de théâtre originelle est très ancienne puisqu’elle a été écrite vers
av. J.-C. par Sophocle.

Désormais, Antigone est un personnage mythologique très connu du grand public, notamment en raison de toutes les réécritures inspirées de la pièce d’origine.
Parmi celles-ci, nous pouvons notamment citer celle de Jean Rotrou en 1637, celle de Jean Cocteau en 1922 ou encore celle de Bertolt Brecht en 1948.
Cela dit, en plus de la pièce de Sophocle, nous nous intéresserons en particulier à deux autres réécritures dont celle de Jean Anouilh.
C’est aujourd’hui la réécriture la plus connue du mythe d’Antigone et aussi la version la plus étudiée en classe.
Sophocle (441 avant JC)
C’est lui qui a écrit la première pièce de théâtre au sujet d’Antigone, permettant ainsi à ce mythe de traverser les siècles. Elle fait partie de la trilogie composée par Sophocle, concernant le sort d’Œdipe (après Œdipe roi et Œdipe à Colone).
La portée de sa pièce est avant tout religieuse. Si Antigone s’oppose à son oncle, c’est du fait qu’elle place la loi divine avant celles des hommes et donc avant celles qui régissent le royaume.
Le Créon d’origine est un tyran borné, qui cherche en quelque sorte à se substituer au divin. Il fait appel aux lois de la cité mais l’on sent que c’est surtout son orgueil de souverain qui est en jeu. Il demeure sourd à tous les arguments qui l’inciteraient à faire preuve d’empathie et donc de clémence, même lorsqu’Hemon - son propre fils et, accessoirement, fiancé d’Antigone - tente de le convaincre de revenir sur son jugement.
Jean Anouilh (1944)
Même si Jean Anouilh a fait le choix de regrouper les faits en un seul acte, le déroulement de sa pièce est assez fidèle à celle de Sophocle. Cependant beaucoup de différences sont à noter.
- Sa tragédie commence avec l’apparition d’un chœur, qui nous présente les personnages et le contexte.
- Il invente le personnage de la nourrice
- D’autres n’apparaissent pas, comme le devin Tirésias
- La portée de la pièce n’est pas centrée sur la religion, mais sur l’humain. Antigone est une enfant qui refuse les injustices relatives au monde des adultes.
- C’est surtout sur le personnage de Créon que se concentrent les différences. Le sien a profondément pitié d’Antigone: il tente tout pour la sauver et ne cesse d’essayer de la raisonner. Créon a pour devoir de respecter la loi officielle, il agit donc en homme d’État qui fait passer les intérêts de son pays (du moins c’est ce qu’il pense) avant son amour pour sa famille.
- Antigone peut être interprétée comme une allégorie de la Résistance, s’opposant à l’injustice du régime de Vichy. Créon pourrait être ainsi une figure déguisée de celle du maréchal Pétain. Comme les résistants, Antigone a choisi la difficulté : la rébellion.
- La pièce d’Anouilh se déroule dans la société contemporaine de l’époque, loin du monde grec. Les anachronismes sont donc nombreux.
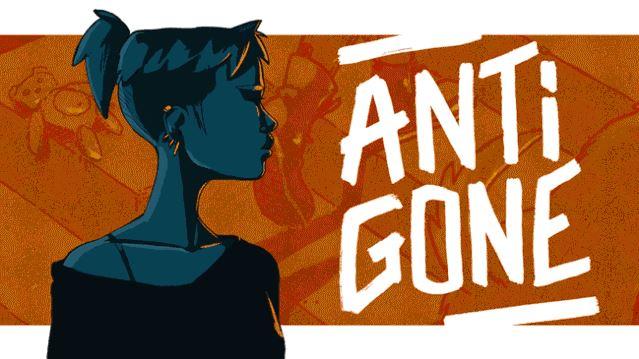
Antigone en bande dessinée (2019)
Les réécritures du mythe d’Antigone ont dépassé les frontières du théâtre. En effet, son histoire a inspirée de nombreux peintres comme Charles Jalabert, Sébastien Norblin ou encore Benjamin Constant. Mais elle a aussi été à l’origine de nombreux opéras, dont la nationalité des compositeurs prouve d’ailleurs que ce mythe a fasciné toute l’Europe : l’italien Tommaso Traetta, l’allemand Carl Orff, ou encore le néerlandais Ton de Leeuw.
Or Antigone continue à faire l’objet de réécritures, comme avec la courte bande dessinée du dessinateur Jop, qui a placé l’histoire d’Antigone dans notre monde contemporain et qui nous en offre ainsi une interprétation résolument actuelle.
En effet la transposition est on ne peut plus moderne : nous sommes en 2018 et Antigone est une jeune adolescente très impliquée dans la défense d’une ZAD (une Zone à Défendre). Zadiste, elle fait donc figure d’une rebelle moderne, attachée à l’environnement et en constante opposition avec le pouvoir. Pouvoir évidemment représenté par son oncle Créon, qui n’est autre que le préfet de son état. Il est notamment averti par la police des activités illégale de sa nièce, et va ainsi tenter de la raisonner.
On retrouve également d’autres personnages issus de la pièce de Sophocle, comme Ismène, qui est ici sa sœur de cœur, choisissant de lutter à ses côtés. S’adressant à un public majoritairement adolescent, ce nouveau regard peut donc être un très bon moyen pour découvrir le mythe originel.
Résumer avec l'IA :














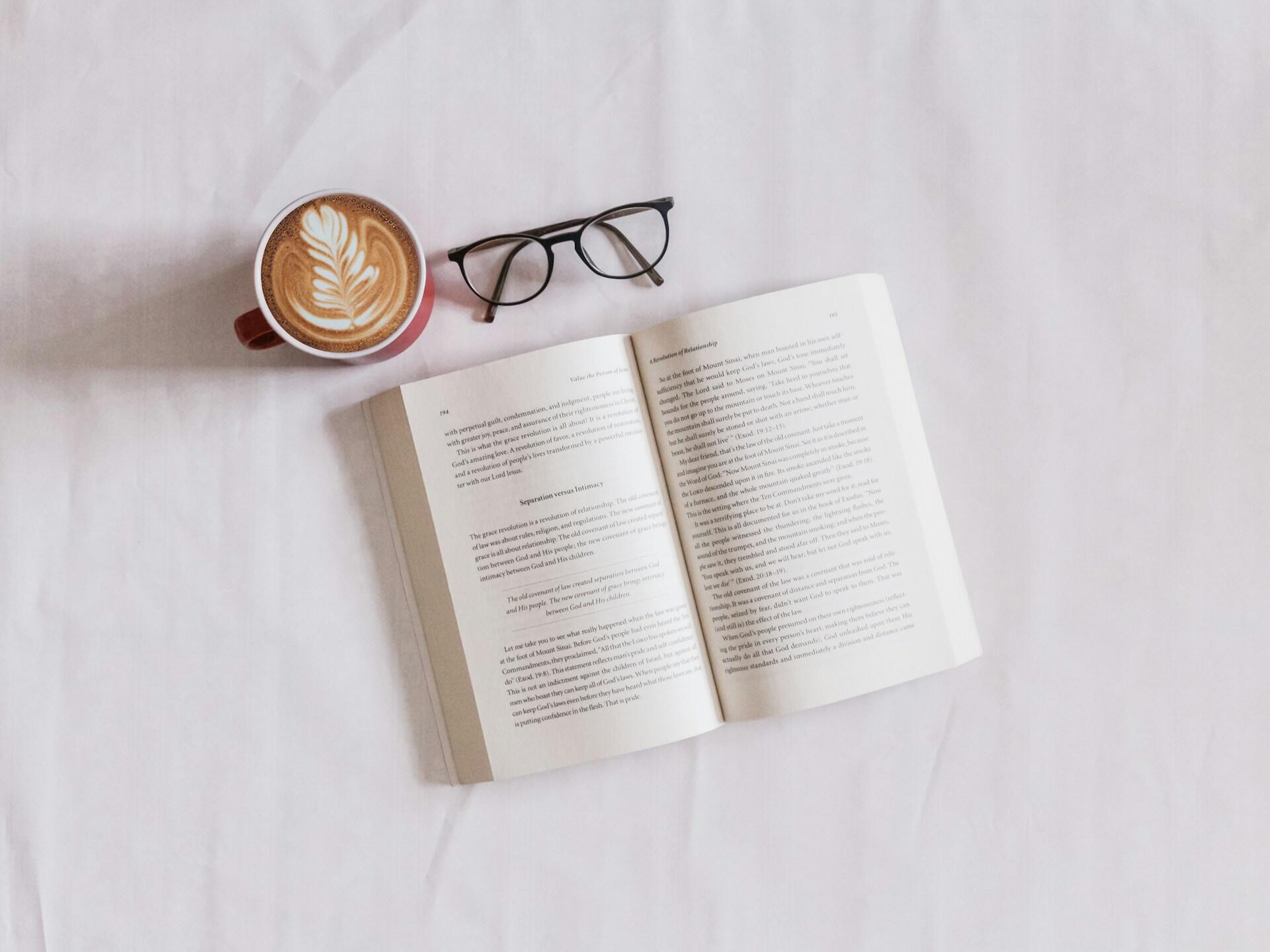


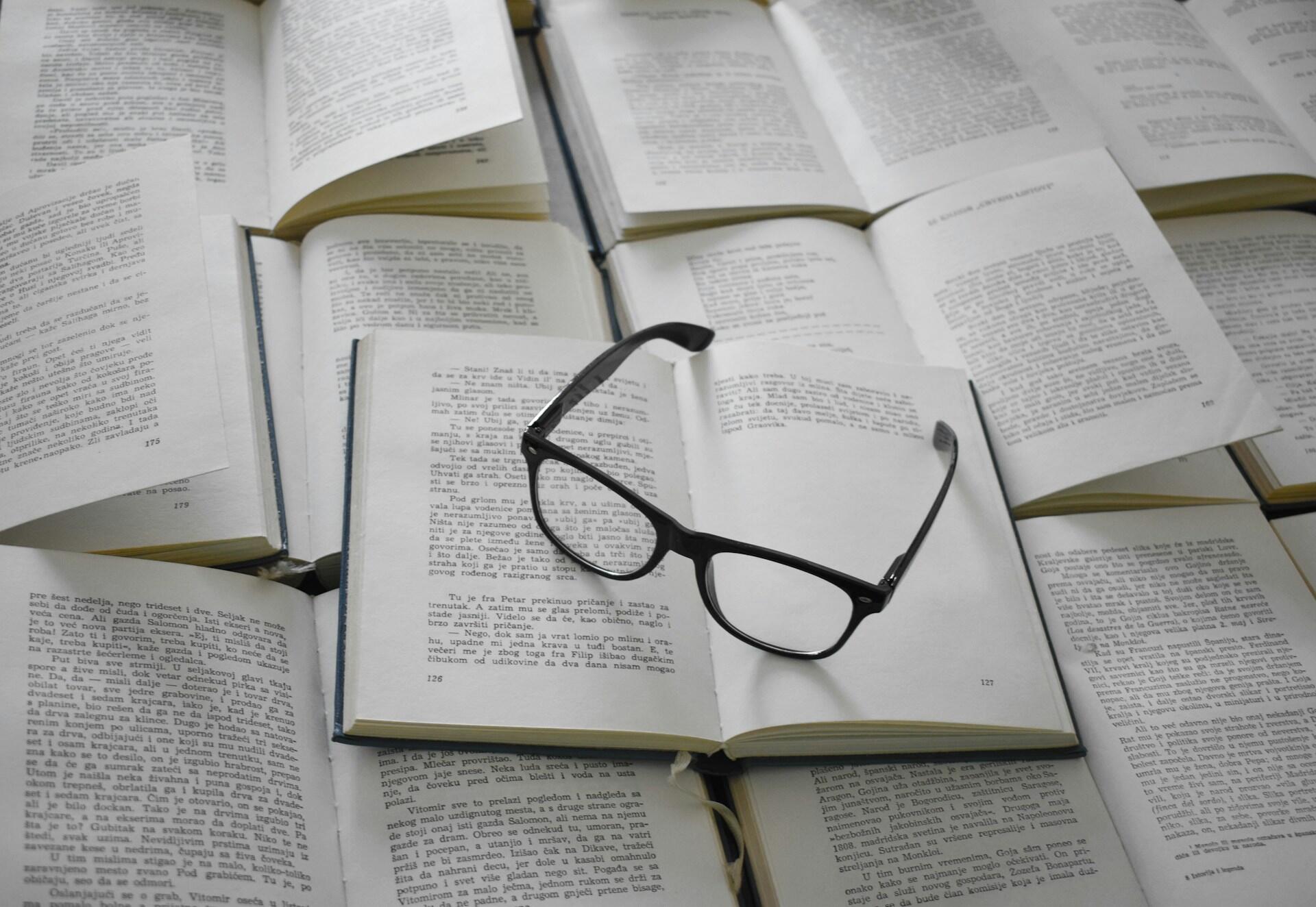
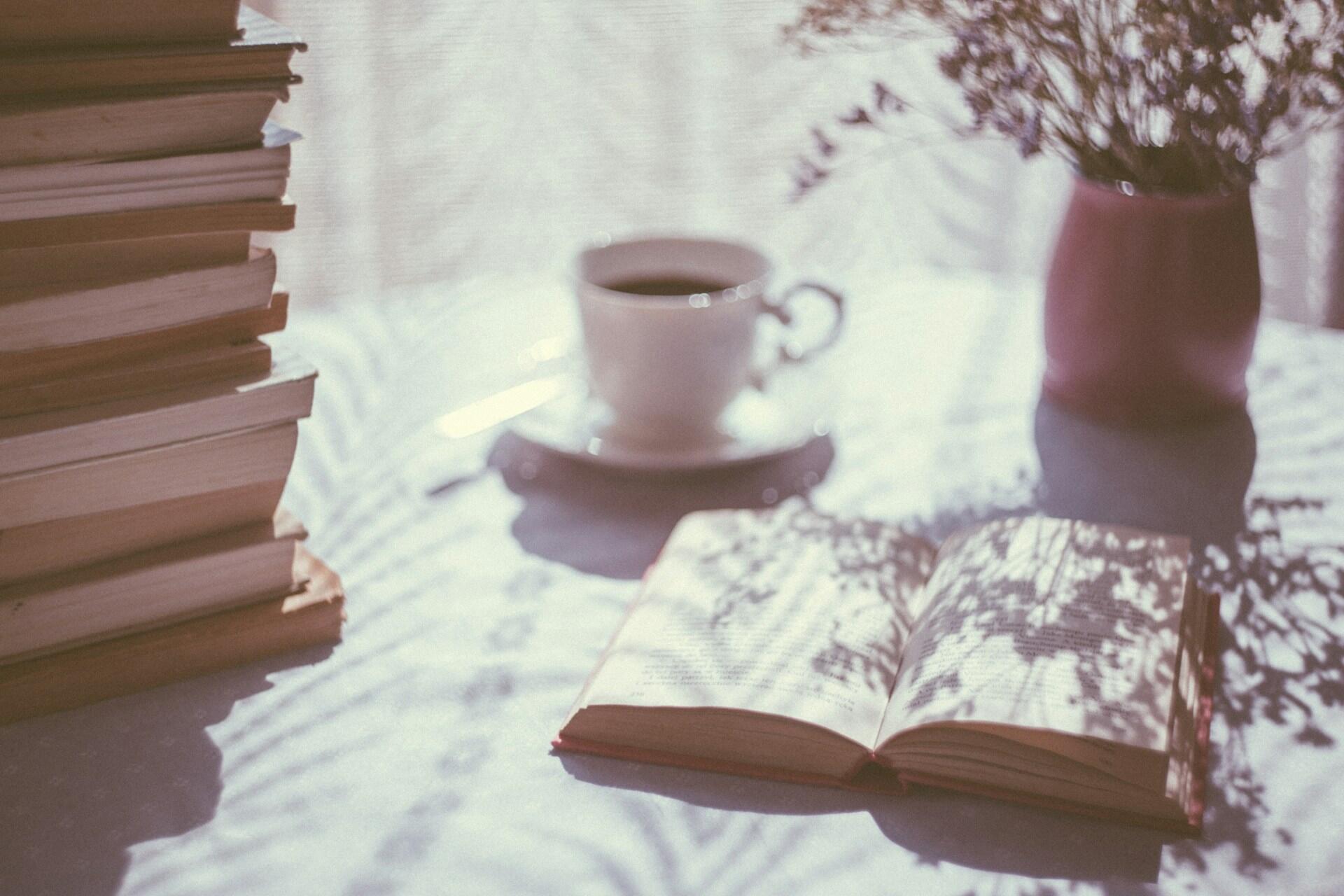


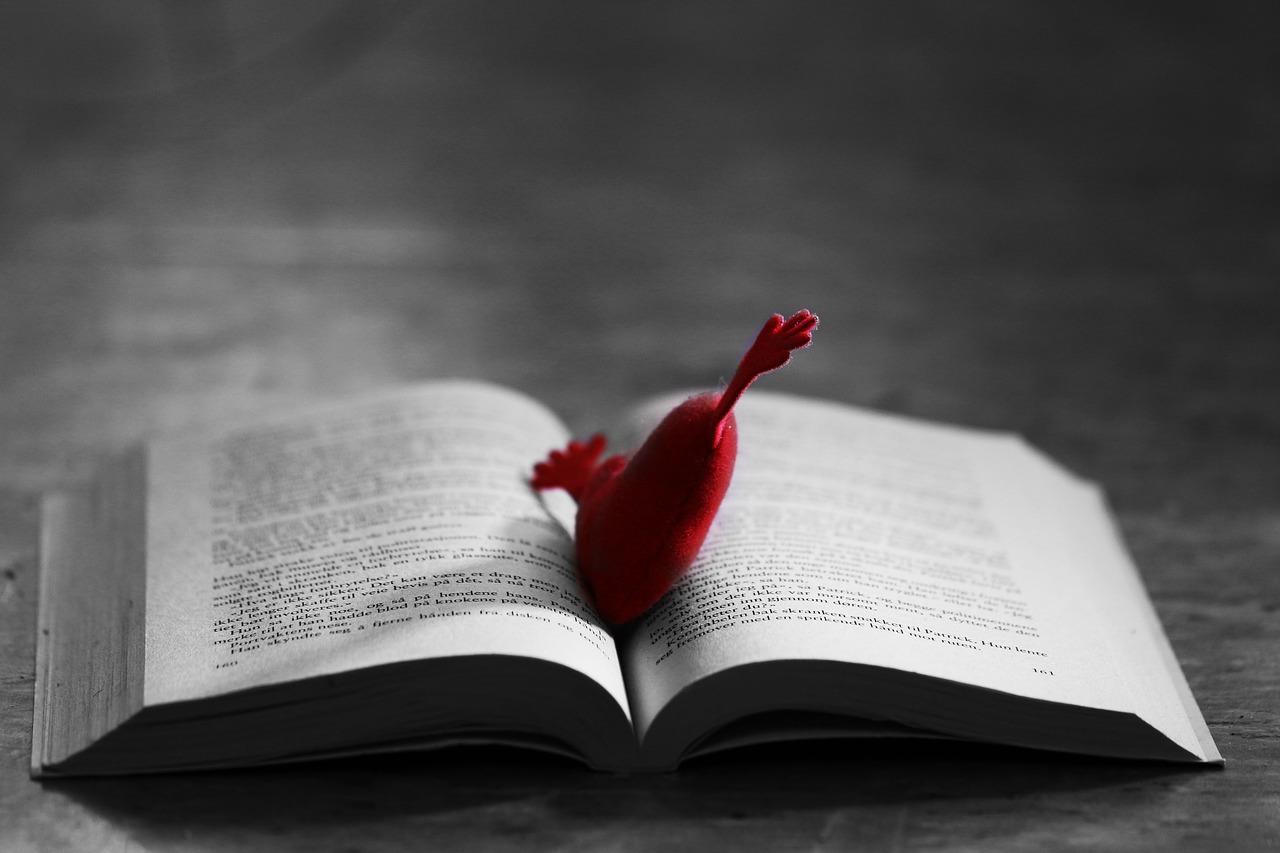

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !
n3a zabouromkom ya mibounet
Très bien
le livre ne me donne toujours pas envi même après le résumer mais grâce a vous je n’aurais pas une mauvaise tous
Merci beaucoup pour ce résumé même après avoir lu le livre j’avais pas vu tout ça Mrcc.
Ce résumé est sûrement complet mais je n’ai malheureusement pas l’impression que nous ayons lu le même ouvrage. Il est parlé de certains passages présents dans le mythe original mais sans mentionner qu’ils ne font pas partie de l’œuvre de Jean Anouilh. C’est dommage mais globalement cet page est très intéressante.
de rien