Chapitres

Le chapitre
Candide, dans le fond de son cœur, n’avait aucune envie d’épouser Cunégonde ; mais l’impertinence extrême du baron le déterminait à conclure le mariage ; et Cunégonde le pressait si vivement qu’il ne pouvait s’en dédire. Il consulta Pangloss, Martin, et le fidèle Cacambo. Pangloss fit un beau mémoire par lequel il prouvait que le baron n’avait nul droit sur sa sœur, et qu’elle pouvait, selon toutes les lois de l’empire, épouser Candide de la main gauche. Martin conclut à jeter le baron dans la mer ; Cacambo décida qu’il fallait le rendre au levanti patron, et le remettre aux galères, après quoi on l’enverrait à Rome au père général par le premier vaisseau. L’avis fut trouvé fort bon ; la vieille l’approuva ; on n’en dit rien à sa sœur ; la chose fut exécutée pour quelque argent, et on eut le plaisir d’attraper un jésuite, et de punir l’orgueil d’un baron allemand.
Il était tout naturel d’imaginer qu’après tant de désastres, Candide marié avec sa maîtresse, et vivant avec le philosophe Pangloss, le philosophe Martin, le prudent Cacambo, et la vieille, ayant d’ailleurs rapporté tant de diamants de la patrie des anciens Incas, mènerait la vie du monde la plus agréable ; mais il fut tant friponné par les Juifs, qu’il ne lui resta plus rien que sa petite métairie ; sa femme devenant tous les jours plus laide devint acariâtre et insupportable : la vieille était infirme, et fut encore de plus mauvaise humeur que Cunégonde. Cacambo, qui travaillait au jardin, et qui allait vendre des légumes à Constantinople, était excédé de travail, et maudissait sa destinée. Pangloss était au désespoir de ne pas briller dans quelque université d’Allemagne. Pour Martin, il était fermement persuadé qu’on est également mal partout ; il prenait les choses en patience. Candide, Martin, et Pangloss, disputaient quelquefois de métaphysique et de morale. On voyait souvent passer sous les fenêtres de la métairie des bateaux chargés d’effendis, de bachas, de cadis, qu’on envoyait en exil à Lemnos, à Mytilène, à Erzeroum : on voyait venir d’autres cadis, d’autres bachas, d’autres effendis, qui prenaient la place des expulsés, et qui étaient expulsés à leur tour : on voyait des têtes proprement empaillées qu’on allait présenter à la sublime Porte. Ces spectacles faisaient redoubler les dissertations ; et quand on ne disputait pas, l’ennui était si excessif, que la vieille osa un jour leur dire : Je voudrais savoir lequel est le pire, ou d’être violée cent fois par des pirates nègres, d’avoir une fesse coupée, de passer par les baguettes chez les Bulgares, d’être fouetté et pendu dans un auto-da-fé, d’être disséqué, de ramer en galère, d’éprouver enfin toutes les misères par lesquelles nous avons tous passé, ou bien de rester ici à ne rien faire ? C’est une grande question, dit Candide.
Ce discours fit naître de nouvelles réflexions, et Martin surtout conclut que l’homme était né pour vivre dans les convulsions de l’inquiétude, ou dans la léthargie de l’ennui. Candide n’en convenait pas, mais il n’assurait rien. Pangloss avouait qu’il avait toujours horriblement souffert ; mais ayant soutenu une fois que tout allait à merveille, il le soutenait toujours, et n’en croyait rien.
Une chose acheva de confirmer Martin dans ses détestables principes, de faire hésiter plus que jamais Candide et d’embarrasser Pangloss. C’est qu’ils virent un jour aborder dans leur métairie Paquette et le frère Giroflée, qui étaient dans la plus extrême misère ; ils avaient bien vite mangé leurs trois mille piastres, s’étaient quittés, s’étaient raccommodés, s’étaient brouillés, avaient été mis en prison ; s’étaient enfuis, et enfin frère Giroflée s’était fait turc. Paquette continuait son métier partout, et n’y gagnait plus rien. Je l’avais bien prévu, dit Martin à Candide, que vos présents seraient bientôt dissipés, et ne les rendraient que plus misérables. Vous avez regorgé de millions de piastres, vous et Cacambo, et vous n’êtes pas plus heureux que frère Giroflée et Paquette. Ah ! ah ! dit Pangloss à Paquette, le ciel vous ramène donc ici parmi nous. Ma pauvre enfant ! savez-vous bien que vous m’avez coûté le bout du nez, un œil, et une oreille ? Comme vous voilà faite ! eh ! qu’est-ce que ce monde ! Cette nouvelle aventure les engagea à philosopher plus que jamais. Il y avait dans le voisinage un derviche très fameux qui passait pour le meilleur philosophe de la Turquie ; ils allèrent le consulter ; Pangloss porta la parole, et lui dit : Maître, nous venons vous prier de nous dire pourquoi un aussi étrange animal que l’homme a été formé.
De quoi te mêles-tu ? lui dit le derviche ; est-ce là ton affaire ? Mais, mon révérend père, dit Candide, il y a horriblement de mal sur la terre. Qu’importe, dit le derviche, qu’il y ait du mal ou du bien ? quand sa hautesse envoie un vaisseau en Égypte, s’embarrasse-t-elle si les souris qui sont dans le vaisseau sont à leur aise ou non ? Que faut-il donc faire ? dit Pangloss. Te taire, dit le derviche. Je me flattais, dit Pangloss, de raisonner un peu avec vous des effets et des causes, du meilleur des mondes possibles, de l’origine du mal, de la nature de l’âme, et de l’harmonie préétablie. Le derviche, à ces mots, leur ferma la porte au nez.
Pendant cette conversation, la nouvelle s’était répandue qu’on venait d’étrangler à Constantinople deux vizirs du banc et le muphti, et qu’on avait empalé plusieurs de leurs amis. Cette catastrophe faisait partout un grand bruit pendant quelques heures. Pangloss, Candide, et Martin, en retournant à la petite métairie, rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le frais à sa porte sous un berceau d’orangers. Pangloss, qui était aussi curieux que raisonneur, lui demanda comment se nommait le muphti qu’on venait d’étrangler. Je n’en sais rien, répondit le bon-homme, et je n’ai jamais su le nom d’aucun muphti ni d’aucun vizir. J’ignore absolument l’aventure dont vous me parlez ; je présume qu’en général ceux qui se mêlent des affaires publiques périssent quelquefois misérablement, et qu’ils le méritent ; mais je ne m’informe jamais de ce qu’on fait à Constantinople ; je me contente d’y envoyer vendre les fruits du jardin que je cultive. Ayant dit ces mots, il fit entrer les étrangers dans sa maison ; ses deux filles et ses deux fils leur présentèrent plusieurs sortes de sorbets qu’ils faisaient eux-mêmes, du kaïmak piqué d’écorces de cédrat confit, des oranges, des citrons, des limons, des ananas, des dattes, des pistaches, du café de Moka qui n’était point mêlé avec le mauvais café de Batavia et des îles. Après quoi les deux filles de ce bon musulman parfumèrent les barbes de Candide, de Pangloss, et de Martin.
Vous devez avoir, dit Candide au Turc, une vaste et magnifique terre ? Je n’ai que vingt arpents, répondit le Turc ; je les cultive avec mes enfants ; le travail éloigne de nous trois grands maux, l’ennui, le vice, et le besoin.
[DÉBUT DE L'EXTRAIT COMMENTÉ]
Candide en retournant dans sa métairie fit de profondes réflexions sur le discours du Turc. Il dit à Pangloss et à Martin : Ce bon vieillard me paraît s’être fait un sort bien préférable à celui des six rois avec qui nous avons eu l’honneur de souper. Les grandeurs, dit Pangloss, sont fort dangereuses, selon le rapport de tous les philosophes ; car enfin Églon, roi des Moabites, fut assassiné par Aod ; Absalon fut pendu par les cheveux et percé de trois dards ; le roi Nadab, fils de Jéroboam, fut tué par Baasa ; le roi Éla, par Zambri ; Ochosias, par Jéhu ; Athalie, par Joïada ; les rois Joachim, Jéchonias, Sédécias, furent esclaves. Vous savez comment périrent Crésus, Astyage, Darius, Denys de Syracuse, Pyrrhus, Persée, Annibal, Jugurtha, Arioviste, César, Pompée, Néron, Othon, Vitellius, Domitien, Richard II d’Angleterre, Édouard II, Henri VI, Richard III, Marie Stuart, Charles Ier, les trois Henri de France, l’empereur Henri IV ? Vous savez….. Je sais aussi, dit Candide, qu’il faut cultiver notre jardin. Vous avez raison, dit Pangloss ; car, quand l’homme fut mis dans le jardin d’Éden, il y fut mis ut operaretur eum, pour qu’il travaillât ; ce qui prouve que l’homme n’est pas né pour le repos. Travaillons sans raisonner, dit Martin, c’est le seul moyen de rendre la vie supportable.
Toute la petite société entra dans ce louable dessein ; chacun se mit à exercer ses talents. La petite terre rapporta beaucoup. Cunégonde était, à la vérité, bien laide ; mais elle devint une excellente pâtissière ; Paquette broda ; la vieille eut soin du linge. Il n’y eut pas jusqu’à frère Giroflée qui ne rendît service ; il fut un très bon menuisier, et même devint honnête homme : et Pangloss disait quelquefois à Candide : Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles ; car enfin si vous n’aviez pas été chassé d’un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l’amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n’aviez pas été mis à l’inquisition, si vous n’aviez pas couru l’Amérique à pied, si vous n’aviez pas donné un bon coup d’épée au baron, si vous n’aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d’Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin.
Candide ou l'Optimisme, Voltaire, 1759

Méthode du commentaire composé
On rappellera ici la méthode du commentaire composé vu en cours francais :
| Partie du commentaire | Visée | Informations indispensables | Écueils à éviter |
|---|---|---|---|
| Introduction | - Présenter et situer le texte dans le roman - Présenter le projet de lecture (= annonce de la problématique) - Présenter le plan (généralement, deux axes) | - Renseignements brefs sur l'auteur - Localisation du passage dans l'œuvre (début ? Milieu ? Fin ?) - Problématique (En quoi… ? Dans quelle mesure… ?) - Les axes de réflexions | - Ne pas problématiser - Utiliser des formules trop lourdes pour la présentation de l'auteur |
| Développement | - Expliquer le texte le plus exhaustivement possible - Argumenter pour justifier ses interprétations (le commentaire composé est un texte argumentatif) | - Etude de la forme (champs lexicaux, figures de styles, etc.) - Etude du fond (ne jamais perdre de vue le fond) - Les transitions entre chaque idée/partie | - Construire le plan sur l'opposition fond/forme : chacune des parties doit impérativement contenir des deux - Suivre le déroulement du texte, raconter l'histoire, paraphraser - Ne pas commenter les citations utilisées |
| Conclusion | - Dresser le bilan - Exprimer clairement ses conclusions - Elargir ses réflexions par une ouverture (lien avec une autre œuvre ? Événement historique ? etc.) | - Les conclusions de l'argumentation | - Répéter simplement ce qui a précédé |
Ici, nous détaillerons par l'italique les différents moments du développement, mais ils ne sont normalement pas à signaler. De même, il ne doit normalement pas figurer de tableaux dans votre commentaire composé. Les listes à puces sont également à éviter, tout spécialement pour l'annonce du plan.
Remarque : nous visons ici l'exhaustivité et tentons de citer un maximum de choses pour appuyer notre propos. Vous n'aurez jamais le temps de tout repérer et de tout écrire le jour de l'épreuve !
Commentaire de l'extrait
Introduction
Candide ou l'Optimisme est un conte philosophique publié par Voltaire en 1759. L'auteur y présente un personnage qui grandit de ses voyages, se forme intellectuellement et deviendra lui-même philosophe. C'est un récit teinté d'ironie qui veut rendre compte des moeurs de son temps, tout en y apportant une critique.
Il s'agit également de tourner en ridicule la pensée optimiste du philosophe allemand Leibniz, selon qui le monde, parce qu'il a été créé par un Dieu parfait, serait le meilleur des mondes possibles. Pour Voltaire, au contraire, l'homme passe son existence dans un monde rempli d'horreurs, dont le héros Candide fait l'expérience. Il appartient donc à l'Homme d'améliorer de lui-même sa condition.
L'extrait qui nous occupe ici est la fin du conte philosophique (appelé excipit, soit les derniers mots d'une histoire). Candide se retrouve dans sa métairie, une exploitation agricole, avec tous les personnages rencontrés au cours de ses aventures : Martin, le philosophe pessimiste, Pangloss, le philosophe optimiste caricature de Leibniz, Cunégonde, sa femme, Paquette, la servante, etc.
En tant que conclusion d'un conte philosophique, cet excipit est l'occasion d'apporter une conclusion à l'histoire : elle doit montrer ce que Candide a appris de ses péripéties, si d'aventure il y avait quelque chose à en tirer.
Annonce de la problématique
Dès lors, dans quelle mesure le conte apporte-t-il une morale philosophique ?
Annonce du plan
Nous verrons dans un premier temps que cette fin de récit présente les caractéristiques principales de l'excipit. Nous analyserons ensuite les diverses évolutions connues par les personnages, et ce qu'elles disent de l'histoire elle-même. Enfin, nous montrerons comment les paroles de chacun invitent le lecteur à « cultiver son jardin ».
Développement
Un excipit typique
C'est sur cet extrait que se clôt le conte philosophique Candide. Cela se repère en deux points caractéristiques de l'excipit : le récit se termine par un retour chez soi et son dénouement est heureux.
Retour chez soi

L'extrait s'ouvre sur une formule explicite : « Candide en retournant dans sa métairie ... ». Cette métairie, c'est le « chez soi » de Candide. C'est donc dire qu'il s'en revient finalement chez lui, après une dernière péripétie.
En outre, il y a chez lui l'ensemble des personnages principaux, ceux avec qui il a fait ses voyages, c'est-à-dire ceux avec qui il est censé avoir appris quelque chose (puisque, paraît-il, les voyages forment la jeunesse). Pangloss, Cunégonde, Giroflée, la vieille et Martin sont tous présents dans ce jardin.
Surtout, la dernière tirade de Pangloss résume l'ensemble du conte, faisant un bilan des principales aventures :
si vous n’aviez pas été chassé d’un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l’amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n’aviez pas été mis à l’inquisition, si vous n’aviez pas couru l’Amérique à pied, si vous n’aviez pas donné un bon coup d’épée au baron, si vous n’aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d’Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches.
Or, un bilan, c'est bien quelque chose que l'on fait à la fin.
Une fin heureuse
Il faut également rappeler qu'il s'agit d'un conte philosophique, qui veut parodier le genre du conte lui-même. Or, le genre du conte a certaines règles à laquelle cette conclusion fait aboutir.
Candide est un héros qui a surmonté toutes les épreuves énumérés par Pangloss. Surtout, il a atteint l'objet ultime de sa quête : l'amour de Cunégonde.
En outre, le conte se termine par une dénouement heureux. Tous les personnages trouvent leur place (« chacun se mit à exercer ses talents ») et leur bonheur est finalement accentué par des superlatifs : « Cunégonde [...] devint une excellente pâtissière », « Giroflée [...] fut un très bon menuisier ».
Enfin, les derniers mots du conte ont l'allure d'une maxime :
« Il faut cultiver notre jardin. »
Transition
C'est donc ce que Candide semble avoir retiré de ses multiples aventures et il l'affirme avec l'aplomb de son bonheur. En cela, Candide a changé entre son départ et son retour.
L'évolution des personnages
Il y a un antagonisme perceptible entre Pangloss et Candide : si le premier semble être resté le même, Candide, au contraire, fait montre d'une sagesse qu'il n'avait pas au cours du récit.
Pangloss, du pareil au même
Pangloss agit d'une manière identique à celle du début : il prononce de longs discours qui ont l'apparence de la logique sans en avoir la rigueur, et répète encore que tout va pour le mieux « dans le meilleur des mondes possibles ».
Ses voyages ne l'ont pas changé et ne lui ont pas donné de capacités personnelles :
- il est toujours incapable de penser par lui-même, comme le signifie la formule « selon le rapport de tous les philosophes » (il utilise des arguments d'autorité)
- il cite la Bible en latin (« ut operaretur eum », qui signifie « pour qu'il travaille »), ce qui le montre comme dogmatique et engoncé dans un passé révolu
- il a gardé son optimisme à toute épreuve, malgré tous les événements terribles qu'il a lui-même vécus
Pangloss monopolise toujours la parole et étale ce faisant sa culture inutile. Car elle se révèle bien inutile face au laconisme de Candide, qui lui répond par deux fois : « il faut cultiver notre jardin. »
Candide le sage
Ces réponses de la part de Candide montrent d'abord son émancipation. Tandis qu'au début du récit, il se soumettait à la doctrine de Pangloss, il lui oppose désormais sa propre vision des choses, héritées de ce qu'il a vu du monde et de ce qu'il en a compris. Cette opposition est matérialisée par la conjonction de coordination « mais » :
Cela est bien dit mais il faut cultiver notre jardin.
En outre, Pangloss l'adoube, puisqu'il reconnaît qu'il a raison (« Vous avez raison »). À la fin du récit, on peut donc dire que l'élève a pris la place du maître.

Candide réfléchit seul, calmement et silencieusement (soit tout l'inverse du loquace Pangloss) :
Candide en retournant dans sa métairie fit de profondes réflexions sur le discours du Turc.
De ces réflexions naît la maxime, sage entre toutes, selon laquelle il faudrait cultiver son jardin. Il est devenu un philosophe véritable, qui chérit la sobriété et la réflexion en solitaire. Il illustre ainsi l'un des principes des Lumières : l'Homme doit s'émanciper par une pensée individuelle, nourrie par l'esprit critique.
Transition
C'est que de fait, Voltaire use de Candide pour transmettre ces valeurs-là.
Cultiver son jardin
Sans surprise, les fondements de ces valeurs se trouvent dans cette maxime qui clôture le récit : « il faut cultiver son jardin ». Elle s'explique en trois points : le travail fait accéder au bonheur, l'action vaut mieux que les discours, la réalité demande des efforts.
Travail et bonheur
Dans la métairie de Candide, chacun travaille et y trouve son propre bonheur : Paquette est brodeuse, Martin est jardinier, la vieille garde les toiles, Cunégonde est cuisinière, etc. Mais plus important encore : en se consacrant à ces activités respectives, ils trouvent une sorte de destinée, puisqu'ils se révèlent doués pour celles-ci (rappelons les superlatifs déjà mis au jour).
Voltaire conduit sa fin de récit avec une tonalité véritablement positive. Il utilise des termes appréciatifs, tels que « louable », « excellente », « très bon » ou encore « honnête ». Ces termes sont associés à l'idée de labeur, puisque les verbes « travailler » et « cultiver » reviennent à deux reprises. C'est dire l'importance et la valeur des travaux manuels.
En outre, le caractère commun et anonyme de ces activités est valorisé face à la longue et risible tirade de Pangloss, qui cite tous les grands noms de l'histoire ayant cherché les « grandeurs dangereuses » et qui ont, pour cela, connu une mort terrible.
A contrario, travailler humblement la terre est une garantie de vie paisible et heureuse. À la fin, en effet, ces menus efforts contribuent à ce que « la petite terre rapporte beaucoup ». Des petits pas font ainsi des grandes choses.
Action versus discours
Candide montre en deux endroits au moins que l'action vaut mieux que le discours :
- il interrompt Pangloss au milieu de son soliloque : « Vous savez….. Je sais aussi, dit Candide, qu’il faut cultiver notre jardin. »
- il réfléchit, mais donne à sa réflexion un aboutissement pratique : « Il faut cultiver notre jardin. », avec le verbe « falloir » qui apporte l'idée de nécessaire mise en action (il faut le faire)
Les petites actions de tous conduisent ainsi à une vie en communauté heureuse, qui s'enrichit des efforts consentis par tous.
Enfin, le travail - et donc l'action - permet d'éviter de se lamenter. Il faut rappeler que la phrase qui précède immédiatement l'extrait commenté est :
le travail éloigne de nous trois grands maux, l’ennui, le vice, et le besoin.
Ainsi, pour Voltaire, le travail permet d'échapper à la condition dangereuse de l'Homme. Agir permet d'éviter l'ennui et d'éloigner le besoin.

Les efforts de la vie
C'est dire qu'il ne suffit pas d'être optimiste pour que la vie soit belle. C'est finalement le sens du dernier moment de l'extrait : Pangloss tient une longue tirade remplie d'hypothèses (signifiées par les « si ..., si ... ») qu'il conclut avec une chute dérisoire. Fallait-il vraiment affronter des dangers invraisemblables pour devoir arriver à une conclusion aussi simple ?
Au contraire, Candide répond avec un laconique et prosaïque « Il faut cultiver notre jardin. » Autrement dit, rien ne sert de croire en une destinée positive pour s'en assurer l'existence ; mieux vaut travailler modestement la terre qui est à soi, et ne s'occuper que de cela.
Conclusion
En concluant son conte philosophique avec cette maxime devenue légendaire, Voltaire montre surtout comment son héros s'est émancipé et se montre capable de réfléchir par lui-même à son propre bonheur.
Il n'empêche : il invite aussi son lecteur à adopter la même conduite que Candide. Dans un monde imparfait, où le hasard autant que l'injustice existent, l'Homme doit s'occuper de son sort et cultiver ses talents.
Ouverture
Car on peut aussi discuter de la dimension potentiellement métaphorique de l'expression « cultiver son jardin » : ne s'agirait-il que d'une activité manuelle ?
Résumer avec l'IA :
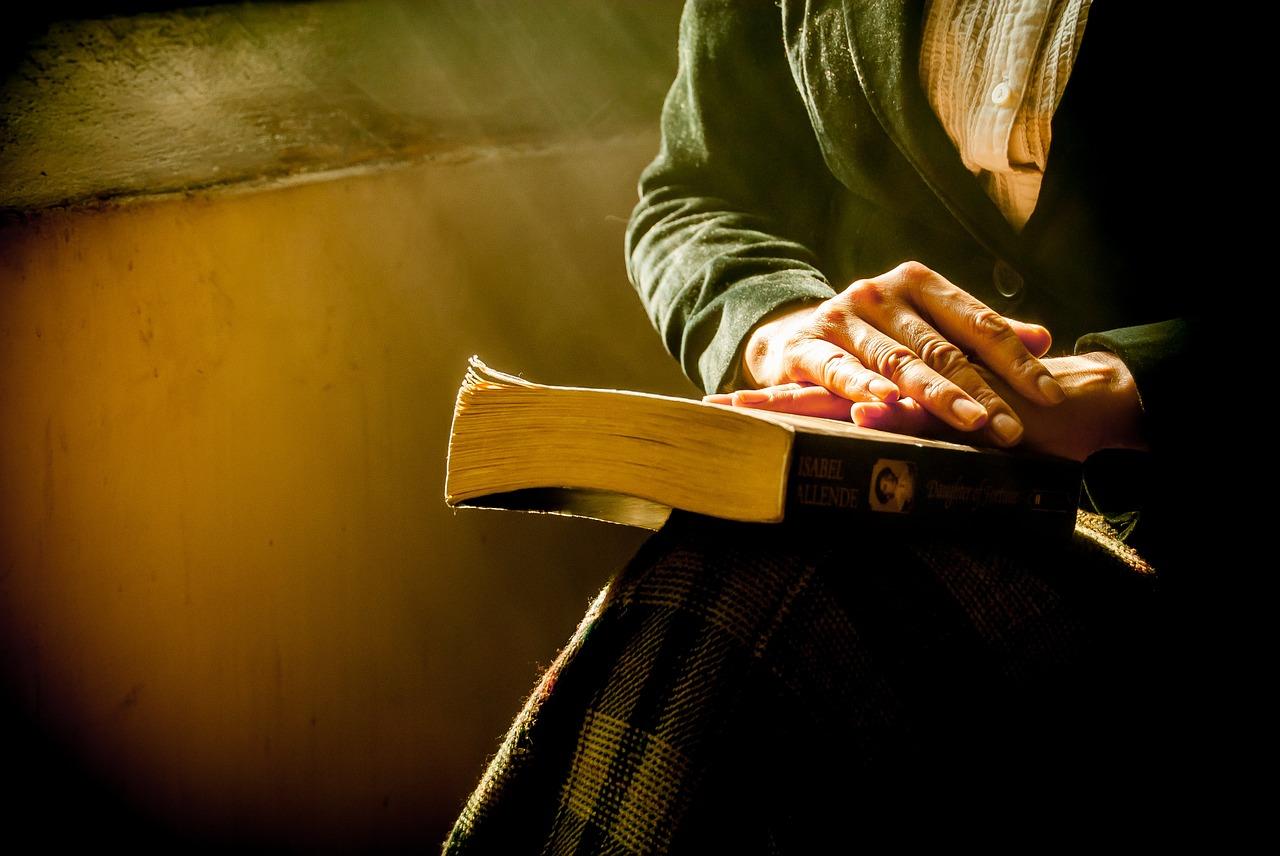






















Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !
Résumé sur ce texte de Voltaire Candide 1759