Vous en connaissez la plupart mais certaines restent encore floues dans votre esprit ?
Voici donc un petit rappel. N'oubliez pas qu'énumérer les figures de style ne sert à rien ; il faut penser avant tout à l'effet produit, au but recherché par l'auteur.
- allégorie = figuration d'une abstraction (ex = la mort) par une image (ici, un squelette armé d'une faux)
- allitération = répétition de consonnes . Exemple = "Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?" (Racine, Andromaque). En général dans les poèmes, mais on en trouve partout, notamment ds les textes argumentatifs.
- amplification ou gradation (ou accumulation) = elle se fonde sur une gradation successive d'idées ou de mots de plus en plus forts entre les termes d'une énumération ou dans la construction d'un paragraphe. Exemple : "Adieu veaux, vaches, cochons, couvée" (La Fontaine, Perrette et le pot au lait) ; j'avoue que cet exemple me pose toujours problème : s'agit-il d'une gradation ascendante ou descendante ? La vache ets plus grosse que le boeuf, OK. Mais le cochon est plus petit et la couvée encore plus. Deux types de gradation dans ce vers.
- anaphore = commencer par le même mot les divers membres d'une phrase ou d'un vers. Exemple = "Rome, l'unique objet de mon ressentiment ! / Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant ! / Rome qui t'a vu naître et que ton coeur adore ! / Rome enfin que je hais..." (Corneille, Horace).
- antiphrase = on exprime une idée par son contraire. Voir ironie de Voltaire, notamment les fameux passages de Candide (la guerre, l'esclave).
- antithèse = rapprochement de deux pensées, deux expressions, deux mots opposés pour mieux faire ressortir le contraste. exemple = "...un homme est là / qui vous aime, perdu dans la nuit qui le voile ; / qui souffre, ver de terre amoureux d'une étoile...". ATTENTION ! Ne pas confondre avec la série thèse / antithèse / synthèse.
- assonance (dans poésies) = répétition d'une même voyelle. Exemple avec é = "Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant..." (Verlaine, Poèmes saturniens).
- chiasme = termes disposés d'une manière croisée suivant la structure ABBA. Exemple = "Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger."
- comparaison et métaphore => voir niveau 3e, lol ! Intéressant : la métaphore filée, cad. une métaphore développée dans tout un paragraphe, voire un texte entier.
- euphémisme = remplacer une expression un peu forte ou désagréable par une forme atténuée ou adoucie. Exemple =
"vient de disparaître pour "vient de mourir".
- hyperbole = exagération. Emploi de mots au sens excessif. Exemple = "Je meurs de soif.
- litote = dire moins pour suggérer davantage. C'est donc le contraire de l'euphémisme. Exemple = Chimène à Rodrigue dans Le Cid de Corneille : "Va, je ne te hais point." (sous-entendu : je t'aime)
- métonymie = désigner un objet ou une idée par un autre terme que celui qui lui convient mais qui lui est lié par analogie. Exemple : "boire une verre", "une lame" (pour une épée), "une voile" (pour un navire), etc.
- oxymore = alliance de mots plus ou moins opposés : "Cette obscure clarté qui tombes des étoiles" (Corneille), "Le soleil noir de la mélancolie " (Nerval). Surtout utilisé en poésie. Dans un texte, on parle plus volontiers d'antithèse ou d'opposition, mais il n'est pas interdit d'utiliser le terme oxymore.
- personnification (à ne pas confondre avec allégorie) = elle attribue à une chose abstraite les propriétés d'un être animé.
- prétérition = c'est lorsqu'on affirme passer sous silence une chose dont on parle néanmoins. Utilisé dans les textes argumentatifs.
- synecdoque = pratiquement synonyme de métonymie. En fait, on assigne à un mot un sens plus large ou plus restreint. Exemple = "acheter un vison".
NB : Toutes les figures de style ne figurent pas ici. La plupart remontent à l'Antiquité grecque et romaine et au temps fameux de la
rhétorique. Du reste, on utilise volontiers le terme "figures de rhétorique" en langage savant.
Résumer avec l'IA :
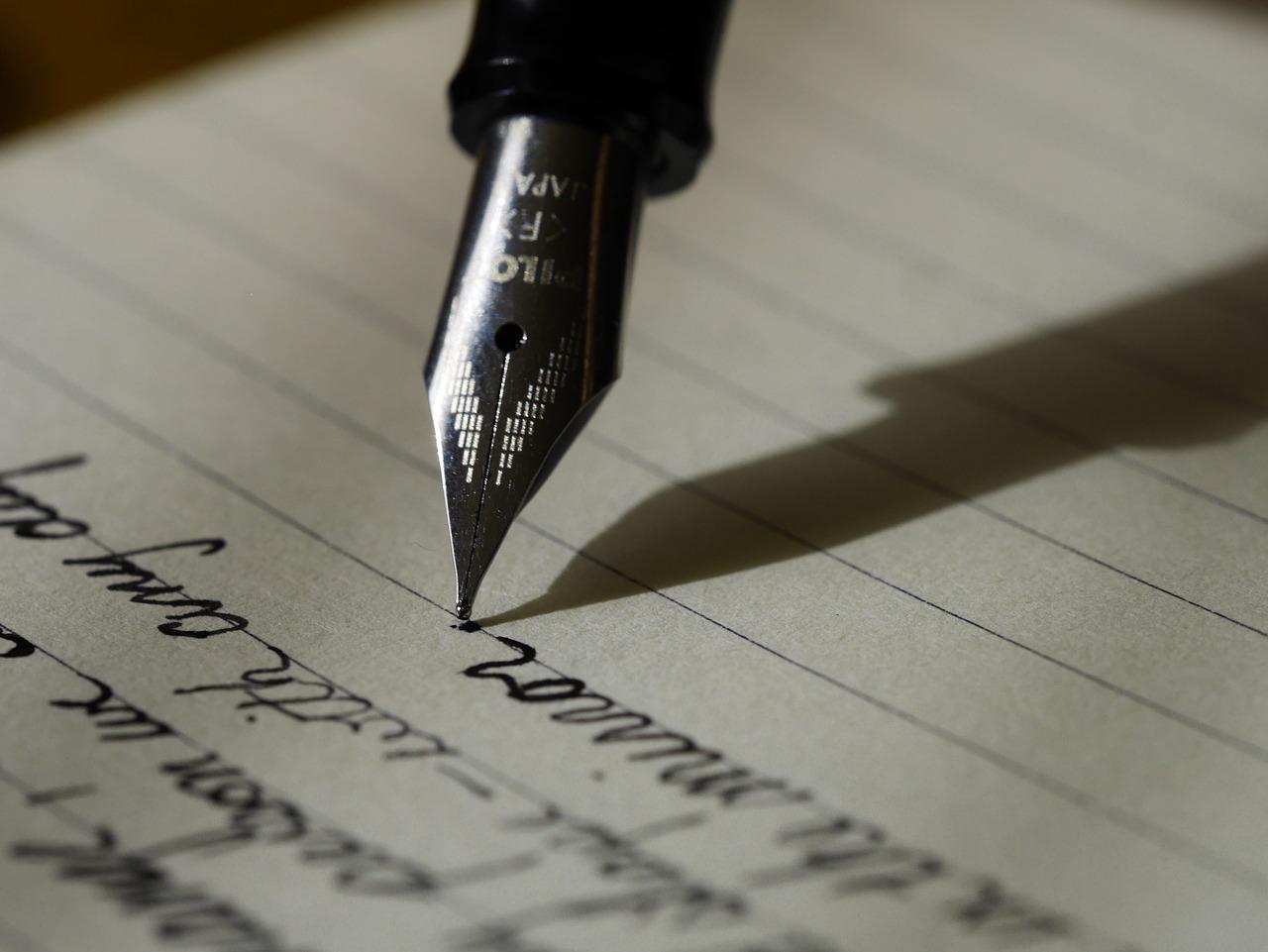











Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !