Chapitres
- 01. I / Une stricte égalité des DF contestable
- 02. A/ Une prééminence palpable au sein des droits fondamentaux
- 03. B/ Vers une consécration supra-constitutionnelle de certains principes?
- 04. II/ L’absence de hiérarchie juridique formelle préétablie des DF
- 05. A/ Une hiérarchisation des DF réfutée
- 06. B/ Une hiérarchie restreinte par la politique conciliatrice des juges
Pour Frédéric Sudre, « tout classification de droit emporte un part d’arbitraire, et aucune classification n’est en soi satisfaisante » ; de surcroit, « classer les droits de l’homme et les libertés fondamentales reste une entreprise très délicate ». Dès lors, face à cette difficulté et en tant que juriste, il s’agit d’approcher la confrontation entre les droits fondamentaux.
Les droits fondamentaux sont une notion abstraite dont il n’existe pas de définition faisant l’unanimité.
Par conséquent, il sera tiré exemple de la pragmatique définition émise par Etienne Picard définissant les droits fondamentaux comme « assez essentiels pour fonder et déterminer, plus ou moins directement, les grandes structures de l'ordre juridique tout entier en ses catégories, dans lequel et par lesquelles ils cherchent à se donner ainsi les moyens multiples de leurs garanties et de leur réalisation. Mais, se heurtant nécessairement à eux-mêmes, ils révèlent ainsi, par leur prévalence respective, leur plus ou moins grande fondamentalité de fond ». En l’espèce, il ne sera traité que droits ayant reçu une reconnaissance supra-légale. Il s’agit des libertés et les droits reconnus par la constitution, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la constitution de 1946 (repris par celle de 1958) et les principes fondamentaux dégagés et auxquels ces textes renvois. 
En conséquence, il advient que la confrontation entre droits fondamentaux doit générer l’interrogation suivante : Stricte égalité ou nécessaire hiérarchie ?
Dans cette perspective, il ressortira que la stricte égalité des droits fondamentaux est contestable (I/). Néanmoins, la thèse inverse soutenant l’absence de hiérarchie préétablie des droits fondamentaux (II/) émerge à travers le refus croissant de la doctrine d’admettre une hiérarchie formelle et grâce à la démarche progressiste des juges.

I / Une stricte égalité des DF contestable
Au regard d’une partie de la doctrine, il y a bel et bien une prééminence palpable au sein des droits fondamentaux (A/). Si bien que des auteurs tel que Serge Arné se demandent l’hégémonie de certains droits ne tend pas vers une consécration supra-constitutionnelle de certains principes (B/).
A/ Une prééminence palpable au sein des droits fondamentaux
L’hétérogénéité de nature des droits fondamentaux (1/) montre la distance qu’il existe entre les Droits de l’Homme de 1789, droit naturel et les droits positifs dégagés postérieurement. Par la suite, il sera fait référence à un noyau dur des droits fondamentaux (2/).
1/ Une hétérogénéité de nature
Il apparait que les droits de l’homme de 1789 et les droits fondamentaux ultérieurs (Préambule de 1946) ont une parenté, une nature sensiblement distincte. Le Conseiller d’Etat Daniel Lévis caractérise les droits de 1789 de « droit impératifs catégoriques procédant de la postulation de l’individu, possédant une nature propre ». A fortiori, les droits autres que « initiaux » (terme qui renforce l’idée d’antériorité) peuvent êtres fondamentaux, mais ils n’ont clairement pas la même nature, visée. Dès lors, ces droits vont dans le sens d’une stricte égalité des DF contestable.
Les droits initiaux, « droit des droits » sont les droits de l’homme, tout autre droit ultérieur rattaché au réel, à un moment donné ne saurait être rangé au même rang.
Par cet aspect spécifique de certains droits fondamentaux, il se dessine une hiérarchie dans laquelle la jurisprudence et la doctrine distingue les droits intangible des droits ultérieurs, synonyme d’inférieur.
2/ La référence à un noyau dur des DF
Sur un plan international, il se dégage l’idée d’un noyau dur des droits de l’homme dans les traités ou conventions internationaux. Il est fait état de quatre droits hiérarchiquement supérieurs aux autres : le droit à la vie, le droit de ne pas être torturé, le droit de ne pas être tenu en esclavage et le droit à la non rétro activité de la loi pénale. C'est le standard minimum des droits fondamentaux s'appliquant à tous, ainsi est dévoilé la portée concrète des droits de l'homme et forment un patrimoine commun de l'humanité ; ils sont reconnus à la fois par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention américaine relative aux droits de l'homme et laConvention européenne des droits de l'homme. 
Pour concrétiser cet élan, une partie de la doctrine prend le partie de faire donner une valeur supra constitutionnelle à certains de ces droits (aux principes matriciels).
B/ Vers une consécration supra-constitutionnelle de certains principes?
Tendre vers des normes supra constitutionnelles, s’est donner à ces droits « intangibles » une transcendance qu’ils n’ont pas en pratique ; le constituant ne serait plus à même d’intervenir.
En effet, au travers la doctrine et la jurisprudence, il ressort la vocation hégémonique de principes matriciels (1/). Cependant, cette transcendance est relative ( 2/) puisqu’elle n’ a pas été consacrée.
1/ La vocation hégémonique de principes matriciels
Ici, les droits intangibles et amener à avoir une valeur supra constitutionnelle sont le respect de la dignité de la personne humaine, la non discrimination (et la solidarité en corollaire) et le pluralisme. Des ces principes positifs et source de droits, il sera tiré exemple du principe de dignité qui est aussi une qualité substantielle de la personne humaine. On parle de principe matriciel, interrogeable, absolu. Elle est un postulat qui n’appelle pas de démonstration. Du principe du droit à la dignité découlent d’autres droits (le principe de la primauté de la personne humaine, du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité de l’intégrité, l’absence de patrimonialité du corps humain, et l’intégrité de l’espèce humaine etc..). Cette hégémonie met en exergue l’idée d’une hiérarchie au sein des droits. Néanmoins, la transcendance voulue à travers la supra-constitutionalité reste relative.
2/ Une transcendance relative
Cette transcendance reste relative puisque la supra constitutionalité de ces principes n’a pas été consacrée.
En outre, l’effectivité du principe de dignité est affaiblie par une tendance à faire prévaloir l’exigence de liberté, en tant que droit subjectif. Au-delà du débat idéologique sur cette question, c’est la protection de l’individu qui est en jeu. Benoit Jorion nous invite à la prudence face au phénomène de « concurrence victimaire »des droits fondamentaux. Il faut alors comprendre que le principe de dignité, malgré sa suprématie apparente, reste un vecteur de cohésion et de dynamisme avec les droits fondamentaux qui découle de ce dernier. A fortiori, et dans le sens d’une meilleure protection de l’individu, la méthode adéquate semble la conciliation entres ces différents droits. Il n’y aurai pas de hiérarchie juridique préétablie. Certes certains droits semble centraux, mais d’un point de vue formel et dans l’approche du juge, il semble avenu d’adopter un raisonnement où l’idée de hiérarchie n’intervient pas.
II/ L’absence de hiérarchie juridique formelle préétablie des DF
Ici c’est la thèse inverse qui est invoquée. De facto, la hiérarchisation des DF est réfutée (A/) et écartée par la politique conciliatrice des Juges (B/). Cependant, la nuance est de rigueur est il sera difficile d’évoquer en l’espèce une stricte égalité.
A/ Une hiérarchisation des DF réfutée
Il n’existe pas de hiérarchie préétablie entre les droits fondamentaux et a fortiori entre les composantes du bloc de constitutionnalité. Il sera alors fait état de deux aspect à l’appuie de ce propos : une égalité formelle affirmé (1/) et une égalité substantielle suggérée (2/)
1/ Une égalité juridique formelle affirmée
D’après le constat de Dominique Rousseau, « sur le plan du droit positif, rien ne permet de fonder une différence de valeur entre la Déclaration et le Préambule de 1946 ». Concernant le mode d’élaboration de ces deux textes, il est identique : les deux textes ont été proclamés dans les mêmes formes, par des Assemblées constituantes similaires et enfin aucun vice de procédure n’est intervenu. En outre, comme l’affirme Louis Favoreu, il n’y a pas de hiérarchie entre les droits et libertés fondamentaux dès qu’ils sont protégés constitutionnellement. Resurgit en l’espèce la décision de 1982 qui contredit ce propos ; dès lors il s’agit d’une « méprise » de compréhension, et de fait la jurisprudence postérieure infirma cette position.
Sur le plan terminologique, malgré la qualification de droit de premier, second et troisième rang, ces droits sont tous qualifiés de « droits fondamentaux ».
En somme, il découle une stricte égalité juridique entre les droits fondamentaux
2/ Une égalité substantielle suggérée
La fondamentalité substantielle (ou « extra juridique »), c’est-à-dire le rang de la valeur attachée à tel ou tel droit en raison de son contenu. De part leur contenu, les droits fondamentaux ont une égalité de valeur. Ils disposent tous du caractère « fondamental ». Ces droits sont intimement liés, interdépendants et indivisibles. L’amélioration d’un droit facilite le progrès des autres. De la même manière, la privation d’un droit a un effet négatif sur les autres. Aussi, doit-on considérer que la fondamentalité n’est réservée à aucun rang normatif particulier. Elle ne s’épuise dans aucune norme formelle mais elle réside dans la valeur propre du droit concerné
Sur le plan des valeurs et formel, il n’existe pas de hiérarchie préétablie.
En revanche, le contentieux montre que plusieurs droits fondamentaux peuvent rentrer en concurrence.
B/ Une hiérarchie restreinte par la politique conciliatrice des juges
L’arbitrage permanent des principes constitutionnels en conflit (1/) permet d’écarter la thèse d’une hiérarchie formelle, mais de part la systématisation du CE (voir doc Jean-Marc Sauve), il peut apparaitre une hiérarchie matérielle (2/) dégagée de l’objet de la liberté en question.
1/ L’arbitrage permanent des principes constitutionnels en conflit
Selon la formule de G.Vedel, « le trésor des droits de l’homme s’accroit au long des siècles et des décennies mais aucune des gemmes qui le composent n’en est retirée pour faire place à une autre. Le juge constitutionnel est le gardien de ce trésor. Il doit accueillir de nouvelles richesses mais ne rien perdre des anciennes ». En l’espèce, le rôle conféré au CC et aussi a fortiori aux autres juges est ici bien résumé. 
La progressivité ne retire rien aux droits naturels, la crainte d’une absorption des droits de l’homme par les autres droits fondamentaux (Daniel Lévis) n’est plus ici justifiée et palliée par cette démarche.
Pourtant, une frange de la doctrine tout en reconnaissant qu’il n’existe pas de hiérarchie formelle, considère qu’à travers l’arbitrage du Conseil, il est assuré une protection et garantie différentes aux droits fondamentaux.
2/ Une hiérarchie matérielle en question
Une théorie de la hiérarchie matérielle des libertés fondamentale peut être établie si on s’attache à étudier l’ensemble des décisions du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’Etat. De part l’étendu et le degré de protection, on distingue une hiérarchie basée sur des critères réalistes. Dès lors, est encore une fois remis en cause la stricte égalité des droits fondamentaux. A titre d’exemple, G. Vedel nous informe que « le Conseil d’Etat module son contrôle en fonction de l’objet de la liberté en cause ». Cependant, il s’agit encore une fois d’évoquer l’approche de plus en plus pragmatique du Conseil Constitutionnel qui va dans le sens d’une absence de hiérarchie préétablie des droits fondamentaux. Après s’être heurté aux difficultés découlant des deux thèses en question. Il semble qu’une hiérarchie entre les droits fondamentaux est introuvable. Cependant, il est clair que certains d’entre eux comme le principe de la dignité humaine mérite d’être énoncés et de profiter d’une protection particulière du fait qu’il est matriciel mais potentiellement nocif pour les autres droits.
Le rôle laissé au juge est de réaliser un compromis entre les deux textes celui de 1789 et de1946, et de facto, il est fidèle au vœu des citoyens tel qu’il ressort de l’histoire des référendums entre 1946 et 1958.
Résumer avec l'IA :
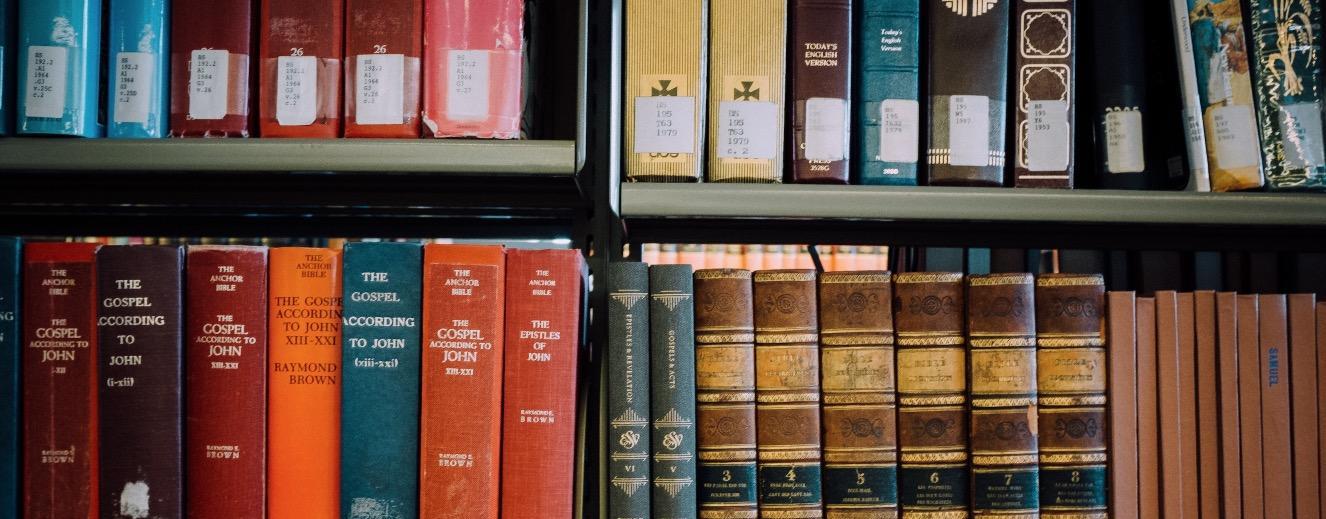






















Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !
Bonjour Professeur. Puis-je avoir svp la source référencée de la citation d’Etienne Picard? Merci.
Bonjour ! Nos professeurs sur Superprof sont prêts à vous offrir un soutien sur mesure pour vous aider à atteindre vos objectifs. N’hésitez pas à les contacter. Belle journée à vous !
Tres satisfait vous comment rester en contact avec vous?
Bonsoir, j’ai été satisfait. Merci
Comment procède t_on 0pour garder contact avec vous?
Bonsoir j’ai été satisfait. Merci