Chapitres
Une infraction a été commise : quelle sera la juridiction compétente pour traiter cette infraction ?
Cela veut dire quelle sera la juridiction d’instruction et quelle sera la juridiction de jugement compétente.
Plus largement on parle d’autorité compétente, ou de légitimité.
La solution est donnée par l’examen des règles de compétence.
C’est très important ces règles.
En effet si d’aventure une décision en matière pénale était rendue par une juridiction incompétente, elle serait illégale et donc annulée.
En matière pénale c’est ainsi très important ce jeu des règles de compétence et les règles sont toujours d’ordre public en matière pénal.
En effet elles ont été instituées dans un intérêt public, celui de la bonne administration de la justice.
Le fait que cette compétence en matière répressive revête un caractère d’ordre public entraine des conséquences tout à fait importantes.
- La première conséquence : les parties ne peuvent pas modifier le jeu des règles de compétence.
- Ensuite, autre conséquence : dès qu’une juridiction est saisie elle doit examiner sa compétence, et troisième conséquence : l’incompétence éventuelle d’une juridiction peut être relevée « en tout état de cause » c’est à dire à n’importe quel niveau de traitement de l’affaire.
On peut relever l’incompétence en appel, si l’on s’en est pas rendu compte avant.
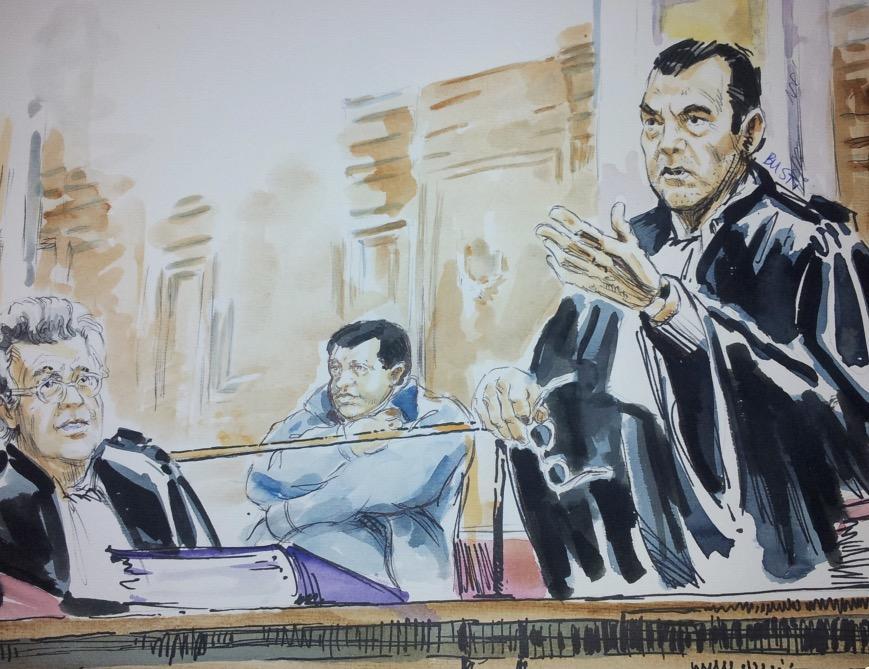
Dès lors, la répartition des affaires va s’effectuer selon certaines règles, ceci étant il ne faut pas qu’il y ait trop de rigidité.
Il y a ainsi des aménagements possibles qui parfois vont revêtir une importance assez grande, et à certains moments on parlera même de dérogations.
Si l’on applique la règle en matière trop rigide on ne peut pas rendre la justice.
Parfois il faut aménager pour atteindre le but : rendre la justice à celui ou celle qui le demande ou le nécessite.
Parfois des conflits de compétence : comment on va régler ce conflit.

Les principes de la compétence pénale
Il y a un préalable à ne pas oublier : l’infraction doit relever de la compétence interne des juridictions répressives françaises.
Si l’infraction a été commise en France, on applique le principe de la territorialité.
Si c’est commis sur le territoire de la république : c’est l’hexagone, mais aussi la corse, les DOM TOM, les aéronefs de la compagnie nationale.
Mais en plus, il y a un article dans le code pénal, 113-2 qui parle de ce principe de la territorialité, l’alinéa 2 dit « l’infraction est réputée commise sur le territoire de la république dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur l’un de ses territoires ».
Arrêt de la chambre criminelle du 15 novembre 2005 qui avait appliquait le principe de territorialité quand il y avait rejet d’hydrocarbures dans les eaux territoriales françaises.
Si l’infraction a été commise à l’étranger, on pourra dans certains cas appliquer un autre principe : on pourra appliquer le principe de personnalité. Renvoi à l’article 113-6 du code pénal. En effet la loi française est applicable à tout crime commis par un français hors du territoire de la république.
Mais aussi à tout délit à condition que les faits en question, constitutifs de ce délit, soient également réprimés dans le pays en question. Pour les délits on demande ce que l’on appelle « la réciprocité d’incrimination ».
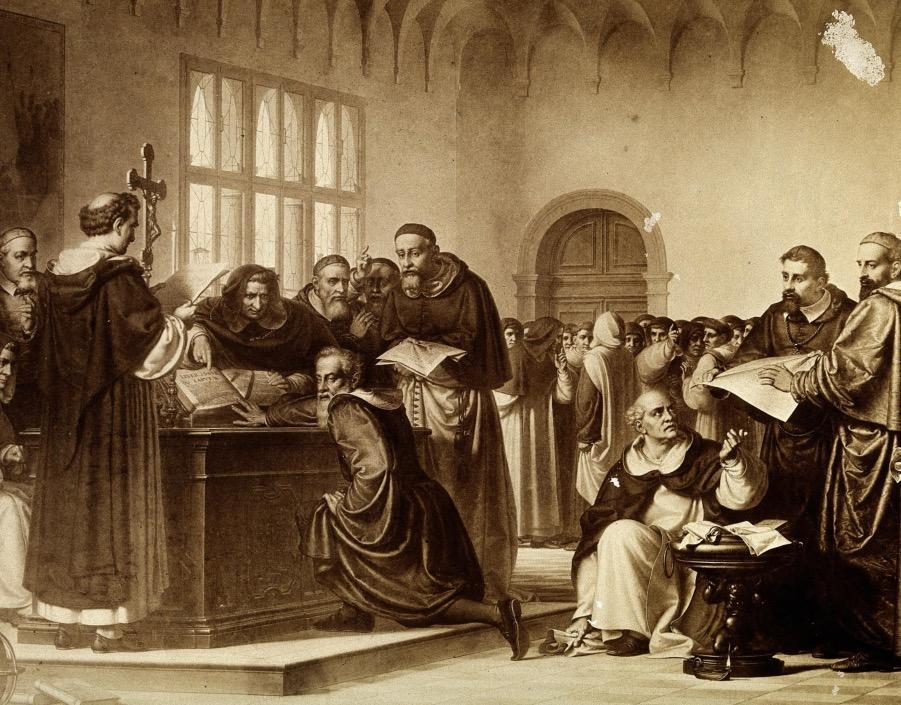
La possibilité de juger en France une infraction commise à l’étranger : c’est notamment dans le domaine du tourisme sexuel.
Normalement pour qu’on puisse juger en France, une infraction commise à l’étranger, il faut qu’il y ait une plainte de la victime, sauf quand la victime est mineure.
La loi Française pourra également être applicable si la victime est française. C’est l’article 113-7 du code pénal. Si on est victime à l’étranger d’une infraction on pourra demander que l’affaire soit jugée par nos juridictions.
Et enfin un autre type de situation : La Compétence universelle.
La compétence du juge français pour certaines infractions très graves, découle de conventions internationales. C’est le cas en matière de torture, de génocide. Ce sont des infractions très graves, infractions qui ont été définies dans une résolution signée en 1933, votée à Palerme, qui parle d’infraction qui blesse les intérêts communs de tous les Etats.
Une fois évacué tout ce préalable, on est certain que l’infraction peut être jugé par les juridictions françaises. Reste désormais à savoir quelle sera la juridiction compétente pour connaître de l’affaire en question.
Pour déterminer la compétence on peut faire référence à trois types d’éléments : la situation personnelle du délinquant, là on va parler de compétence personnelle, ensuite on peut faire référence à la gravité des faits commis, là on parlera de compétence matérielle, et ensuite on peut faire référence à la localisation géographique des faits.
On peut aussi faire référence à la localisation géographique du délinquant.
Là on parle de localisation géographique et de compétence territoriale.
Retrouvez tous nos cours de droit constitutionnel.
La compétence personnelle
La compétence personnelle : on fait référence là à la situation personnelle du délinquant, au moment où il a commis les faits. On va prendre certaines caractéristiques en compte. Dans la DDHC, on trouve l’article 6 qui dit « la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
Il y en a qui ne sont pas d’accord. On ne peut pas être d’une rigidité extrême sinon on obtient l’effet inverse que celui recherché, donc il faut des aménagements.
Le droit pénal fera ainsi référence à la qualité de la personne, existent ainsi des juridictions d’exception.

On pourra faire référence ici tout d’abord à l’état de minorité au moment des faits. Ensuite si la personne est majeure il peut aussi y avoir des situations dérogatoires : la personne peut être un militaire, dans ce cas il sera jugé par des juridictions spécialisées en matière militaire.
L’article 697-1 du code pénal, alinéa 3, parle des militaires.
Ensuite les politiques, pour le PDR il y a la haute cour de justice, et pour les ministres, ils ont la qualité de politique et seront jugés par la cour de justice de la république.
Où trouver des cours de droit pénal ?
La compétence matérielle
Là on va se référer à la nature de l’infraction : on va regarder quels sont les faits poursuivis. On a une détermination de la compétence objective. Ici il faut différencier la ventilation générale et ensuite quelques aménagements
La ventilation générale
En cours de droit, on va regarder la gravité des faits.
S’il s’agit d’une contravention : compétence du Tribunal de police, voir de la juridiction de proximité
S’il s’agit d’un délit : compétence du tribunal correctionnel. Sauf si le délit est très rattaché à un crime.
Les crimes : ils relèvent de la Cour d’assise.
Les aménagements apportés à cette ventilation objective
Il y a des aménagements apportés par le législateur compte tenu de la spécificité de certaines infractions. L’exemple type est le terrorisme. Là on va se référer aux mobiles. Le mobile peut être pris en compte pour aggraver la répression, comme dans le cas du terrorisme.
Là on aura une Cour d’assise spéciale.
La compétence territoriale
Une fois que l’on a décidé quelle serait la juridiction compétente, il faudra désigner précisément la juridiction chargée de traiter l’affaire : le tribunal correctionnel de Bayonne ou le TC de Pau ?
Les règles applicables : D’abord on se réfère a la circonscription géographique.
Le plus simple est de faire juger l’affaire dans la juridiction de laquelle ont été commis les faits. Ca peut être aussi l’endroit où le délinquant a été capturé. Là aussi on va avoir un critère opérationnel. Si il doit y avoir un transfert, cela a des coûts, et risque d’évasion.
Pour les personnes morales on a des règles différentes : ca peut être le lieu de l’infraction ou le lieu où la personne morale a son siège. Si dans une affaire on poursuit la personne morale et le dirigeant on regarde quelle est la juridiction compétente pour le dirigeant, et après automatiquement la personne morale sera jugée par la même juridiction.
Il y a aussi des aménagements pour être plus efficace, pour que la justice soit mieux rendue.
Et c’est ainsi que l’on a des extensions de compétence : les affaires de terrorisme, en matière aussi économique et financière. Il faut des juges spécialisés, des experts comptables. Egalement on a vu d’autres dérogations notamment en matière d’infractions à la santé publique.
En matière de santé publique, relatif aux droits des malades : loi du 4 mars 2002.
En matière d’infractions sanitaires il faut là aussi des magistrats spécialisés.
Toutes ces règles sont dans la partie procédure spécifique du Code pénal.
En matière d’hydrocarbures : article 706 du code pénal.
Où trouver des cours droit du travail ?
Les dérogations aux règles de compétence
On va se trouver ici dans la situation où une juridiction répressive va connaître d’un procès, d’une affaire, dont normalement elle ne devait pas connaître. Cela veut dire que si les règles de compétences avaient été appliquées à la lettre elle n’aurait pas du connaître de cette affaire, or elle va en connaître. Ainsi on va voir que certaines situations vont entrainer une modification des règles normales de compétence.
Il y a essentiellement trois types de dérogations :
La prorogation de compétence
Prorogation de compétence signifie accroissement de la compétence d’une juridiction à raison des faits commis. On va pouvoir accroire la compétence d’une juridiction.
Pourquoi ?
Pour assurer une meilleure efficacité de la justice.
On va éviter les pertes de temps et d’énergie.
On dit ainsi que dans cette hypothèse il y aura jonction des procédures.
Les cas de Jonction des procédures
- La connexité (question à l’oral fréquente) : il en est question à l’article 203 du Code de procédure pénal. Cet article délimite les cas de connexité. Le code envisage 4 hypothèses : d’abord ce que l’on peut appeler l’unité de temps et de lieu. Imaginons des infractions commisses en même temps par des personnes réunies, on va rassembler tout cela.
L’unité de dessein c’est à dire l’unité de pensée criminelle : dans ce cas c’est par exemple des infractions commises dans des lieux différents par des personnes différentes, mais à la suite d’un concert et d’un projet commun.
Ensuite autre hypothèse : la relation de cause à effet. On assome le gardien pour s’évader par exemple.
Et ensuite le code parle d’une chose spécifique : le recel de choses.
Le recel est différent du vol, le recel est « tirer bénéfice de la chose ». Le recel est connexe du vol.
l’indivisibilité : Article 382 alinéa 3. Là on est face à un ensemble de faits qui constituent chacun une infraction autonome mais qui ont des liens très étroits entre eux et c’est pour cela que l’on parle d’indivisibilité.
Par exemple c’est le faux qui a été commis dans la perspective d’une escroquerie.
Les effets de la prorogation
Les conséquences sont les mêmes : il y a jonction des procédures.
Parfois les affaires jointes, étaient de juridictions différentes. Si juridiction de droit commun et juridiction d’exception, c’est la juridiction de droit commun qui l’emporte. S’il y a des différences de niveau, c’est la juridiction la plus élevée qui est compétente.
Cette connexité a des effets aussi sur le cours de la prescription : si la prescription s’interrompt pour l’une elle s’interrompt aussi pour l’infraction qui est rattachée.
Les exceptions préjudicielles
Préjudiciel ne vient pas de préjudice mais de préjudicium, c’est à dire « exception avant le jugement ».
Là il y a un problème relatif aux exception préjudicielles simple. Imaginons que lors d’une procédure pénale se pose une question d’u autre domaine du droit.
Est ce que cette question qui relève peut être du droit civil, administratif, pourra t’elle être résolue par le juge répressif lorsqu’il procède à cette qualification des faits.
La loi à l’article 384 du CPP fixe un principe mais elle prévoit aussi des possibilités d’exception, et des limites au principe en question.
Besoin de cours droit des affaires ?
Le principe
le principe on peut le résumer par un adage : « le juge de l’action est juge de l’exception ». L’énoncé de ce principe on le trouve au début de l’article 384 : le tribunal saisit de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense à moins que… (là ce seront les exceptions ensuite).
Ensuite depuis le nouveau code pénal, le juge répressif tient du législateur la possibilité d’apprécier la légalité des règlements administratifs.
C’est ce que dit l’article 111-5 du code pénal : « lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis ».
Autorise les juridictions pénales à se faire juge.
Le juge pénal peut soulever d’office l’illégalité du règlement.
Des cours de droit administratif pourront vous aider à mieux comprendre le droit.
Les limites de ce principe : les exceptions préjudicielles
Article 384 : « …a moins que la loi n’en dispose autrement ou que le prévenu n’excipe un droit réel immobilier ». Ainsi on va voir qu’il y aura différents cas d’exceptions préjudicielles. Le régime juridique de ces exceptions sera le même.
On peut avoir des exceptions préjudicielles tout d’abord de nature civile. C’est ce qui est cité par le législateur quand on parle de droits réels immobiliers. Si la question porte sur un Droit réel immobilier, le juge pénal ne pourra pas trancher, il devra alors saisir le juge civil.
En matière civile, il y a aussi des cas en matière d’état des personnes. ex : un individu fait l’objet d’un arrêté d’expulsion qu’il ne respecte pas et avance l’argument qu’il est français. Il faut saisir le TGI.
Ensuite il peut y avoir des exceptions de nature pénale. Le juge pénal devrait pouvoir juger mais il y a parfois au cours des débats une question qui se pose, question qui va relever d’une autre juridiction pénale que celle qui était saisie.
Par exemple en matière de diffamation. Le diffamateur ne pourra être jugé qu’après qu’il ait été tranché sur les faits diffamatoires en question. Idem en dénonciation calomnieuse : il faut savoir si les faits dénoncés étaient vrais ou faux.
Ensuite parfois il y a des exceptions préjudicielles en matière administrative : par exemple un comptable est poursuivi pour détournement de deniers publics. Avant de juger cet individu il faut que l’on constate bien qu’il y ait un déficit dans les deniers publics. Ce n’est pas le juge répressif qui peut regarder cela. Cela relève du droit administratif.
Le régime de l’exception préjudicielle
Tout le régime on le trouve à l’article 386 qui indique qu’il y a des conditions de fond. Il faut présenter la question avant toute défense au fond. Elle doit être ensuite vraisemblable. Et elle doit être aussi valable, c’est à dire qu’elle doit être susceptible de produire un effet.
Il y a à côté de ces conditions de fond, des conditions de forme. Il faut interroger une autre juridiction donc là le tribunal impartira un délai au prévenu pour qu’il saisisse la juridiction compétente. La réponse donnée par la juridiction compétente s’imposera. Le juge pénal doit juger en fonction de la réponse.
Mais si l’individu ne saisit pas la juridiction compétente pendant le délai imparti une fois que le délai est passé le tribunal va juger comme si qu’aucune exception n’avait été soulevée.
- le Renvoi
Le Renvoi en droit pénal : le renvoi a pour objet d’ôter une affaire à une juridiction déjà saisie pour la confier à une autre du même ordre. Donc le renvoi va avoir pour conséquence de modifier le jeu des règles normales de compétence territoriale. Une affaire devait être jugé a Bastia et finalement on va la juger a Grenoble par exemple.
Le renvoi ne peut être accordé que par la chambre criminelle qui désigne elle même la juridiction qui sera compétente. Le renvoi s’applique à une juridiction, mais ne s’applique pas à un magistrat nommément désigné. Plusieurs hypothèses :
- la suspicion légitime
Article 662, alinéa 1 : on parle de suspicion légitime lorsque certains éléments font douter de l’impartialité des juges. La procédure de suspicion légitime ne peut s’appliquer qu’à une juridiction et pas au ministère public.
- la sûreté publique
Article 665 alinéa 1.
On va enlever une affaire à une juridiction car le procès qui concerne cette affaire peut entrainer des troubles ou des scènes de désordre.
- l’intérêt d’une bonne administration de la justice
Article 665 alinéa 2
Là on va permettre à la justice d’être sereine dans une affaire parfois sensible, quand elle suscite une certaine émotion, cela va empêcher les juges de travailler sereinement. Par exemple la délocalisation de l’affaire Betancourt.

On peut juger un détenu à un autre endroit lorsque risque d’évasion.
La délocalisation est une mesure assez lourde décidée par la Cour de cassation. Une loi du 23 Juin 1999 a assouplie cette procédure et permet le renvoi limitrophe : c’est le PDT de la Cour d’appel qui décide.
Ces dérogations sont importantes mais parfois il peut y avoir quelque chose de plus important : les conflits de compétence.
Les conflits de compétence
Il peut y avoir deux types de conflits :
- conflits de compétence des juridictions judiciaires (car aucune ne veut connaître de l’affaire souvent) : dans ce cas il y a deux démarches prévues par le code de procédure pénale. D’abord dit qu’il faut procéder à un règlement amiable : article 657 du code de procédure pénale. Mais parfois le règlement amiable n’aboutit pas alors il y a une procédure imposée : le règlement de juge. On a les informations des articles 657 à 661. Le règlement de juge est la procédure par laquelle une juridiction supérieure tranche le conflit existant. Le conflit doit être géré et résolu par la juridiction supérieure commune aux deux juridictions en conflit. Si on a un conflit entre un juge d’instruction de Bayonne et un de Toulouse : CA différente donc la juridiction commune supérieure sera la chambre criminelle de la cour de cassation : article 659 du code de procédure pénale.
- Conflit des ordres juridictionnels : Là on va avoir un conflit de nature différente. On va avoir autorité judiciaire et autorité administrative qui sont en conflit. Ou elles se rejettent une affaire, ou plus souvent elles se disputent une affaire. Ordre judiciaire et administratif veulent être compétents, par exemple pour un fonctionnaire. C’est un conflit qui touche à la séparation des pouvoirs. C’est le tribunal des conflits qui va gérer le conflit.
C’est le préfet qui va demander au juge judiciaire de se dessaisir par un déclinatoire de compétence. Si la juridiction judiciaire refuse la demande du préfet c’est là que le préfet pourra saisir le Tribunal des conflits, par un arrêté de conflit. Quand il est pris, la juridiction judiciaire est obligée de sursoir à statuer.
Cette procédure est limitée : En ce qui concerne la nature des faits le conflit pourra toujours être élevé sauf dans deux cas : dans deux cas on va considérer en effet que l’intérêt de la répression est supérieur aux principes de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Ces deux cas sont : les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque.
Et peut importe que l’auteur ou la victime soit un fonctionnaire.
Ensuite, le conflit ne peut jamais être élevé dans les cas d’atteinte à la liberté d’individuelle : Article 136 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Par exemple si un magistrat commet une violation de domicile, cela relève du tribunal judiciaire.
L’article 66 de la Constitution dit que le juge judiciaire est garant de la liberté individuelle.
L’article 136 alinéa 3 est est le prolongement pénal de l’article 66 de la Constitution qui dit que le juge judiciaire est garant des libertés individuelles.
Résumer avec l'IA :























Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !
Étudiant en Master 2 droit pénal et les sciences criminelles. Je suis personnellement satisfait des éléments de compréhension par à cet article 👍
bonjour
je m’appelle Raherisoa et je suis un étudiant en L1 droit
je me demandais si vous pouvez me donner les conditions de validité d’une sentence arbitrale et des exemples d’arbitrage nationaux et internationaux merci d’avance
Étudiant en Master 2 droit pénal et les sciences criminelles. Je suis personnellement satisfait des éléments de compréhension par à cet article 👍