Chapitres
- 01. La notion de cause réelle et sérieuse
- 02. La réalité du motif (cause existante et exacte)
- 03. Le sérieux du motif
- 04. La cause sérieuse non fautive
- 05. La preuve de la cause réelle et sérieuse
- 06. La sanction des licenciements nuls ou injustifiés
- 07. Le régime dérogatoire : la nullité
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.


La notion de cause réelle et sérieuse
La réalité du motif (cause existante et exacte)
Signifie que le motif doit être objectif. Le contentieux est peu abondant sur cette question contrairement à celui relatif au sérieux du motif qui est plus subjectif. Malgré la volonté de la cour de cassation d'objectiver le licenciement, elle n'exerce en principe sur l'existence d'une CRS qu'un contrôle limité à la motivation des juges du fond. Toutefois, en cas de licenciement pour perte de confiance ou pour des faits tirés de la vie privée du salarié, la cour de cassation va exercer un contrôle renforcé sur cette cause objective de la rupture du contrat. 
Arrêt du 29 novembre 1990 de la chambre sociale (dalloz 1991, PELISSIER page 190) : modification radicale de la jurisprudence.
Le sérieux du motif
Les différents types de faute
La faute légère n'est pas une cause sérieuse de licenciement : la répétition de cause légère peut les transformer en faute plus grave.
Les fautes qui sont susceptibles de justifier un licenciement sont de 3 types : la faute sérieuse, la faute grave, la faute lourde.
- La faute sérieuse justifiera un licenciement sans priver le salarié de ses indemnités ni de son préavis.
- La faute grave est un comportement inadmissible du salarié qui rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La différence avec la faute sérieuse est que le salarié est privé d'indemnités et de préavis : ne doit pas passer un jour de plus après le respect de la procédure dans l'entreprise. Ex : vol du salarié, harcèlement en particulier sexuel. Importance d'utiliser la mise à pied conservatoire à ce moment là pour montrer au salarié qu'il ne doit pas rester dans l'entreprise mais pas mise à pied disciplinaire car faute pas sanctionnée deux fois. Depuis un arrêt du 2 février 2005, la cour de cassation a apporté une précision : un employeur licencie un salarié pour faute grave tout en lui octroyant une indemnité « équivalente à l'indemnité de préavis » hors la faute grave est privative d'indemnité de préavis donc le salarié a réclamé en plus des indemnités de licenciement. La cour de cassation a répondu que le versement d'une somme « équivalente » ne prive pas l'employeur de son droit d'invoquer une faute grave. C'est au juge de qualifier la faute, ce n'est pas à l'employeur de le faire dans sa lettre. La faute grave est la seule qui permet la rupture anticipée d'un CDD ou de licencier une femme enceinte dès lors que la faute n'est pas liée à l'état de grossesse / dès lors que le motif du licenciement n'est pas lié à l'état de grossesse.
- La faute lourde est très rare : il n'y a pas avec la faute lourde un degré de gravité supplémentaire car la faute lourde est la faute commise avec l'intention de nuire à l'employeur. Ex : la cour de cassation a considéré que le fait de permuter l'étiquette d'une bouteille de whisky pour le payer moins cher n'est pas une faute lourde. La faute lourde caractérise l'intention de nuire à l'employeur : détérioration du matériel de l'entreprise, virus introduit dans un logiciel pour se venger de l'employeur.
Le harcèlement sexuel est plus grave que de détruire un ordinateur donc n'est pas plus important. Le salarié perd toutes ses indemnités : celles de licenciement, indemnité de préavis et indemnité de congés payés. L'indemnité de congés payés n'est pas une véritable indemnité : si les congés n'ont pas été pris, payés sous forme d'indemnité. En cas de faute grave, le salarié ne les perd pas mais avec la faute lourde, si : la cour de cassation dit que le salarié, lorsqu'il a commis une faute lourde, a nécessairement commis un préjudice à son employeur et le fait de ne pas les payer : façon de réparer ce préjudice. Avec la faute lourde, on perd tout. En droit du travail, contrairement au droit commun, seule la faute intentionnelle de l'employé permet à l'employeur de rechercher sa responsabilité civile : arrêt de la chambre sociale du 19 mars 2003 : concernait le réceptionniste d'un hôtel qui avait emprunté la voiture d'un client pour la nuit et avait eu un accident : la CA avait condamné le salarié à rembourser car faits étrangers au contrat. La cour de cassation se place sur le terrain contractuel et reproche aux juges de n'avoir pas caractérisé l'intention de nuire : est-ce que intention de nuire du salarié ici ? Non : « la responsabilité du salarié n'est engagée qu'en cas de faute lourde ». La cour de cassation reconnaît de moins en moins de fautes graves aujourd'hui, sauf harcèlements moral et sexuels, propos racistes, vols. Pour ne pas avoir à verser les indemnités (licenciement, préavis et congés payés) de rupture, certains employeurs licenciaient systématiquement pour faute grave et comptaient sur l'inaction judiciaire des salariés (le contentieux prudhommal : 2/3 concernent le licenciement). Si l'employeur licencie pour faute grave et que le salarié fait une action en justice, le juge disait que cause réelle et sérieuse mais pas faute grave donc l'employeur versait les indemnités. Ces stratégies ont poussé la cour a retenir de moins en moins de fautes graves : comportement qui rend impossible le maintien de l'employé dans l'entreprise. Une faute sera qualifiée différemment selon l'ancienneté du salarié et selon le passé professionnel (qui peut être irréprochable).
- Différence entre la faute grave et la faute sérieuse : faire préavis ou pas.
- Différence entre faute grave et faute lourde : intention de nuire ou pas.
La cause sérieuse non fautive
C'est une question importante avec une actualité jurisprudentielle soutenue. Sans faute, la situation d'un salarié peut perturber le bon fonctionnement de l'entreprise et justifier son licenciement : inaptitude physique et insuffisance professionnelle. Parmi les causes sérieuses non fautives, on pourrait ajouter le licenciement économique.
Le rôle du juge est de vérifier l'absence d'abus de droit et de détournement de pouvoir.
Le juge vérifiera que l'employeur a satisfait à la bonne formation du salarié pour assurer leur employabilité. 
Ex : agent de surveillance dans une entreprise qui pendant ses congés vient dans l'entreprise en tant que client et vole de la marchandise car connait toutes les ruses : la cour de cassation dit que ses agissements bien qu'étrangers à ses activités professionnelles rendaient impossibles la poursuite de son contrat pendant son préavis : faute contractuelle même si agissements en l'absence du temps de travail.
Un salarié ne peut être licencié pour un motif tiré de sa vie privée que si est repéré par les juges du fond un trouble caractérisé au sein de l'entreprise.
La cour de cassation, de ce point de vue a radicalement changé de cap à partir d'un arrêt du 17 avril 1991 : PAINSECQ : cet arrêt a annoncé l'article L 1121-1 du code du travail : nul ne peut porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux du salarié, sauf... avant cet arrêt, la cour avait accepté le licenciement d'une enseignante d'un lycée catholique (avait divorcé et s'était remariée) parce qu'elle n'avait plus la communion de pensée et de foi avec son employeur et l'esprit de l'institution : arrêt de 1986. Un boucher salarié, deux après le début de son contrat de travail avait refusé de manipuler de la viande de porc en raison de convictions religieuses : licencié et invoque le non respect de sa vie privée et la cour de cassation a voulu mettre un coup d'arrêt à ces pratiques : « sauf clause express, les convictions religieuses n'entrent pas dans le contrat de travail et l'employeur ne commet pas de faute en demandant au salarié d'effectuer la tâche pour laquelle il a été employé ».
La frontière de la subordination est très délicate et c'est le problème majeur.
Dernières questions : ce que l'on consomme chez soi : drogue, alcool.
Arrêt du 22 novembre 2002 : MATHSEN contre Danemark : garçon de cabine qui refusait de subir un test de dépistage au cannabis. La CEDH juge indispensable à la sécurité d'un ferry que le personnel puisse s'acquitter de ses fonctions de sauvetage. Arrêt où un conducteur de bus fait le pari qu'il va faire son trajet en moins de 30 minutes. Les contrôles d'alcoolémie prévus dans le règlement intérieur sont licites.
La preuve de la cause réelle et sérieuse
Contrairement au droit commun où la charge de la preuve pèse sur le demandeur, la loi de 1973 a décidé en raison des difficultés de preuve pesant sur le salarié de confier la recherche de la vérité au juge comme en droit pénal puisque l'article L 1235 1 du code du travail : « le juge doit former sa conviction, au besoin après une instruction ». Il n'y a pas renversement de la charge de la preuve, elle est juste administrée en faveur du juge.
Le doute profite au salarié donc le licenciement sera dénué de CRS et coûtera cher à l'employeur.
La sanction des licenciements nuls ou injustifiés
Il y a deux types de conséquences en l'absence de CRS : une conséquence indemnitaire et un régime dérogatoire qui est celui de la nullité. Les conséquences indemnitaires : il faut distinguer le cas des entreprises employant plus de 10 salariés et le cas des salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté : article 1235-3 1e du code du travail qui dispose que le tribunal peut proposer la réintégration (ne peut pas l'ordonner) aux salariés ou à l'employeur mais le taux est très faible en pratique et à défaut de réintégration, indemnités d'au moins 6 mois de salaires brut. Cette solution s'expliquait à l'époque où la durée moyenne du chômage était de 6 mois : aujourd'hui, la durée serait de 7 mois même si cela est surprenant. Le pouvoir souverain d'appréciation des juges peut entrainer des conséquences dramatiques : un salarié qui est resté 2 semaines au chômage a obtenu 30 mois de salaire. Les entreprises employant moins de 11 salariés ou pour les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté (moins grave si licencié peut être ?), le salarié devra prouver un préjudice : n'a pas droit à 6 mois de salaire minimum. Ici, les indemnités peuvent se cumuler avec celles de la procédure irrégulière.
Le régime dérogatoire : la nullité
La solution de principe est dictée par un arrêt du 28 mai 2003 : sans texte, il n'y a pas de nullité. Aujourd'hui, la cour de cassation n'admet la nullité réintégration que dans les cas où une liberté publique est en jeu ou en présence d'un texte express. Progressivement, les textes se sont étoffés : lors d'un licenciement d'un représentant du personnel, lors du licenciement d'un salarié gréviste pour fait de grève, pour un licenciement d'un salarié syndical, d'une femme enceinte. Désormais, tout salarié dont le licenciement est nul (pas sans CRS), a droit à la réintégration et s'il n'use pas de ce droit, il a droit à une indemnisation prévue par l'article 1225-71 du code du travail. Ces licenciements précités ne sont pas dénués de CRS, ils sont nuls de plein droit, ils sont censés n'avoir jamais existé. Il faut distinguer 2 hypothèses de licenciement fautif :
- les licenciements irréguliers (procédure légale qui n'a pas été respectée) et salarié a le droit au maximum à un mois de salarié et dans un arrêt du 29 juin 2005, la cour de cassation a décidé qu'en cas de violation non pas de la procédure légale mais de garanties procédurales conventionnelles, le licenciement prononcé est dépourvu de RCS, s'agissant de conditions de fond (ex : pas de motif de licenciement dans une lettre de notification les licenciements non fondés sur CRS : 6 mois de salaire minimum
- le licenciement nul : depuis l'arrêt du 28 mai 2003, la nullité ne peut être prononcée qu'en présence d'un texte ou de violation d'une liberté fondamentale donc la liste n'est pas très claire. Ici, la sanction de ce licenciaient nul varie selon que le salarié demande ou non sa réintégration. La cour de cassation utilise le terme de « réintégration » mais la rupture est censée n'avoir pas existé. S'il ne demande pas la réintégration : chambre sociale du 2 juin 2004 : le salarié dans ce cas a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité résultant du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de CRS, et « en toute hypothèse » à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire (pas lieu de distinguer selon les seuils).
Résumer avec l'IA :
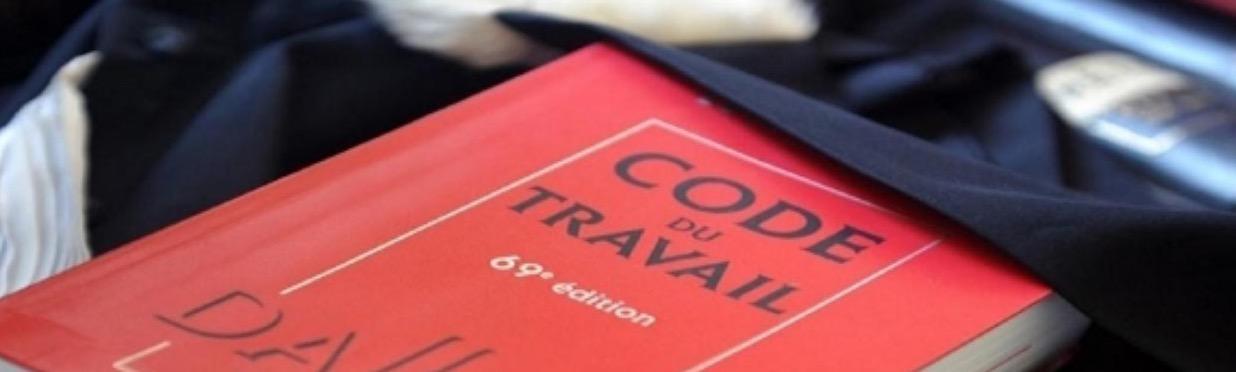






















Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !