Chapitres
Les controverses doctrinales sont nombreuses. On peut distinguer deux écoles différentes :
- Les théories volontaristes selon lesquelles l’existence et le fondement du droit international résident dans la volonté de l’Etat.
- Les théories objectivistes qui placent, quant à elles, la raison de la force obligatoire du droit international dans des éléments extérieurs à la volonté de l’Etat.

Les faiblesses de la doctrine volontariste
Définition
Pour les tenants du volontarisme juridique, la validité de la règle de droit est engendrée par la volonté du pouvoir.
Donc la validité du droit s’explique parce qu’il est l’œuvre de l’Etat considéré dans sa volonté comme une personne supérieure aux individus. Dans la mesure où la validité juridique découle de la volonté étatique, on peut se demander alors comment il est possible de reconnaitre que telle ou telle règle est conforme à la volonté étatique ? Les règles positives fondées sur la volonté de l’Etat sont des règles valables en tant qu’elles ont été régulièrement formées par les organes de l’Etat habilités à exprimer sa volonté. Cette théorie qui est très formaliste place le fondement du droit dans le respect des règles de compétence et de procédure. Au total, la force obligatoire du droit international va reposer sur la volonté de l’État souverain. Comment un État souverain peut-il s’obliger uniquement par sa volonté ? 
Illustrations
La théorie de l’autolimitation
Théorie développée par des juristes allemands à la fin du 19°s : JHERING et JELLINEK Selon ces auteurs, l’État souverain ne peut être lié par le droit que s’il y consent. L’État de par sa volonté créatrice de droit peut donc accepter de s’autolimiter en créant précisément le droit international. Cette auto limitation est accepté par l’État parce qu’elle est conforme à ses propres intérêts. Deux conséquences :
- Lorsque l’Etat n’a pas limité son pouvoir il est libre d’agir
- L’Etat qui a limité sa liberté d’action par sa propre volonté peut modifier cette limitation.
La théorie de la fusion des volontés (« Vereinbarung »)
Inventée par TRIEPEL à la fin du 19°siècle. Selon lui, « le droit international est bien crée par la volonté de l’Etat mais il ne résulte pas des volontés isolées des Etats.
Le droit international résulte de la volonté commune des Etats ».
Il distingue la Vereinbarung véritable union des volontés du simple contrat qui formalise certes l’accord de plusieurs personnes mais qui en fait est la rencontre de volontés différentes. Cette Vereinbarung peut se manifester de façon express par la voie des traités internationaux ou de façon tacite par la coutume internationale étant entendu que le droit international qui est ainsi créé n’oblige que les participants.
La critique
En ce qui concerne l’auto-limitation, si on peut admettre que l’État puisse s’engager à s’autolimiter, le fondement du droit international reste fragile car rien ne vient garantir qu’une nouvelle manifestation de volonté de l’État ne viendra pas anéantir la première. Donc la volonté peut créer une règle mais la règle ne lie pas à la volonté. Donc le caractère obligatoire de la règle étant lié à la volonté du pouvoir, il est indéniable que le résultat juridique d’une volition (=acte par lequel une volonté se détermine), une autre volition pourra le défaire. Idem pour la fusion des volontés : de même que l’État peut se lier par une Vereinbarung, il peut s’en retirer par sa volonté. En conclusion, ces théories ne sont pas satisfaisantes parce qu’elles sont impuissantes à expliquer le caractère obligatoire du droit international. De plus, ériger la volonté de L’État souverain en source unique du droit international reviendrait au fonds à ériger l’anarchie.
Or, la pratique montre que la volonté de l’Etat ne peut pas tout.
Les Etats sont limités dans leur volonté parce qu’ils ne sont pas seuls. De plus, le « jus cogens » (c’est la transposition de la notion d’ordre public dans la société internationale) vient nécessairement limiter l’émission de certaines règles par les Etats.
Les hésitations de la doctrine objectiviste
Pour les objectivistes, le fondement du droit international repose sur un élément extérieur à la volonté de l’Etat. La doctrine diverge quant à la nature de cet élément. Certains parlent de droit naturel, d’autres vont parler d’une norme fondamentale, d’autres des nécessités de la vie sociale.
Le droit naturel
Rappelons l’apport de Vittoria et Suarez qui fondaient l’existence du droit international sur le droit naturel. Puis il y a eu l’apport de Grotius qui a contribué à la laïcisation du droit naturel d’une part, et, d’autre part, il a établi une distinction entre droit volontaire et droit naturel. Le droit volontaire ne pouvait procéder valablement des volontés étatiques qu’en vertu d’un principe de droit naturel à savoir la règle « pacta sunt servanda » (= la promesse lie, engage). A l’époque contemporaine, d’autres auteurs que l’on va appeler néo-naturaliste reprennent cette distinction en tentant d’y apporter des améliorations. Pour lutter contre la subjectivité du droit naturel, celui-ci est défini par les néo-naturalistes par l’application de la justice aux relations internationales. Le terme justice est entendu comme faisant partie du « monde objectif des valeurs étiques ». Cette justice on la constate par « l’expérience et grâce à ses sens spirituels ». Il a fallu éviter que le droit naturel ne devienne une sorte de recueil, de préceptes moraux suffisamment souples pour s’adapter à la diversité des cultures dans le monde. Certains auteurs ont tenté de définir le droit naturel en quelques grands principes : on en trouve deux : le « pacta sunt servanda » et l’obligation de réparer tt préjudice injustement causé. Cette construction a été consacrée en partie par le droit positif qui a intégré certaines valeurs morales comme par exemple le principe de bonne foi ou le droit naturel de légitime défense. La critique : l’idée d’un système juridique complet fondé sur le droit naturel peut paraitre insatisfaisante parce que le droit naturel ne peut pas remplir le rôle social d’un Etat. Autrement dit, le seul appel aux valeurs morales peut paraitre insuffisant quand l’objectif est de fonder une règle de droit parce qu’à côté des facteurs idéalistes il existe des nécessités sociales.
Le normativisme
Kelsen et les tenants de l’école de Viennes (Merkl, Verdross, Kunz) en sont les représentants. Ils ont tenté de fonder une théorie pure du droit. Kelsen qui est positiviste s’est employé tout d’abord à nier l’idée d’Etat en tant que personne morale supérieure douée de volontés. La personnalité de l’Etat étant une fiction, celui-ci est tt simplement assimilé à un système de normes, un ordonnancement juridique. Il a formalisé ensuite la théorie de la pyramide juridique selon laquelle toutes les normes juridiques sont ordonnées, hiérarchisées. Chaque norme tirant sa validité d’une norme supérieure et donnant sa validité à une norme inférieure étant entendu qu’au sommet de la hiérarchie se trouve une norme suprême fondamentale qui est le fondement du système tout entier. Pour l’ordre juridique interne, la norme fondamentale est la constitution. Dans l’ordre juridique international, la validité du droit conventionnel (=traités) repose sur le principe pacta sunt servanda qui est un principe de droit international coutumier.
Le droit conventionnel est subordonné au droit coutumier.

Le positivisme sociologique
Cette doctrine a été illustrée par des auteurs comme Duguit et Scelle. Elle se rattache aux travaux de Durkheim. Au départ, Duguit reprend cette loi sociologique : « L’Homme ne peut vivre qu’en société ». A ce titre, il doit donc suivre les règles rendues nécessaire par cette vie sociale. En effet, une transgression de ces règles entraine une rupture de la solidarité sociale c'est-à-dire un désordre social. Ce désordre provoque à son tour une réaction sociale et lorsque cette réaction prend la forme d’une sanction, on se trouve alors en présence d’une règle juridique. Autrement dit, la transformation de la norme sociale en norme juridique se réalise quand la société a conscience que la règle a pris tellement d’importance pour la défense de la solidarité sociale que l’intervention de la sanction pour réprimer sa violation devient tout à fait nécessaire et juste.
En un mot, le droit apparait bien comme le produit des nécessités sociales.
L’Etat, à un certain moment, le constate mais il ne le crée pas. Il ne fait qu’exprimer un droit qui résulte des rapports sociaux. Ce droit est qualifié de droit objectif parce qu’il est obligatoire pour tous et qu’il se forme indépendamment de la volonté étatique. Même processus en ce qui concerne la société internationale mais on va reprocher à Duguit de minimiser la volonté des Etats. Scelle va prolonger l’idée de Duguit. Il estime que le respect de la solidarité sociale comme fondement du droit est une nécessité biologique : « nul ne peut la compromettre sans nuire à la vie de la société et à la sienne propre ». Ainsi, le droit est défini par Scelle comme « un impératif social traduisant une nécessité née de la solidarité naturelle ». Mais sa thèse est apparue plus réaliste que celle de Duguit dès lors qu’il a intégré l’élément « pouvoir » dans son analyse : « D’où viennent les règles de droit ? Du fait social lui-même et de la conjonction de l’étique et du pouvoir produit de la solidarité sociale ». Il a établit une nouvelle distinction entre droit objectif et droit positif, dualité qui est en fait étroitement liée à la distinction entre source matérielle et source formelle du droit. Seules les sources matérielles c'est-à-dire les nécessités sociales sont considérées comme créatrices de droit. Les sources formelles c'est-à-dire le pouvoir ne sont que des procédés de captation des sources matérielles. Donc le caractère obligatoire du droit n’est pas fondé sur le fait qu’il est issu des sources formelles mais sur sa conformité avec les nécessités sociales qui constituent les sources matérielles. Dès lors, quand la norme positive est contraire au droit objectif c'est-à-dire aux nécessités sociales elle peut provoquer des révolutions légitimes. La thèse de Georges Scelle n’est pas entièrement satisfaisante dans la mesure en particulier où elle nie l‘importance du concept de souveraineté qui est prégnant (=dominant) dans la vie internationale. En conclusion, au-delà de toutes ces théories, on est obligé de considérer l’ordre juridique international comme une réalité objective. Autrement dit, il n’y a pas à rechercher le fondement du droit international, c’est un fait.
Résumer avec l'IA :
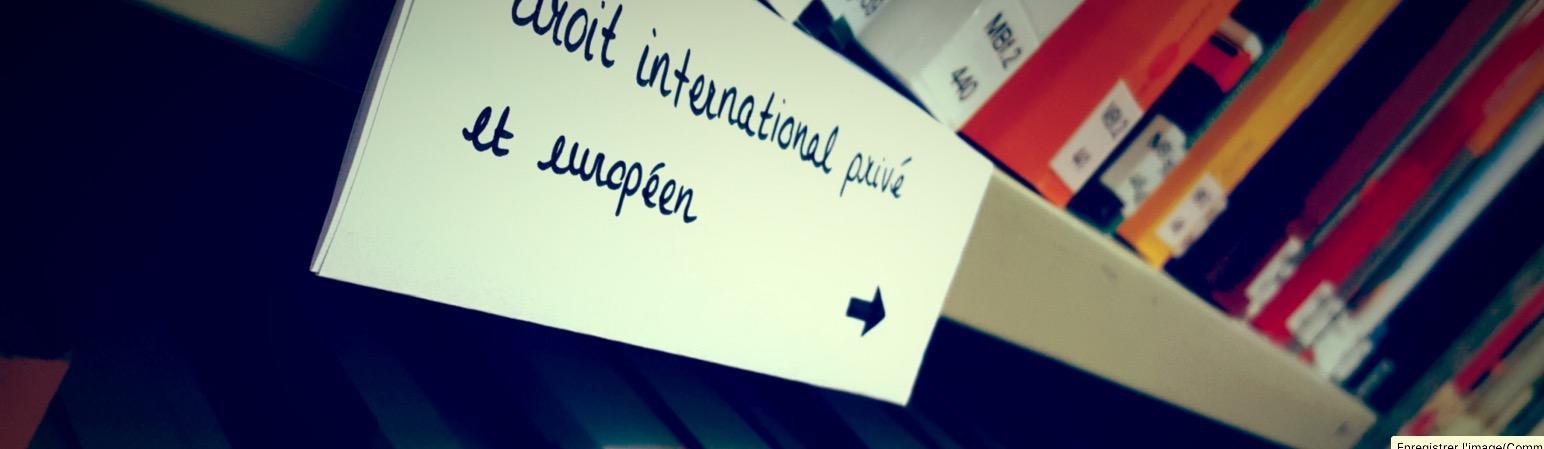






















Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !
Bonjour Simon, est-il possible d’ajouter votre nom à l’article pour une référence complète?
Bonjour Zina ! Vous pouvez effectivement citer Superprof et nos auteurs. Merci pour votre intérêt et à bientôt. :)
Bonjour Monsieur Simon
Je suis étudiant de Master à l’université de Yaoundé II.
Mon thème de mémoire porte sur# les limites des pouvoirs reconnus aux Etats sur l’espace aérien et l’esprit extra-atmosphérique.#.
Je souhaiterais avoir vos éclaircissements à ce sujet.
Aussi pourriez-vous me référer des ouvrages ou articles pertinents sur
– les restrictions à la souveraineté aérien ne des États( Les libertés de l’air, les normes et pratiques recommandées, les zones d’exclusion aérienne décidées par l’ONU et les aspects qui limitent les pouvoirs des États sur leurs espaces aériens);
_ les restrictions à la liberté de survol de la haute mer( les zones d’identification aérienne -ADIZ-, les législations limitant le survol de certaines installations sur le plateau continental et la zone économique exclusive, les zones dangereuses, la poursuite chaude ou hot puirsuit, l’empire des normes de l’OACI sur le survol de la haute mer );
– les restrictions à la liberté d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique.
Merci