"Comment pouvez-vous être sûr que votre raisonnement est correct si vous ne comprenez pas le paradoxe qu'il contient ?"
Niels Bohr
Les mathématiques, souvent perçues comme un domaine d'ordre et de logique implacable, cachent un univers fascinant de paradoxes qui bousculent nos intuitions. Ces énigmes, loin d'être de simples curiosités, jouent un rôle essentiel dans la compréhension des fondements de la logique, de la théorie des ensembles ou encore des probabilités.
Les paradoxes mathématiques ne se contentent pas de poser des défis intellectuels ; ils nous poussent à reconsidérer nos certitudes.
Parmi ces paradoxes, certains sont célèbres pour avoir déstabilisé des générations de penseurs, comme celui de Zénon, qui interroge la notion même d'infini, ou celui de Monty Hall, qui a mis à l'épreuve notre compréhension des probabilités. D'autres, moins connus mais tout aussi captivants, trouvent des applications insoupçonnées dans la vie quotidienne, des algorithmes informatiques à l'économie comportementale.
Ces paradoxes témoignent de la richesse et de la profondeur des mathématiques, tout en montrant que ce domaine n'est pas seulement une science exacte, mais également une question de point de vue.
Voici un résumé des 10 paradoxes mathématiques les plus connus à ce jour :
| Intitulé du paradoxe | Famille de paradoxe | Définition |
|---|---|---|
| Le paradoxe de Zénon (Achille et la tortue) | Paradoxe logique | Il affirme qu'Achille ne peut jamais rattraper une tortue plus lente en raison d'une division infinie des distances, mais la théorie moderne des séries montre qu'il le rattrape en un temps fini |
| Le paradoxe de Russell | Paradoxe logique | L'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes conduit à une contradiction |
| Le paradoxe du menteur | Paradoxe logique | La phrase "Cette phrase est fausse" est à la fois vraie et fausse, créant une incohérence logique |
| Le paradoxe de Curry | Paradoxe logique | Avec certaines hypothèses, il est possible de prouver n'importe quoi, ce qui met en évidence des failles déductives |
| Le paradoxe de Berry | Paradoxe logique | Décrire "le plus petit entier indéfinissable en moins de 100 mots" crée une contradiction en le définissant |
| Le paradoxe de Monty Hall | Paradoxes statistiques ou probabilistes | Changer de choix dans un jeu à trois portes augmente vos chances de gagner, malgré l'intuition contraire |
| Le paradoxe des anniversaires | Paradoxes statistiques ou probabilistes | Avec seulement 23 personnes, il y a 50 % de chances que deux partagent le même anniversaire |
| Le paradoxe de Simpson | Paradoxes statistiques ou probabilistes | Une tendance observée dans des groupes de données peut s'inverser lorsque les groupes sont combinés |
| Le paradoxe des deux enveloppes | Paradoxes statistiques ou probabilistes | Échanger une enveloppe semble toujours avantageux, bien que les probabilités rendent la situation ambiguë |
| Le paradoxe du joueur | Paradoxes statistiques ou probabilistes | Croire qu’un résultat est "dû" après une série de pertes ou de gains est une illusion statistique |
On décortique tout ça ensemble, c'est parti ! 🤯

Définition générale du paradoxe
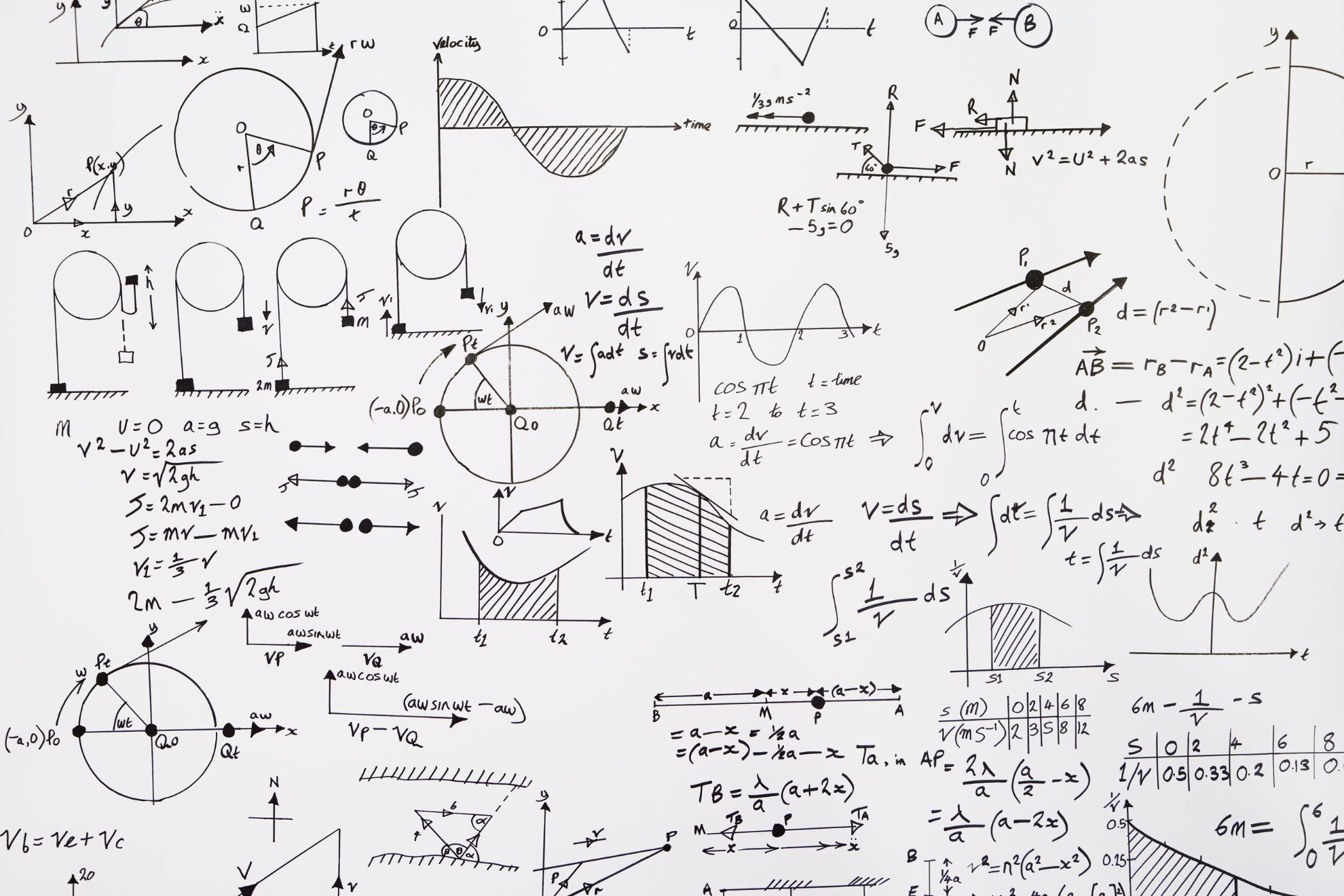
L'étude de ces phénomènes peut occuper tout un cours de mathématiques : interactifs et ludiques ils sont un vecteur pédagogique non négligeable.
Un paradoxe mathématique est une situation ou un énoncé qui semble contradictoire ou impossible, mais qui révèle des concepts profonds lorsqu'on l'examine de plus près. Les paradoxes naissent souvent d'une confusion entre nos intuitions et les règles mathématiques.
Ils peuvent révéler des failles dans un raisonnement ou des aspects surprenants des mathématiques, comme l'infini ou la probabilité.
Étudier ces paradoxes aide à développer une pensée critique et à mieux comprendre les limites et la puissance des mathématiques. Certains paradoxes montrent des incohérences apparentes dans la logique, d'autres des résultats contre-intuitifs dans des calculs ou des probabilités.
Un exemple classique est le paradoxe de la corde. Imaginez un cercle de rayonne de 1 mètre avec une corde tendue autour. Si l'on ajoute 1 mètre à la corde et qu'on les soulève autour du cercle, à quelle hauteur la corde se trouve-t-elle au-dessus du sol ?
On pourrait penser que la hauteur sera minuscule, mais elle est en réalité d' environ 16 centimètres , quel que soit le rayon du cercle initial. Cela s'explique par une formule simple : la hauteur dépend seulement de l'augmentation de longueur de la corde, et non du rayon initial du cercle.
Ce paradoxe surprend, car il défie notre intuition sur la relation entre la taille initiale et l'effet de l'ajout. Les paradoxes mathématiques fascinent littéralement les amoureux de casse-têtes en tout genre ou les passionnés de chiffres. Un sujet au moins aussi fascinant que le nombre Pi !
Ainsi, les paradoxes mathématiques ne sont pas des erreurs, mais des outils pour explorer les idées mathématiques sous un autre angle.
Les paradoxes logiques
Les paradoxes logiques mettent en évidence des contradictions ou des incohérences dans des systèmes logiques ou mathématiques.
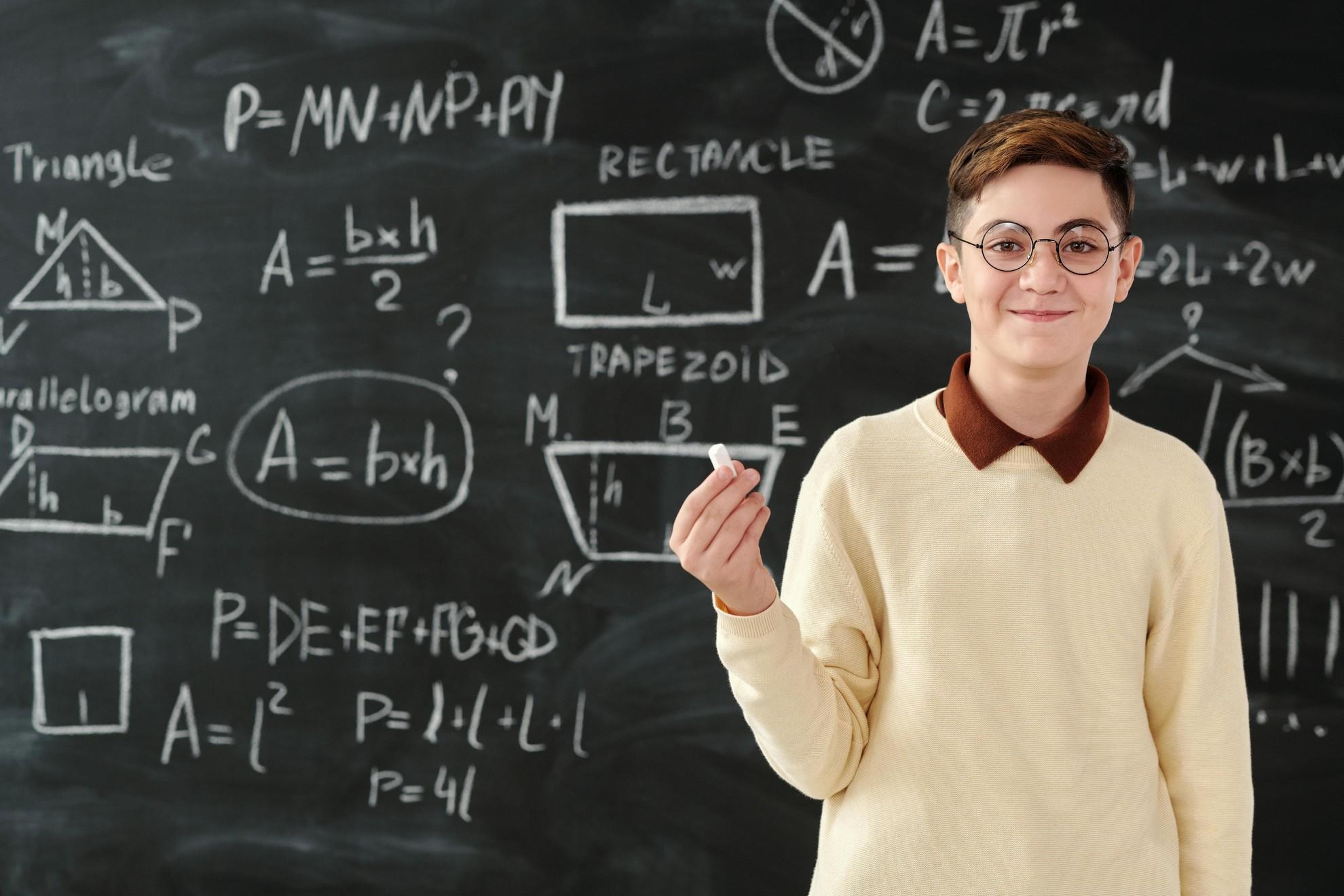
Ils sont essentiels pour comprendre les limites des formalismes mathématiques.
Le paradoxe de Zénon (Achille et la tortue)
Dans ce paradoxe attribué à Zénon d'Élée, Achille, le héros grec rapide, court une course contre une tortue, beaucoup plus lente, qui a une avance initiale. Zénon affirme qu'Achille ne pourra jamais rattraper la tortue, car :

- Achille doit d'abord atteindre la position initiale de la tortue,
- Pendant ce temps la tortue avance un peu,
- Puis, Achille doit atteindre cette nouvelle position mais la tortue aura encore progressé légèrement,
- Ce processus se répète indéfiniment, donc, selon Zénon, Achille ne peut jamais rattraper la tortue.
Cependant les mathématiques modernes réfutent ce paradoxe !
En effet, dans ce cas présent, Achille semble incapable de rattraper une tortue plus lente, car il doit d'abord atteindre chaque position qu'elle occupe, ce qui crée une infinité d'étapes. Or, les maths modernes montrent que cette infinité de petites distances peut être additionnée pour donner un temps fini, et Achille fini par dépasser la tortue.
Cela vous donne envie de vous replonger dans vos cours de maths ? On continue !
Le paradoxe de Russell
Le paradoxe de Russell concerne l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Si un tel ensemble existe, on se demande s'il se contient lui-même : s'il se contient, il ne devrait pas se contenir, et s'il ne se contient pas, il devrait se contenir.
Cette contradiction a montré que certains concepts naïfs de la théorie des ensembles devaient être repensés pour éviter ces incohérences.
Exemple : Imaginez un village où le barbier rase uniquement les habitants qui ne se rasent pas eux-mêmes. La question est : le barbier se rase-t-il lui-même ? Si oui, il ne devrait pas se raser, et si non, il devrait se raser, ce qui crée une contradiction logique insoluble.
Le paradoxe du menteur
Le paradoxe du menteur est une célèbre énigme mathématique.
Énoncé sous la forme "Cette phrase est fausse", ce paradoxe illustre une contradiction : si la phrase est vraie, elle est fausse, et si elle est fausse, elle est vraie. Cela crée une boucle de contradiction sans solution évidente.
Voici quelques explications complémentaires :
Le paradoxe de Curry
Ce paradoxe logique affirme qu'avec certaines hypothèses, il est possible de prouver tout et n'importe quoi, ce qui met en évidence des failles dans certains systèmes déductifs.
C'est un paradoxe logique qui fonctionne de manière similaire au paradoxe du menteur, mais il utilise des implications logiques.
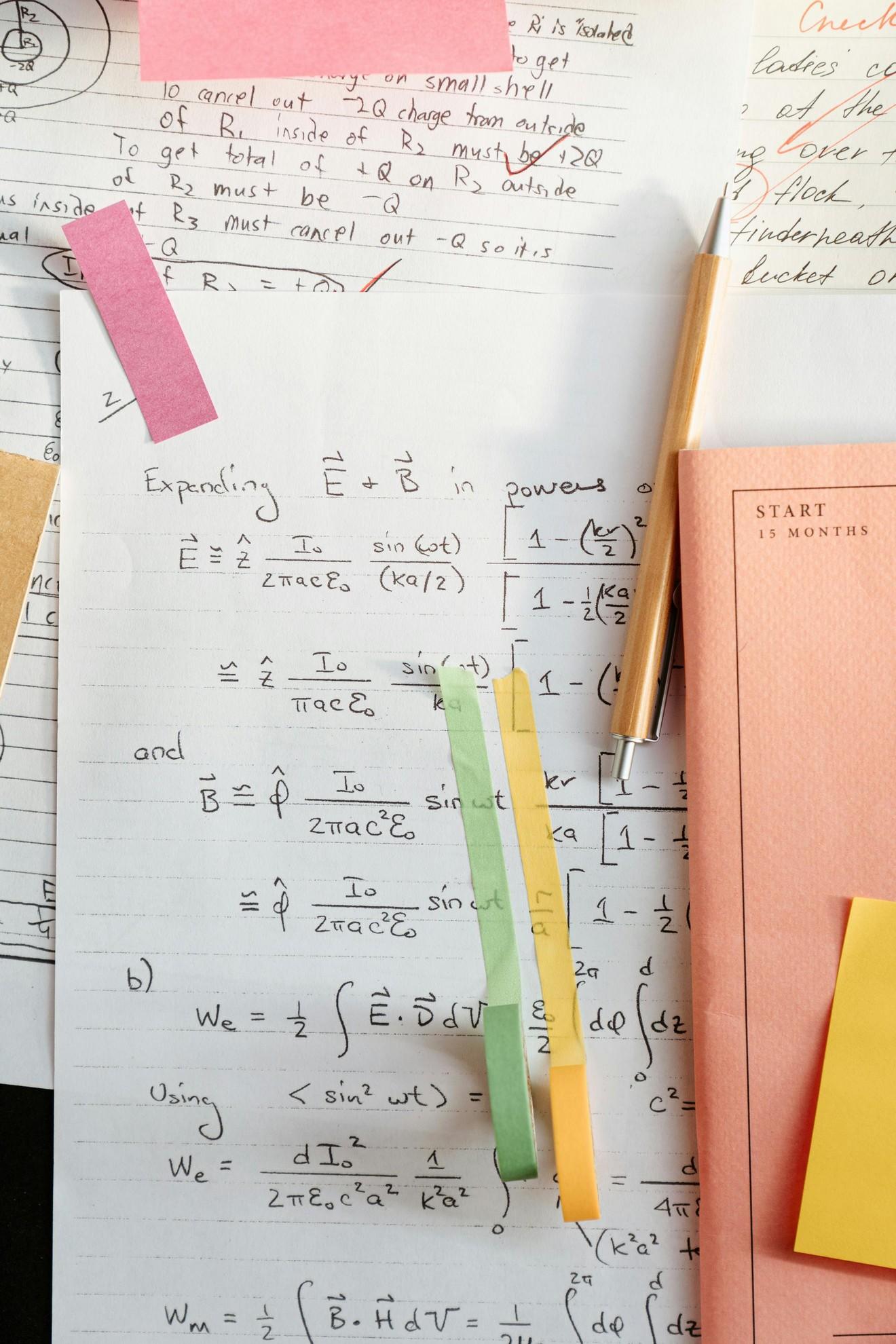
Par exemple : "Si cette phrase est vraie, alors 1 = 2."
Si on suppose que la phrase est vraie, alors ce qu'elle affirme (que 1 = 2), doit également être vraie. Mais cela contredit nos principes mathématiques, car 1 n'est pas égal à 2. Ce paradoxe met en lumière les problèmes liés à certaines règles de la logique formelle, en particulier lorsqu'on travaille avec des systèmes autoréférentiels.
De quoi vous donner des heures de réflexion pendant vos cours de maths !
Le paradoxe de Berry
Le paradoxe de Berry est basé sur les définitions en langage naturel et les limites de la logique.
Ainsi la phrase suivante : "Le plus petit nombre entier qui ne peut pas être décrit en moins de 100 mots" est une phrase qui semble logique, mais elle crée une contradiction puisqu'elle décrit cet entier en moins de 100 mots.
Pas facile les mathématiques hein? Cela mets notre logique à rude épreuve à bien des égards !
Mais les maths peuvent aussi êtres fascinantes ! Connaissez-vous par exemple les plus grands mystères mathématiques ?
Les paradoxes statistiques ou probabilistes
Les paradoxes statistiques sont des situations où les résultats d'une analyse semblent aller à la rencontre de l'intuition ou de la logique, souvent à cause de biais ou d'interprétations erronées des données.
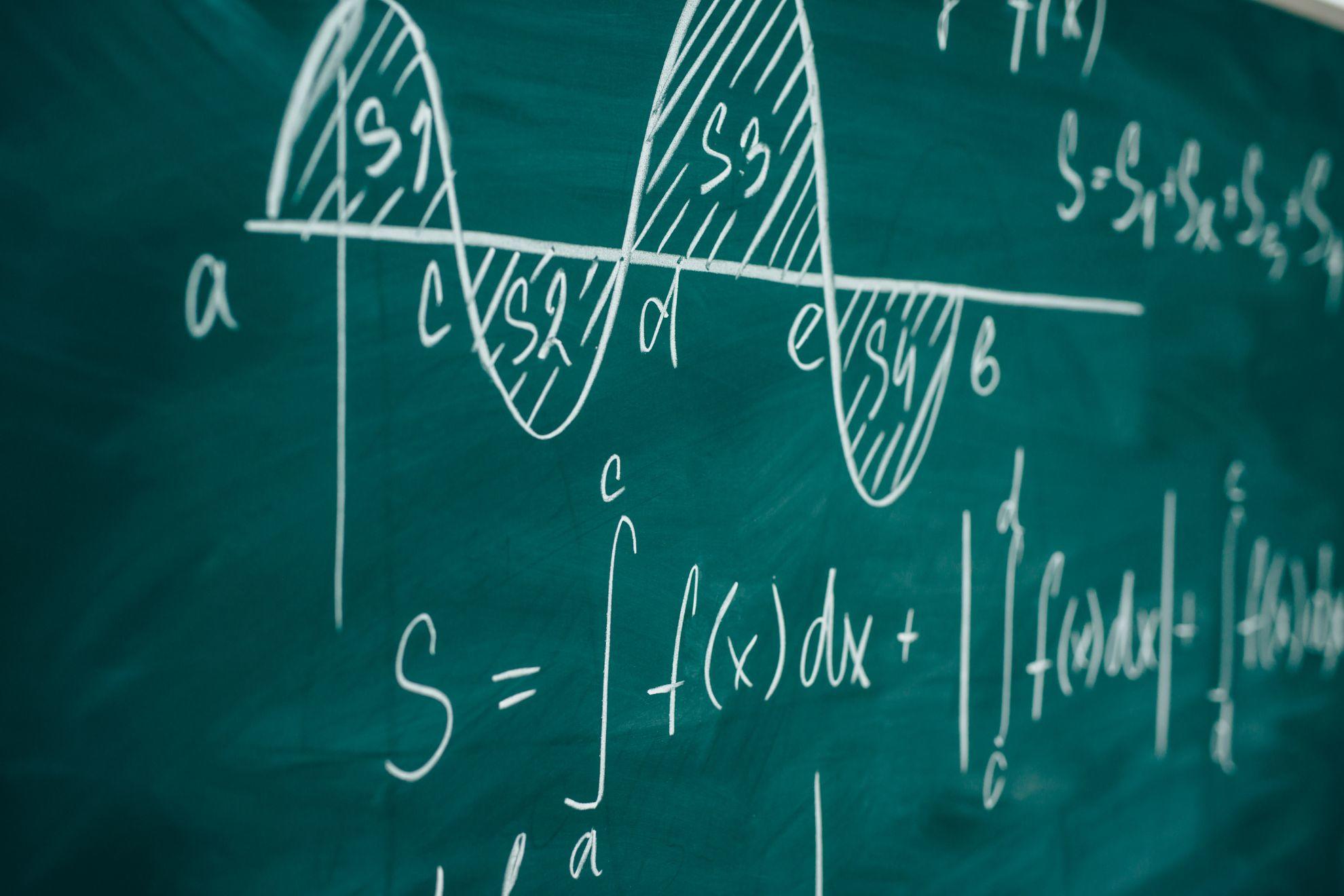
Voici les 5 paradoxes statistiques les plus connus.
Le paradoxe de Monty Hall
Le paradoxe de Monty Hall est un problème de probabilité célèbre. Il tire son nom d'un jeu télévisé américain. Imaginez trois portes : derrière l'une se cache une voiture (le prix), et derrière les deux autres, des chèvres (des lots perdants). Vous choisissez une porte. L'animateur, qui sait ce qu'il ya derrière chaque porte, ouvre une autre porte, révélant une chèvre. Il vous demande ensuite si vous voulez changer de porte.
La solution est contre-intuitive : il vaut mieux changer. En restant, vous avez 1 chance sur 3 de gagner. En changeant, vos chances montent à 2 sur 3.

Le paradoxe des anniversaires
Le paradoxe des anniversaires est un problème de probabilité surprenante. Il montre qu'il suffit de 23 personnes dans une pièce pour qu'il y ait 50 % de chances que deux d'entre elles partagent le même anniversaire.
Ce résultat contre-intuitif s'explique par le grand nombre de comparaisons possibles entre les anniversaires des individus, bien plus élevé que ce que l'on imagine intuitivement.
Même votre date d'anniversaire peut faire l'objet d'un cours de maths !
Le paradoxe de Simpson
Le statisticien Edward Simpson a formulé ce paradoxe en 1951. Cela concerne des séries de données apparemment contradictoires, mais simplement parce qu'elles appliquent des critères différents.
Exemple : contre telle maladie, l'ordonnance A serait plus efficace que l'ordonnance B. La cause est entendue ? Non, car quand ladite maladie est bénigne, le traitement B est plus efficace que le traitement A, dont les résultats sont toutefois meilleurs en cas d'atteinte aigüe.
Ce paradoxe n'est possible que s'il y a une variable influençant le résultat, et si l'échantillon statistiquement étudié n'est pas distribué de manière homogène.
De ce fait, le paradoxe de Simpson montre l'importance d'analyser les données dans leur contexte et de tenir compte de l'ensemble des facteurs sous-jacents avant de tirer des conclusions.
Le paradoxe des deux enveloppes
Le paradoxe des deux enveloppes est un problème de décision contre-intuitif en probabilité et en logique.
Imaginons que vous participez à un jeu : deux enveloppes sont posées devant vous.
L'une contient 50 € et l'autre 100 €, mais vous ne savez pas laquelle est laquelle. Vous choisissez une enveloppe et découvrez, par exemple, 50 €. Maintenant, vous réfléchissez : si je change, j'ai peut-être 100 €, mais si l'autre enveloppe contient seulement 25 €, alors je perds !
Le paradoxe arrive ici : en calculant, vous vous dites que changer semble toujours avantageux. Pourtant, si vous appliquez cette logique en boucle, vous finirez par vouloir constamment partager sans jamais être sûr de gagner plus. Cela montre comment une simple décision peut devenir très déroutante !
N'oubliez pas ce genre d'anecdote toute simple qui peut vous aider le jour de votre Grand Oral de maths

Le paradoxe du joueur
Le paradoxe du joueur, ou fallacy du joueur , est une erreur de raisonnement liée aux probabilités. Il consiste à croire que des événements aléatoires passés influencent les chances d'un événement futur, alors qu'ils sont en réalité indépendants.
Par exemple, si une pièce tombe "pile" cinq fois de suite, on pourrait croire que "face" a plus de chances d'apparaître la prochaine fois, alors que la probabilité reste toujours 50 %.
De nombreux autres genres de paradoxes existent comme les paradoxes géométriques ou topologiques par exemple.
Ils peuvent être utilisés pour a peu près tout et n'importe quoi dans le domaine de l'analyse et de la statistiques, on s'en est même servi pour déterminer le rôle le plus important dans Game of Thrones, oui oui !
Résumer via IA :

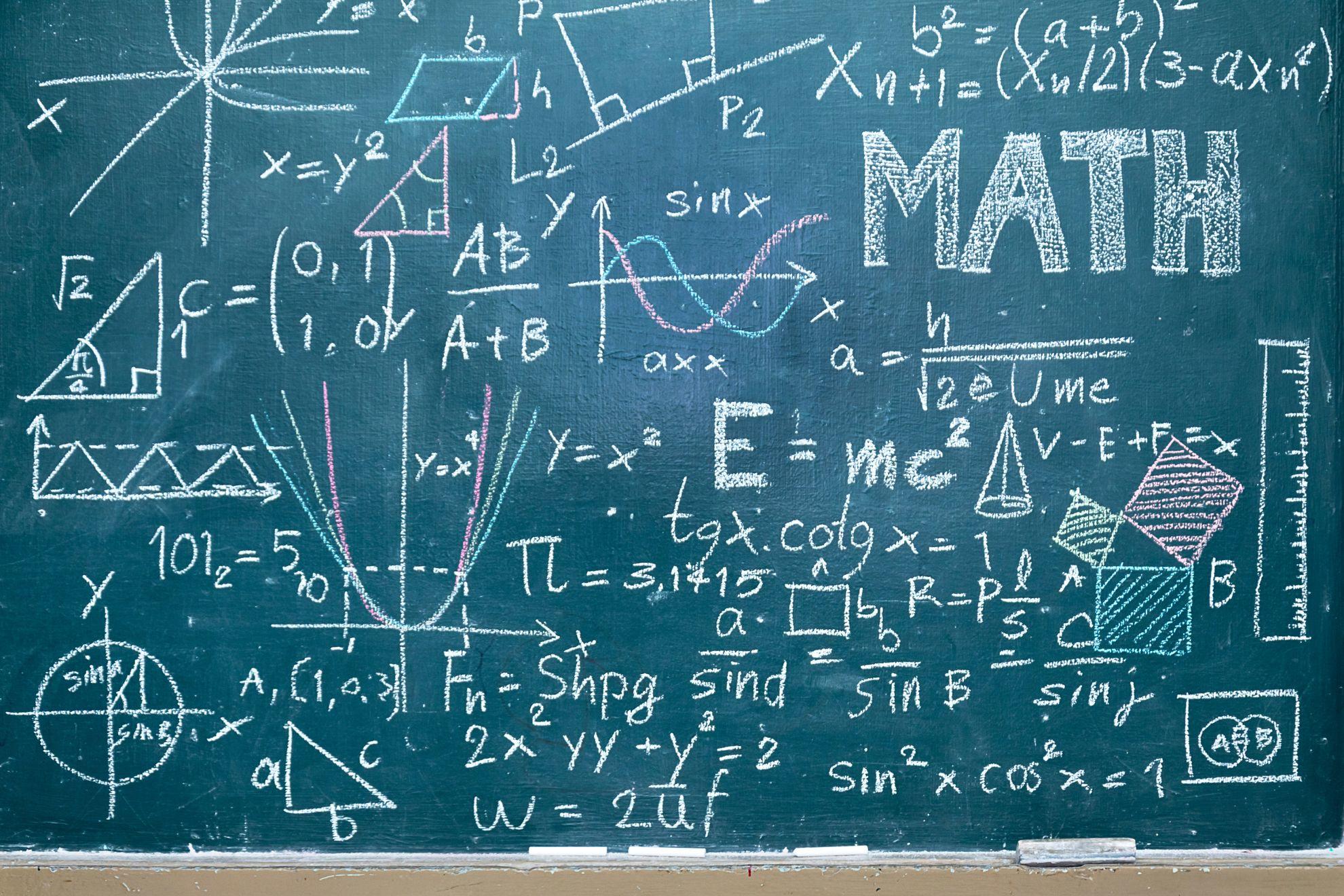














Bonsoir j’ai un dm à rendre et je voudrai savoir comment démontrer les résultats :
Énoncé:
1)on considère le carré ci contre.Quelle est son aire dans le repérer (O,I,J)
2)qu’elle est l’aire du rectangle dans le repère (O,I,J) qu’en penser?
3)nous allons expliquer le résultat de la question 2
J’aurai bien besoin de votre aide s’il vous plaît je sais pas comment faire
Bonjour,
Il est très difficile de vous donner des informations sans avoir l’exercice sous les yeux. Je vous conseille d’appliquer la formule de calcul de rectangle dans un repère orthonormé que vous avez sûrement dû voir en cours. Si vous avez du mal en maths de manière générale, n’hésitez pas à faire appel à un prof particulier ou autre.
Bien à vous
Bonjour, Comment pouvez-vous écrire que le paradoxe de Zénon a été levé grâce aux maths modernes ? Merci
Bonjour,
À quelle phrase faites-vous référence ?
Bien à vous
La solution du paradoxe de l’interrogation surprise (1/2)
Version pédagogique
Norbert Codréanu
Ing. E.N.S.E.M.
Docteur d’État-ès-Sciences (HDR)
Retraité
Résumé : La résolution du paradoxe de l’interrogation surprise est proposée dans cet article par la mise en œuvre d’une analyse logique rigoureuse, mais dans une version pédagogique lisible par le plus grand nombre possible de lecteurs. On y démontre qu’il n’y a pas de paradoxe. Et dans un second article, pour les lecteurs désireux d’approfondir le sujet, une analyse précise est réalisée pour mettre en évidence les erreurs commises dans les raisonnements habituels.
Introduction
De nombreux articles, concernant le problème du paradoxe de l’interrogation surprise, sont basés sur un raisonnement par récurrence. Ils concluent tous à un paradoxe ou par exemple à « Il n’y a pas de paradoxe, seulement un drôle de professeur qui tient des propos incohérents – contradictoires – auquel on ne peut donc pas se fier. Il n’a aucune raison d’être fier de nous surprendre puisque quiconque se contredit surprend forcément ceux qui croient à la vérité de ses propos. »
Cette citation, ainsi que l’énoncé suivant, sont extraits de la revue Accromath [2].
Énoncé du paradoxe de l’interrogation surprise :
Le professeur Martin annonce à ses élèves :
(a) je ferai une interrogation la semaine prochaine;
(b) vous ne pourrez pas savoir quel jour elle se déroulera : ce sera une surprise.
On peut ajouter, ce qui, en général, est sous-entendu dans « a ».
(c) il n’y aura qu’une, et une seule, interrogation dans la semaine.
Mathilde, la meilleure élève de la classe, en mathématiques , raisonne alors ainsi :
Nous avons cours avec Monsieur Martin le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Puisqu’il nous dit que nous ne pourrons pas connaître le jour de l’interrogation, celle-ci ne se déroulera pas le samedi, car samedi matin, sachant que l’interrogation se fera dans la semaine (affirmation a), elle ne pourrait avoir lieu que le samedi et donc nous saurions de manière certaine qu’elle va avoir lieu ce jour-là. Il est donc acquis que l’interrogation n’aura pas lieu le samedi. Mais alors, le vendredi, elle ne peut pas avoir lieu non plus, car sachant qu’elle ne peut pas avoir lieu le samedi, quand nous arriverons dans la classe le vendredi, nous saurons qu’elle va avoir lieu. Il est donc acquis aussi que l’interrogation n’aura pas lieu le vendredi. En poursuivant de la même manière ce raisonnement, Mathilde en déduit que l’interrogation ne peut avoir lieu ni le jeudi, ni le mercredi, ni le mardi, ni le lundi et donc qu’elle n’aura pas lieu.
Mais en classe, le mercredi à 14 h 30, le professeur distribue l’énoncé de l’interrogation et tous les élèves sont surpris !
OÙ EST LE PARADOXE ?
Première partie : Définition précise du problème
Pour construire un raisonnement logiquement sérieux, il nous faut définir avec précision tous les termes que nous employons. « une semaine, les jours de la semaine, une interrogation .. » tout cela semble clair et bien défini ; par contre, « l’effet de surprise » est plus flou.
La surprise, d’une façon générale, est fonction de deux paramètres : l’objet de la surprise et l’instant où l’évènement survient.
Je suis surpris du cadeau que je reçois pour mon anniversaire, mais connaissant bien évidemment la date de mon anniversaire, la surprise concerne, dans ce cas, l’objet que je reçois. Par contre, pour l’interrogation surprise : l’objet est connu (il y aura obligatoirement une et une seule interrogation dans la semaine), mais la date est inconnue, ce sera la surprise. Dans ce cas, l’« effet de surprise » est temporel, donc le problème doit être analysé en fonction du temps.
La définition précise du problème est donc la suivante :
Hypothèse n° 1 La semaine comporte 6 jours travaillés par les élèves, du lundi au samedi. (nous verrons que pour une pseudosemaine de « n » jours, avec n strictement supérieur à deux, le raisonnement reste valable)
Hypothèse n° 2 «l’effet de surprise » signifie : « les élèves ne peuvent pas connaître à l’avance, avec une certitude logique, la date de l’évènement ».
Énoncé du problème :
Un professeur annonce à ses élèves : « Il y aura une interrogation surprise la semaine prochaine. »
Ce qui signifie précisément trois choses :
(a) je ferai une interrogation la semaine prochaine;
(b) vous ne pourrez pas savoir quel jour elle se déroulera : ce sera une surprise ;
(c) il n’y aura qu’une, et une seule, interrogation dans la semaine.
Deuxième partie : Résolution du problème
Le problème étant défini avec précision, nous pouvons passer à sa résolution.
Le lundi :
1. soit l’interrogation a lieu (et c’est terminé, car elle a eu lieu avec « surprise », les élèves ne pouvaient pas prévoir, avec certitude, qu’elle aurait lieu le lundi)
2. soit elle n’a pas lieu, alors on passe au jour suivant.
En formalisant un petit peu ce raisonnement, on obtient :
SI (on est lundi) ALORS [(l’interrogation a lieu aujourd’hui) OU (on passe au jour suivant)]
Le mardi :
1. soit l’interrogation a lieu (et c’est terminé, car elle a eu lieu avec « surprise », les élèves ne pouvaient pas prévoir, avec certitude, qu’elle aurait lieu le mardi)
2. soit elle n’a pas lieu, alors on passe au jour suivant.
En formalisant un petit peu ce raisonnement, on obtient :
SI (l’interrogation n’a pas eu lieu lundi) ALORS [(l’interrogation a lieu aujourd’hui) OU (on passe au jour suivant)]
Et ainsi de suite tous les jours de la semaine jusqu’au samedi matin.
Le samedi matin :
1. soit l’interrogation a lieu aujourd’hui,
2. soit elle n’a pas lieu, alors on passe au jour suivant.
En formalisant un petit peu ce raisonnement on obtient : SI A ALORS B
avec A = (l’interrogation n’a pas eu lieu lundi) ET (l’interrogation n’a pas eu lieu mardi) ET .. ET (l’interrogation n’a pas eu lieu vendredi)
et avec B = [(l’interrogation a lieu aujourd’hui) OU (on passe au jour suivant) ]
La proposition (l’interrogation a lieu aujourd’hui) est FAUSSE. L’interrogation ne peut pas avoir lieu le samedi, car le vendredi soir les élèves sauraient avec certitude que l’interrogation aurait lieu le lendemain en application de l’assertion (a).
La proposition (on passe au jour suivant) est aussi FAUSSE, car il n’y a pas de jour suivant (le samedi est le dernier jour de la semaine).
Donc la proposition « B = [(l’interrogation a lieu aujourd’hui) OU (on passe au jour suivant)] » est FAUSSE.
Dans une implication (SI A ALORS B), lorsque la conclusion B est fausse, cela entraine que l’hypothèse A est aussi fausse[1].
L’hypothèse A FAUSSE signifie que la proposition « (l’interrogation n’a pas eu lieu lundi) ET (l’interrogation n’a pas eu lieu mardi) ET .. ET (l’interrogation n’a pas eu lieu vendredi) » est FAUSSE ; donc « l’interrogation a eu lieu l’un de ces cinq premiers jours de la semaine ».
Le contraire de l’assertion P = «X1 ET X2 ET … ET X4» étant non-P = «non-X1 OU non-X2 …OU non-X4 » ; si P est faux, non-P est vrai. Pour cela, il faut et il suffit que l’une (au moins) des assertions «non-Xi » soit vraie. En langage courant cela s’énonce : « l’interrogation a eu lieu pendant l’un (au moins) des cinq premiers jours de la semaine ».
Mais, comme dans notre cas, l’assertion (c) indique qu’il n’y aura qu’une, et une seule, interrogation dans la semaine, il n’y a qu’un, et un seul, jour concerné, donc « l’interrogation a eu lieu l’un de ces cinq premiers jours de la semaine ».
Conclusion
Dans cet article, nous avons proposé un raisonnement, suivant une logique mathématique rigoureuse tout en ne faisant usage que d’un langage compréhensible par le plus grand nombre possible de lecteurs, ce qui nous a conduits à démontrer que le problème dénommé « le paradoxe de l’interrogation surprise » n’est pas un paradoxe.
La conclusion logique précise est « l’interrogation a lieu l’un des cinq premiers jours de la semaine ». Donc il n’y a aucun paradoxe et cette assertion est parfaitement conforme à l’expérience.
Le lecteur intéressé trouvera, dans un second article [3], une analyse des erreurs de raisonnement habituelles.
Références :
1 – Table de vérité de l’implication (A=>B)
A
B
A=>B
V
V
V
V
F
F
F
V
V
F
F
V
i. – Pour la logique propositionnelle, ce tableau indique dans la dernière ligne :
Pour que la proposition (A=>B) soit vraie si B est faux, il faut et il suffit que A soit faux.
ii. – Dans le langage courant, on appelle aussi cette démarche : « raisonnement par l’absurde ». Pour tester la validité d’une hypothèse, on analyse toutes ses conséquences. Si elles sont toutes fausses, c’est que l’on s’est trompé, notre hypothèse de départ était fausse.
iii. – Le bon sens des paysans normands leur fait dire : si un arbre est un pommier alors (cela implique qu’) il donne des pommes. S’il fournit d’autres fruits que des pommes : ce n’est pas un pommier !
iv. – Pour un point de vue plus philosophique sur l’implication, on peut lire, entre autres, avec intérêt, le paragraphe «Un premier exemple de phénomène langagier», pages 3 et 4 de l’article de Zoé MESNIL. « Zoé Mesnil – LOGIQUE ET LANGAGE DANS LA CLASSE DE MATHEMATIQUES ET LA FORMATION. 21ème Colloque de la CORFEM, Jun 2014, Grenoble, France. (hal-01570177) »
2 – Revue Accromath [Volume 9.2 – numéro été-automne 2014], accessible sur le site «accromath.uqam.ca ».
3 – Norbert Codréanu, second article «La solution du paradoxe de l’interrogation surprise (2/2) Analyse des erreurs habituelles »
merci bien.
Solution simple d’un problème non résolu depuis plus de 70 ans
Résolution strictement logique du « paradoxe de l’interrogation surprise »
Norbert Codréanu
Ing. E.N.S.E.M.
Docteur d’État-ès-Sciences (HDR)
Cet article propose une solution simple au « paradoxe de l’interrogation surprise ». Le problème, publié par D.O’Connor en 1948, est resté non résolu jusqu’à ce jour.
La formulation du problème, que nous avons choisi ici, est semblable à celle de Paul Franceschi, adaptée à une semaine de six jours.
« Un professeur annonce à ses étudiants qu’un examen aura lieu la semaine prochaine. Cependant, le professeur ajoute qu’il ne sera pas possible aux étudiants de connaître à l’avance la date de l’examen, car celui-ci aura lieu par surprise. Un étudiant intelligent raisonne alors ainsi : l’examen ne peut se dérouler le dernier jour de la semaine [le samedi] car sinon je saurai, de manière certaine, que l’examen aura lieu le samedi. Ainsi, le samedi peut être éliminé. De même, poursuit l’étudiant, l’examen ne peut se dérouler l’avant-dernier jour de la semaine [vendredi] car sinon je saurai que l’examen aura lieu le vendredi. Ainsi, le vendredi est également éliminé. Par le même raisonnement, l’étudiant conclut que l’examen ne peut avoir lieu ni le jeudi, ni le mercredi, ni le mardi, ni le lundi. Finalement, l’étudiant conclut que l’examen ne peut avoir lieu aucun jour de la semaine. Pourtant, cela n’empêche pas l’examen d’avoir lieu par surprise, par exemple le mercredi.Le paradoxe naît ici du fait que le raisonnement de l’étudiant semble valide, alors qu’il se révèle finalement en contradiction avec les faits, puisque l’examen a finalement bien lieu par surprise. » (Franceschi, 2014)
La plupart des commentateurs de ce problème proposent des raisonnements par récurrence sauf celui-ci :
« Il n’y a pas de paradoxe, seulement un drôle de professeur qui tient des propos incohérents – contradictoires – auquel on ne peut donc pas se fier. Il n’a aucune raison d’être fier de nous surprendre puisque quiconque se contredit surprend forcément ceux qui croient à la vérité de ses propos. » (Delahaye, 2014)
Le professeur annonce à ses élèves qu’il fera une interrogation surprise la semaine prochaine.
Précisons, tout d’abord, les termes du problème :
(a) une interrogation aura lieu durant un cours dans la semaine (du lundi au samedi).
(b) avant le début de l’interrogation, les élèves ne pourront pas avoir la certitude logique que l’interrogation va avoir lieu le jour même.
(c) il n’y aura qu’une et une seule interrogation dans la semaine.
La solution, de ce que l’on nomme couramment « le paradoxe de l’interrogation surprise », est très simple, il suffit d’analyser correctement l’idée de l’élève.
La démonstration est la suivante :
1. SI (le samedi matin, l’interrogation n’a pas déjà eu lieu) ALORS (elle aura lieu le samedi)
2. L’interrogation ne peut pas avoir lieu le samedi, car il n’y aurait pas de surprise (le vendredi soir les élèves sauraient, à l’avance avec certitude, la date de l’interrogation – le dernier jour de la semaine-).
Dans une implication SI « H » ALORS « C », quand la conclusion « C » est fausse, c’est que l’on a fait une mauvaise hypothèse. « H » est par conséquent fausse.
La conclusion C = « l’interrogation aura lieu le samedi » étant fausse, cela impose que l’hypothèse « H » aussi soit fausse.
La proposition H = « l’interrogation n’a pas déjà eu lieu» étant fausse, cela indique que son contraire est vraie, c’est à dire : le samedi matin l’interrogation a déjà eu lieu.
Donc, l’interrogation ne peut pas avoir lieu le samedi, parce qu’elle a déjà eu lieu avant et il n’est prévu qu’une seule interrogation dans la semaine [d’après la condition (c)].
Conclusion : l’interrogation a lieu l’un des cinq premiers jours de la semaine (du lundi au vendredi inclus) et, avec surprise, car il est impossible de déterminer, à l’avance, la date exacte. Donc il n’y a pas de paradoxe.
Remarques :
a) Dans la réalité, on «n’arrive jamais» au samedi, car quand l’interrogation a lieu, le déroulement des jours « s’arrête ». L’interrogation a lieu le jour « J », avec surprise, et donc le problème se termine le jour « J » (entre le lundi et le vendredi inclus).
b) La principale erreur de l’élève est qu’il ne garde que la moitié de la conclusion « l’interrogation ne peut pas avoir lieu le samedi » alors que l’assertion complète est : « l’interrogation ne peut pas avoir lieu le samedi PARCE QU’ELLE A DÉJÀ EU LIEU AVANT le samedi ».
Références
1. O’Connor,D.,(1948). Pragmatic Paradoxes, Mind, 57(227), 358–359.
2. Delahaye, JP., (2014). Solution du paradoxe 9.1 : L’interrogation surprise, Accromath, 9(2), été-automne.
3. Franceschi, P., (2005). Une analyse dichotomique du paradoxe de l’examen-surprise. Philosophiques, 32(2), 399–421.