Chapitres


Introduction
Généralités
L'histoire de la chimie et la curiosité de l'Homme sont intrinsèquement liée. En effet, ce domaine a évolué en même temps que la volonté de l'Homme à comprendre la nature ainsi que les propriétés de la matière, surtout sur la façon dont celle-ci existe ou se transforme.
Le commencement
L'histoire de la chimie commencera tout d'abord avec la découverte du feu : la première source d'énergie utilisée par l'Homme afin d'améliorer son quotidien. En effet, il permet l'éclairage, le chauffage ainsi que la cuisson des aliments mais surtout, la maîtrise du feu a permis l'Homme de réaliser les premières transformations contrôlées de la matière comme dans le cas de la fabrication du verre, de la céramique ou encore d'alliages métalliques métallique. L'histoire de la chimie sera par la suite marquée lors de nombreuses tentatives de développement d'une théorie cohérente en ce qui concerne la matière comme la théorie atomique de Démocrite et la théorie des éléments d'Aristote durant la période antique puis le développement de l'alchimie pendant le Moyen-Âge.
La chimie devient une science

Un passé très flou
Cependant, à ce jour, il est très difficile de distinguer de façon précise l'histoire de la chimie de l'histoire de la physique ou de sciences de la vie comme la biochimie, en effet, leurs histoires sont très liées car chaque découverte dans un domaine a permis une évolution dans d'autres.
Préhistoire et Antiquité
Durant cette large période, la chimie était surtout utilisée pour son côté pratique dans le but de transformer la matière. On a beaucoup de témoignages archéologiques de son utilisation à la préhistoire : Détail de ces transformations 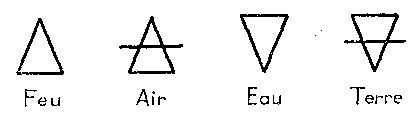
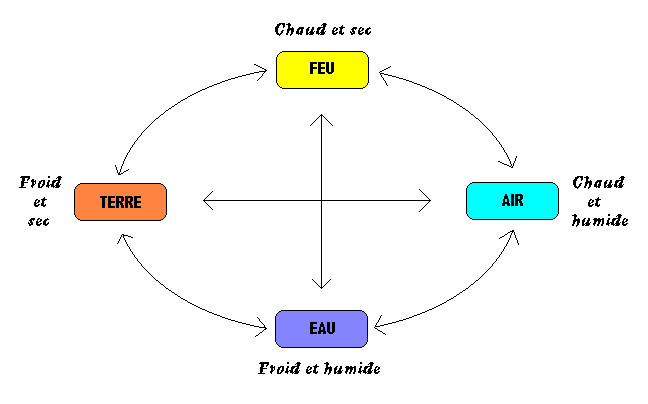
Démocrite (460 - 370 av. J.C.)
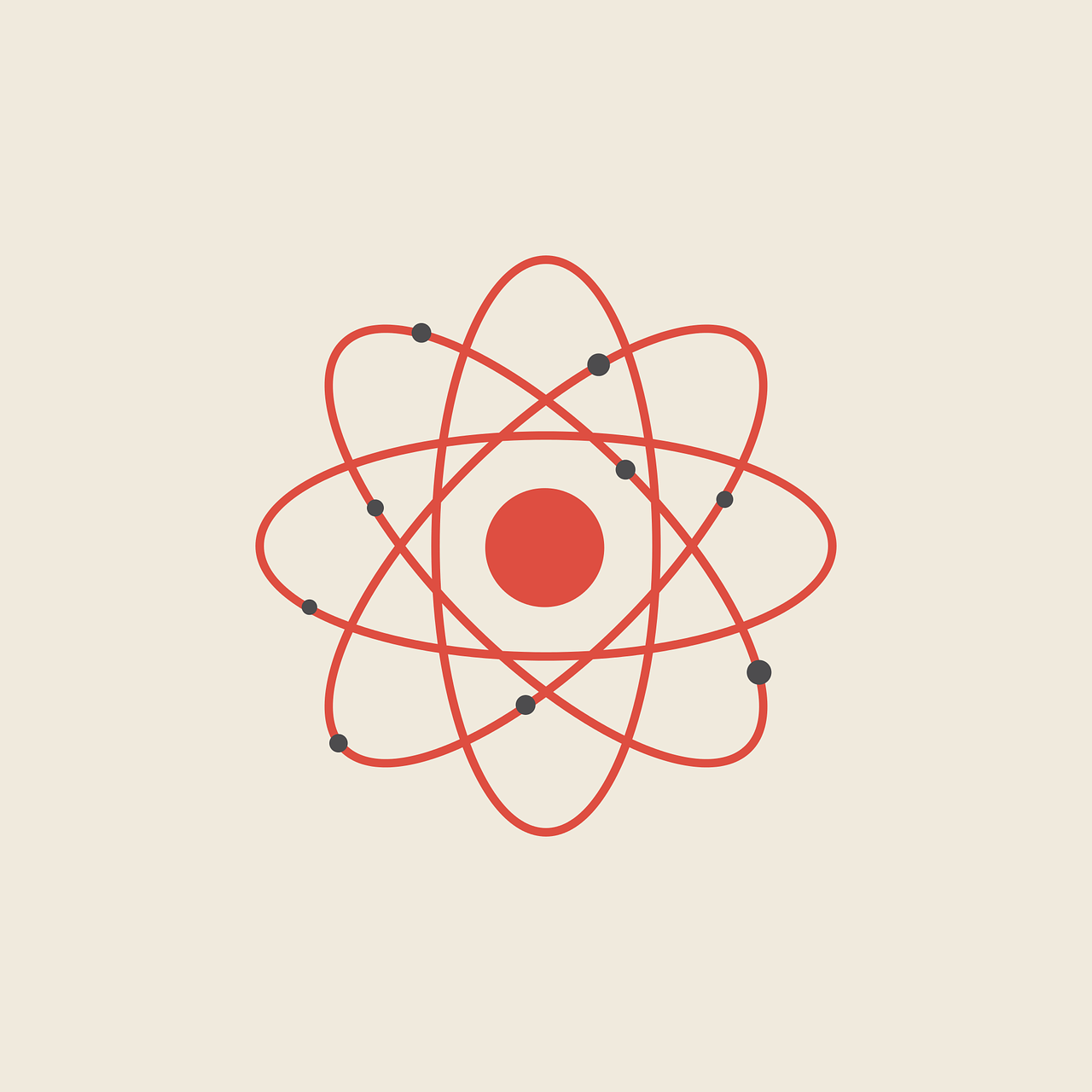
- La cohésion d'un solide est due à l'entrelacement d'atomes crochus.
- Les liquides sont caractérisés par des atomes lisses et ronds qui glissent facilement. Certains sont plus gros que d'autres (ex : l'huile passe plus difficilement que l'eau dans un filtre car l'huile a des atomes plus gros !).
Ces deux théories sont des théories totalement philosophiques (sans expérience justificatrice ou contre expérience). C'est la théorie élémentale qui va longtemps l'emporter (base de la culture des alchimistes), jusqu'à ce que l'atomisme réapparaisse sérieusement remanié au XIXe avec John Dalton (1766 - 1844), comme un système explicatif presque moderne.
L'Alchimie d'Alexandrie (IV e s. av. J.C.) à la Renaissance

- Le Soufre principe est : ce qui est actif, chaud, dur : le masculin.
- Le Mercure principe est : ce qui est passif, froid, malléable, volatile : le féminin.
- Le Sel : Ce qui permet dans un corps d'unir le soufre et le mercure, et d'assurer la cohésion du résultat.
En effet, le sel empêche la putréfaction des viandes en empêchant le Mercure et le Soufre de se séparer et donc la décomposition... Le sel de mer est principalement constitué de Sel : le sel reste symbole de vie. Notons que René Descartes (1596 - 1650), lui n'était pas du même avis : « Je souscris en tout point au jugement que Votre Excellence fait des chimistes et crois qu'ils ne font que dire des mots hors de l'usage commun pour faire semblant de savoir ce qu'ils ignorent. Selon mon opinion, leur sel, leur soufre et leur mercure ne diffèrent pas plus entre eux que les quatre éléments des philosophes, ni guère ni plus que l'eau diffère de la glace, de l'écume et de la neige, car je pense que tous les corps sont fait d'une même matière, qu'il n'y a rien qui fasse de la diversité entre eux ; sinon que les petites parties de cette matière ont d'autres figures, ou sont autrement arrangées que celle qui composent les autres. » Paracelse (1493 - 1541), médecin suisse itinérant, se rend compte de l'importance de la pureté des médicaments. Georg Bauer dit Agricola (1494 - 1555) est le fondateur de la chimie métallurgique (" De Re Metallica " : des choses métalliques). Bernard Palissy (1499 - 1589), artiste (émaux,...) et expérimentateur (il brûla ses meubles et planchers pour alimenter ses fours : il mit ainsi au point la préparation de la faïence). Jan Baptist Van Helmont (1577 - 1644) découvre l'état gazeux, individualise les différents gaz (avant, il n'en existait qu'un seul type : l'Air). Il met en évidence le gaz sylvestre (du bois) : le CO2 et pressent l'O2. Robert Boyle (1627 - 1691) énonce le principe (tout comme l'Abbé Mariotte) "Pour un gaz, le produit de la pression par le volume est constant à température constante, pour un système fermé". Il rejette la théorie élémentale d'Aristote et propose une classification en corps simples, primitifs ou composés et en acides, sels ou alcalis. Il introduit les premiers réactifs chimiques (utilisation du sirop de violette pour mettre en évidence l'acidité : c'est le premier indicateur coloré). Jean Rey (1583 - 1645), médecin, publie en 1630 ses résultats sur plusieurs série d'observations et d'expériences : "Quant on chauffe un métal à l'air, il se forme une chaux (= OXYDE )plus lourde que le métal." Cela n'a pourtant aucun écho jusqu'à sa réédition en 1777. Pour Paracelse "Pendant la combustion, quelque chose quitte le métal, il devient plus dense" Pour Boyle "Le feu a un certain poids absorbé par le métal" Rey reconnaît donc que l'air prend part à la réaction : "Il y a interaction entre l'air et la chaux d'où augmentation du poids et conservation de la matière" Néanmoins, l'interprétation qu'il en donne est d'ordre mécanique. Francis Bacon (1561 - 1626) exprime sa sympathie pour l'atomisme. D. Sennert (1572 - 1637) tente une synthèse des théories élémentale et atomique. René Descartes (1596 - 1650) émet une théorie corpusculaire non atomique. Pour lui la matière est constituée de tourbillons. Pierre Gassendi (1592 - 1655) reprend les théories atomiques de l'Antiquité. Néanmoins, aucun de ces hommes ne dépassera le concept de liaison mécanique entre deux atomes (atomes crochus...).
Il y a alors une modification des théories cosmologiques : héliocentrique avec Nicolas Copernic (1473 - 1543), et il y a avènement de l'expérimentation au détriment de la spéculation. Nicolas Lémery (1645 - 1715) publie le 1er traité de chimie. Isaac Newton (1642 - 1727) était essayeur à la Monnaie de Londres. Son travail l'a amené à s'intéresser longuement aux pratiques alchimiques. Ses travaux à ce sujet n'ont jamais été publiés de son vivant mais ont été récemment retrouvés. Dans son ouvrage "L'Optique", il pose une série de questions et amène des éléments de réponses sous forme de conjectures. Ainsi, à la Question 31, il caractérise la chimie comme étant le lieu de forces attractives et de forces répulsives qui peuvent se manifester à courte distance. Cela lui permet d'expliquer le déplacement d'un métal dans un sel par un autre métal, et propose ce qui constitue la première échelle d'oxydoréduction des métaux. Il explique l'élasticité des gaz, la cohésion des liquides et des solides,... On arrive donc à une chimie corpusculaire dépassant le cadre des liaisons mécaniques.
Les lois de la thermodynamique
Bien que longtemps étudiées, ces lois seront mises en place au cours du XIXe siècle. La première loi de la thermodynamique ne manquera d'ailleurs pas de vous rappeler la célèbre maxime de Lavoisier.
Le principe zéro de la thermodynamique
Ce principe concerne la notion d'équilibre thermique. Ainsi, il est à la base de la thermométrie et s'énonce ainsi : si deux systèmes sont en équilibre thermique avec un troisième, alors ils sont aussi ensemble en équilibre thermique.
Le premier principe de la thermodynamique
Egalement appelé principe de la conservation de l'énergie, ce principe affirme que l'énergie est toujours conservée. Formulé autrement, cela signifie que l'énergie totale d'un système isolé reste constante. Ainsi, les événements qui se produisent au sein du système isolé ne se traduisent donc que par des transformations de certaines formes d'énergie en d'autres formes d'énergie. Puisque l'énergie ne peut pas être produite en partant de rien, elle est présente en quantité invariable dans la nature. Elle ne peut donc que se transmettre d'un système à un autre : on ne crée par l'énergie, on la transforme. Ce principe est également considéré comme étant une loi générale pour toutes les théories physiques, notamment en mécanique, électromagnétisme ou physique nucléaire puisqu'on ne lui a jamais trouvé la moindre exception même si des doutes peuvent subsister lorsque l'on étudie les désintégration radioactives. De puis le théorème de Noether, on sait que la conservation de l'énergie est intimement reliée à une uniformité de structure de l'espace-temps. Le premier principe de la thermodynamique rejoint alors le célèbre principe popularisé par Lavoisier : "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme."
Le deuxième principe de la thermodynamique
Egalement appelé principe d'évolution des système, ce principe affirme la dégradation de l'énergie. En effet, l'énergie d'un système passe de façon nécessaire et spontanée de formes concentrées et potentielles à des formes diffuses et cinétiques telles que le frottement ou la chaleur. Ce principe introduit donc également la notion d'irréversibilité d'une transformation et la notion d'entropie. En effet, d'après le deuxième principe de la thermodynamique, l'entropie d'un système isolé augmente ou reste constante. Souvent interprété comme une mesure du désordre et comme l'impossibilité du passage du désordre à l'ordre sans intervention extérieur. L'interprétation de ce principe se base sur la théorie de l'information de Claude Shannon et la mesure de cette information, également appelée entropie de Shannon. La principale différence de ce principe avec le premier principe de la thermodynamique est l'origine statique de ce deuxième principe. En effet, les lois microscopiques qui gouvernent la matière ne le contiennent qu'implicitement et de manière statique. Cependant, le deuxième principe de la thermodynamique reste relativement indépendant des caractéristique des lois précédemment citée puisqu'il apparaît même si l'on suppose des lois simplistes à petite échelle.
Le troisième principe de la thermodynamique
Ce principe, quant à lui, est associé à la descente vers un état quantique fondamental d'un système dont la température s'approche d'une limite qui définit la notion de zéro absolu. En effet, en thermodynamique classique, ce principe permet de calculer l'entropie molaire S d'un corps pur par intégration sur la température à partir de S=0 à 0 K dans le but d'établir des tables de données thermodynamiques.
La loi de Laplace en thermodynamique
En thermodynamique, cette loi correspond à une relation reliant la pression et le volume d'un gaz parfait qui subit une transformation dite isentropique ou une transformation dite adiabatique et réversible. Mais cette relation peut également être utilisée avec la température et le volume ainsi que la température et la pression. La loi de Laplace suppose en effet des capacités thermiques constante alors que les capacités thermiques d'un gaz parfait dépend évidemment de la température, il suffit de regarder la loi des gaz parfait. En conséquence, cette loi ne peut être appliquée à des transformation où la variation de la température est peu important. On peut alors considérer que les capacités thermiques sont constantes. [ P times V = n times R times T ] Avec :
- P est la pression d'un gaz (en pascals) ;
- V le volume occupé par le gaz (en m3) ;
- n la quantité de matière (en moles) ;
- R la constante universelle des gaz parfaits (8,3144621 J/K/mol) ;
- Et T est la température (en kelvins).
Les sciences et les unités
La nécessité de la mise en place d'un système ordonné
Jusqu'au XVIIIème siècle il n'existait aucun système de mesure unifié. Pourtant, de nombreux rois avant Charlemagne tentèrent de réduire le nombre de mesures existantes. En effet, la France comptait parmi les pays les plus inventifs et les plus chaotiques dans ce domaine : en 1795, plus de 700 unités différentes cohabitaient en France ! Beaucoup de ces unités étaient empruntées à la morphologie humaine et leurs noms en sont la preuve :
- Le doigt,
- La palme,
- Le pied,
- La coudée,
- Le pas,
- La brasse,
- Ou encore la toise.
Le problème avec ces unités de mesures est qu'elles n'étaient pas fixes puisqu'elles variaient d'une ville à l'autre, mais aussi selon la nature de l'objet mesuré, ce qui causait beaucoup de torts ! Les mesures de volume et celles de longueur n'avaient aucun lien entre elles puisque chaque multiple et sous multiple s'échelonnaient de façon aléatoire rendant les calculs compliqués, voir impossibles. Ces différentes unités étaient source de nombreuses erreurs et de fraudes lors des transactions commerciales, mais portaient aussi préjudice au développement des sciences puisque les calculs et les mesures des grandeurs étaient différents pour les scientifiques. C'est donc pour régler ces nombreux problèmes que la mise en place d'un système international se faisait de plus en plus pressante. Le Système International d'unité, abrégé SI, devient le successeur du système métrique en 1960 à partir d'une résolution de la 11ème Conférence générale des poids et mesures. Ce système permet de rapporter toutes les unités de mesure à un petit nombre d'étalons fondamentaux, permettant aux scientifique de se consacrer à améliorer leur définition. Ce travail est l'une des missions des différents laboratoires nationaux de métrologie.
Le système international et les unités usuelles
L'ensemble des unités associées aux dimensions fondamentales constitue le système international d'unités. Il s'agit du système MksA (mètre, kilogramme, seconde, Ampère), mais le Kelvin, le mole et le candela font aussi partie de ce système. Ces unités sont appelées unités légales. Elles sont universelles et connues de par le monde entier.
Il est important de savoir que toutes les autres dimensions se déduisent de ces sept dimensions fondamentales par produit ou division de ces dimensions.
Dans certains sujets d'exercices, les grandeurs ne sont pas exprimées dans le système international mais avec des grandeurs usuelles. Il est facile de les comprendre et elles sont parfois utilisées dans la vie de tous les jours, mais il est essentiel de toujours effectuer les calculs avec les grandeurs exprimées dans l'unité internationale pour éviter les erreurs.














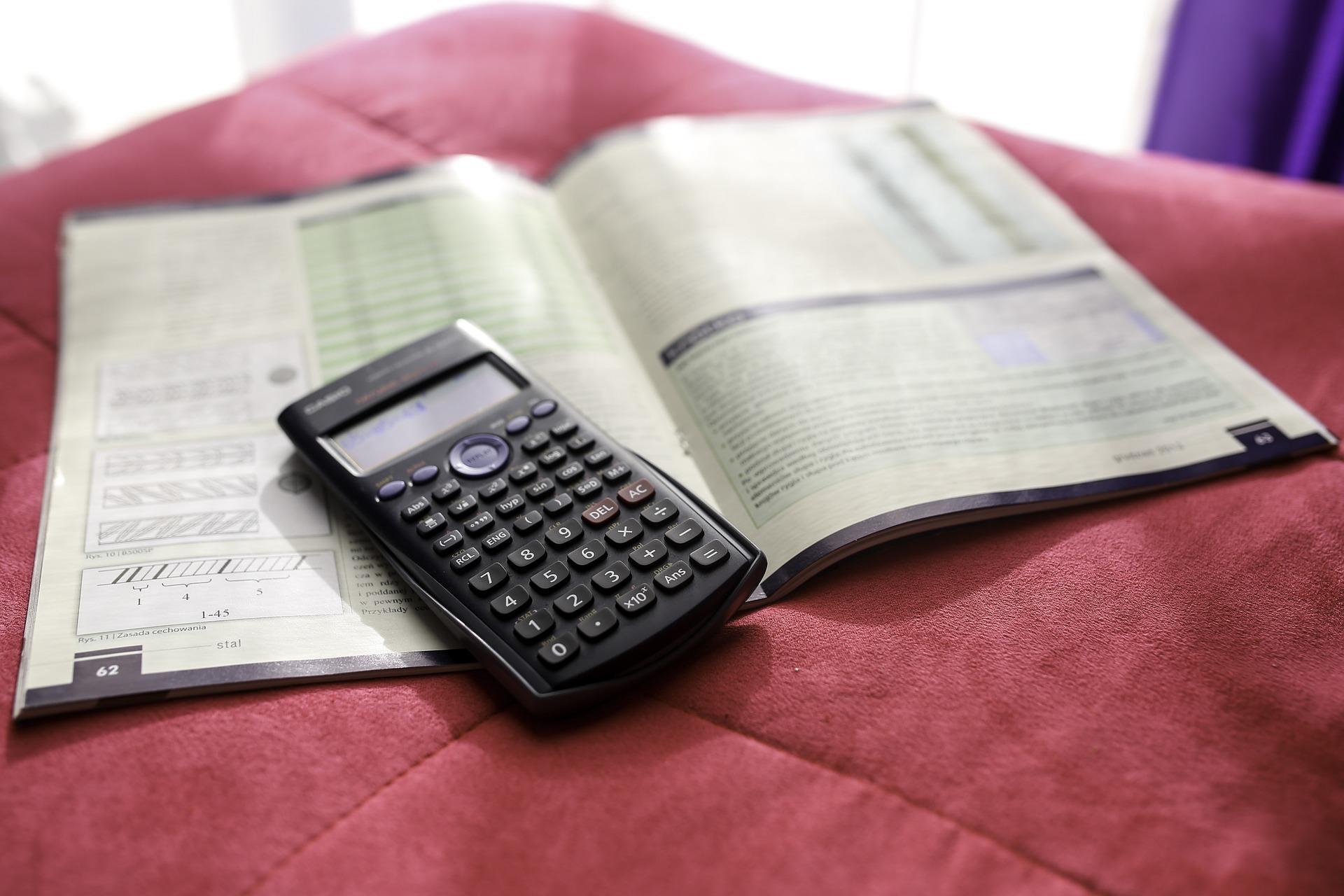




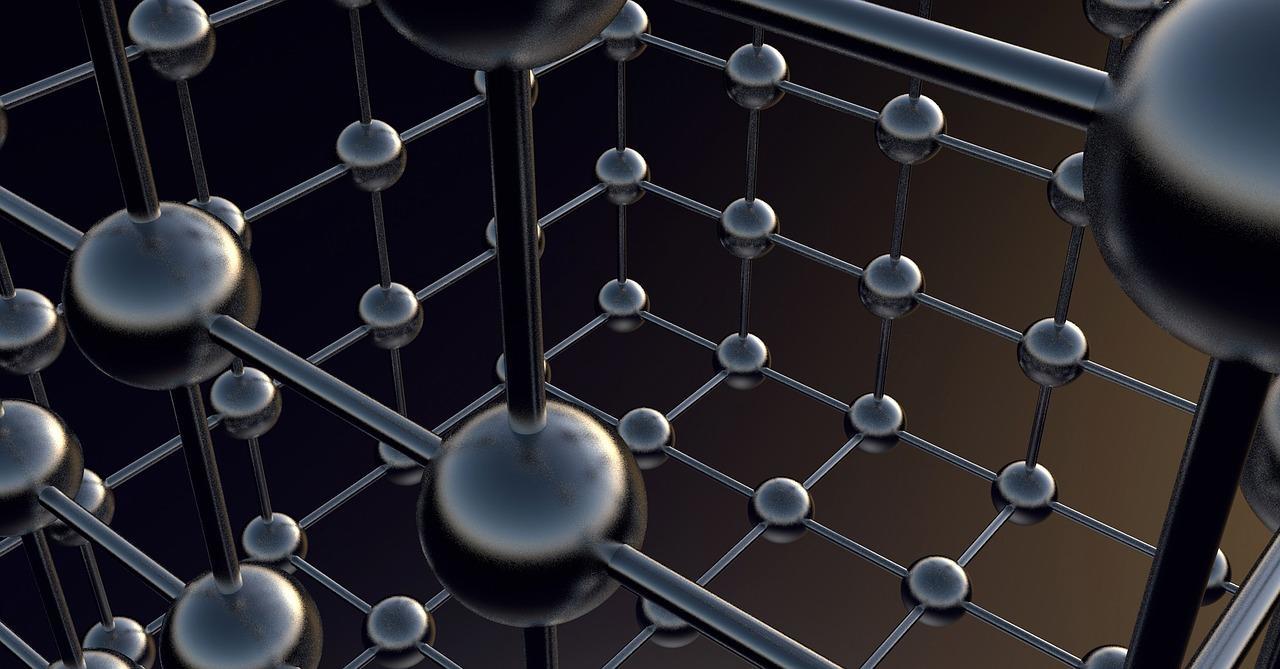



Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !
Donné moi Les dates historiques de la chimie
Bonjour ! Pour un soutien parfaitement adapté à vos besoins, n’hésitez pas à faire appel à nos professeurs sur Superprof. Ils vous aideront à réaliser vos objectifs. Excellente journée !