Chapitres
- 01. Présentation du gaz
- 02. Caractéristiques notables
- 03. L'ozone et la mise en place du protocole de Montréal en 1987
- 04. Réactivité de l'ozone
- 05. Le déficit en ozone dans la protection terrestre
- 06. Destruction de la couche d'ozone stratosphérique
- 07. Températures basses
- 08. Rappel sur l'oxygène et le stress oxydatif

Présentation du gaz
L'ozone est le gaz O3. Il s'agit donc d'une variété allotropique de l'oxygène O. L'ozone est une substance chimique formée par trois atomes d'oxygène portant le numéro 8 dans la classification périodique des éléments.
| Identification | |
|---|---|
| Nom UICPA | Ozone |
| N° ECHA | 100.030.051 |
| N° CAS | 10028-15-6 |
| N° CE | 233-069-2 |
| Propriétés notables | Odeur caractéristique |
| Couleur | Gaz incolore ou bleuâtre |
| Propriétés chimiques | |
| Formule brute | O3 |
| Masse molaire | 47,9982 g.mol-1 |
| Moment dipolaire | 0,53373 D |
| Propriétés physiques | |
| Point d'ébullition | - 111,9°C |
| Solubilité dans l'eau à 0°C | 1 g.L-1 |
| Point de fusion | - 192,5°C |
| Masse volumique | 2,144 g.L-1 |
Définitions
- Dureté : La dureté d'un matériau représente la résistance qu'il oppose à la pénétration. On peut la mesurer selon plusieurs méthodes : la méthode par pénétration, la méthode par rayage ou encore la méthode par rebondissement
- Point de fusion : Le point de fusion correspond à un moment de pression et de température à partir duquel l'élément chimique fond, passant ainsi de l'état solide à l'état liquide
- Point d'ébullition : Le point d'ébullition correspond à un moment de pression et de température à partir duquel l'élément chimique bout, passant ainsi de l'état liquide à l'état gazeux
Rappel : La classification périodique des éléments, aussi appelée tableau de Mendeleïev, du nom de son créateur. C'est un chimiste russe qui en 1869 créa un tableau dont le but était de regrouper tous les éléments chimiques connus par points communs (groupes et familles par exemple). Il a souvent été ajusté et mis à jour depuis cette époque. Sa dernière révision date de 2016 par l'UICPA (Union internationale de chimie pure et appliquée), une ONG suisse qui a pour but l'évolution de la physique-chimie. Le tableau périodique compte à ce jour 118 éléments. L’UICPA, l’Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée est une organisation non gouvernementale ayant son siège à Zurich, en Suisse. Créée en 1919, elle s’intéresse au progrès de la chimie, de la chimie physique et de la biochimie. Ses membres sont les différentes sociétés nationales de chimie et elle est membre du Conseil International pour la Science. L’UICPA est une autorité reconnue dans le développement des règles à adopter pour la nomenclature, les symboles et autres terminologie des éléments chimiques et leurs dérivé via son Comité Interdivisionnel de la Nomenclature et des Symboles. Ce comité fixe la nomenclature de l’UICPA.
Caractéristiques notables
L'ozone tire son nom de l'Allemand Ozon qui est lui même dérivé du Grec ozô signifiant exhaler une odeur. Egalement connu sous le nom de trioxygène, il se présente sous une forme triatomique formées de trois atomes d'oxygène faisant alors de l'ozone une variété allotropique de l'oxygène bien qu'elle soit nettement moins stable que le dioxygène puisque l'ozone tend de façon naturelle à se décomposer.
L'allotropie est la faculté de certains corps simples d'exister sous plusieurs formes cristallines ou moléculaires différentes. Une forme allotropique peuvent avoir des propriétés physique, comme la couleur et la dureté, et une réactivité chimique différentes même si elles sont composées d'atomes identique Les transformations d'une forme allotropique à l'autre peuvent être induites par des changements de pression et de température ou même par une réaction chimique. Certaines formes ne sont stables que sous certaines conditions définies de température et de pression
Lorsque l'ozone se liquéfie à 161,3 K, il se présente sous la forme d'un liquide bleu foncé mais prend la forme d'un solide pourpre dès 80,7 K. Lorsqu'il se trouve à température ambiance, le trioxygène prend la forme d'un gaz bleu pâle à l'odeur très caractéristique. L'instabilité de cette substance se manifeste très largement lorsqu'elle se trouve dans un état condensé. En effet, une tendance à l'explosion se présentera lorsque la concentration en ozone est suffisamment significative.
De plus, l'ozone se décompose en dioxygène, de formule O2, à une vitesse variant selon de nombreux paramètres comme la température, l'humidité de l'air, la présence éventuelle de catalyseurs tels que l'hydrogène ou encore un contact ou non avec une surface solide. Alors que le dioxygène reste inodore pour le nez humain, l'ozone peut être détecté par l'Homme dès que sa concentration dépasse les 0,01 ppm. Son odeur est très caractéristique et rappelle beaucoup l'eau de Javel. Il faut néanmoins être prudent car ce gaz peut être toxique lorsqu'il est respiré en grandes quantités et provoque la toux.
Bien que l'ozone soit présent de façon naturelle dans l'atmosphère terrestre, formant par ailleurs une couche entre 13 et 40 km d'altitude dans la stratosphère, permettant alors d'intercepter près de 97% des rayons UV du Soleil, l'ozone reste un gaz très polluant pour les basses couches de l'atmosphère comme la troposphère. Lorsqu'il est présent dans cette couche, il va agresser le système respiratoire de la faune et peut même provoquer des brûlures chez la partie la plus sensible de la flore. En effet, l'ozone est un oxydant qui va agir sur les cellules vivantes et provoquer une corrosion accélérée des polymères. On appelle ce phénomène le craquelage d'élastomères par l'ozone.

L'ozone et la mise en place du protocole de Montréal en 1987
L'objectif est la réduction de moitié de leur production et de leur émission à l'horizon 2000. Quelques modifications à cet accord ont été adoptés par la suite de l' avancée de la recherche scientifique et de la meilleure compréhension du problème, le dernier a eu lieu en 1992. Un accord a été trouvé sur le contrôle de la production d'halocarbures par l'industrie jusqu'en 2030. Les principaux CFC ne sont plus produits par aucun des pays signataire après la fin de l'année 1995, excepté en quantités limitées pour des usages primordiaux comme en médecine. Les pays membres de la Communauté Economique Européenne ont même adopté des mesures encore plus fortes que celles demandées par le protocole de Montréal. Reconnaissant leurs responsabilités vis-à-vis de l'environnement et de la planète, ils se sont mis d'accord pour stopper toute production des principaux CFC au début de l'année 1995. Des délais plus courts pour mettre fin à l'utilisation d'autres substances réduisant la couche d'ozone ont également été adoptés. Les premières estimations laissent à penser que ces restrictions pourraient conduire à un retour à la normale vers 2050; l'Organisation Météorologique Mondiale estime que cela aura lieu en 2045 , mais de récents travaux suggèrent que le problème est peut-être, de plus grande échelle qu'on ne le pensait auparavant.
Où trouver des cours de physique en ligne ?
Réactivité de l'ozone
L'ozone est une substance chimique qui possède une demi-vie relativement courte et cela est encore plus marquant lorsque la réaction se produit dans l'eau où il se décomposera en radicaux -OH. Cependant, et comme cela a pu être dit précédemment, différents facteurs peuvent influencer la vitesse de décomposition de l'ozone.
La demi-vie correspond au temps mis par une substance afin de perdre la moitié de son activité pharmacologique ou physiologique.
La température
La température correspond au facteur ayant le plus d'influence sur la demi-vie de l'ozone. Il peut également être intéressant de noter que l'ozone est moins soluble dans l'eau, en plus d'être moins stable, lorsque la température augmente.
| Dans l'air | Dans l'eau à pH 7 | ||
|---|---|---|---|
| Température (°C) | Demi-vie | Température (°C) | Demi-vie |
| 250 | 1,5 seconde | ||
| 120 | 1 heure et 30 minutes | 35 | 8 minutes |
| 20 | 3 jours | 30 | 12 minutes |
| -25 | 8 jours | 25 | 15 minutes |
| -35 | 18 jours | 20 | 20 minutes |
| - 50 | 3 mois | 12 | 30 minutes |
Le pH
Lorsqu'il est dissous dans l'eau, l'ozone va se décomposer de façon partielle en radicaux -OH. Ainsi, si le pH de l'eau vient à augmenter, alors la décomposition de l'ozone va s'accélérer et la formation des radicaux -OH augmentera.
Rappel
Le pH, ou encore potentiel hydrogène, correspond à une mesure de l'activité chimique de ce qu'on appelle les hydrons dans une solution. Mais vous les connaissez plus certainement sous le nom de protons ou encore ions hydrogènes. De façon plus particulière, ces protons, dans une solution aqueuse, se présent sous la forme de l'ion hydronium qui représente le plus simple des ions oxonium. Le pH est, le plus souvent, utilisé afin de mesurer l'acidité ou encore la basicité du solution. On peut alors la déterminer avec l'échelle suivant dans le cas d'un milieu aqueux à 25°C :
- Une solution de pH égal à 7 est considérée comme étant neutre ;
- Une solution de pH inférieur à 7 est considérée comme étant acide. De ce fait, plus son pH diminue, plus elle est acide ;
- Une solution de pH supérieur à 7 est considérée comme étant basique. De ce fait, plus son pH augmente, plus elle est basique.
Mais la définition que nous connaissons aujourd'hui du pH, définition de Sorensen, n'a été officiellement reconnue qu'à partir du milieu du XXe siècle par l'UICPA. Cette définition est donc celle que nous retrouvons dans les manuels scolaire et s'énonce ainsi : \[ pH = - \log \left( a _ { \text { H } } \right) \] Avec aH, également noté aH+ ou [H+], qui correspond à l'activité des ions hydrogène H+. aH correspond donc à une grandeur sans dimension tout comme le pH. Néanmoins, cette définition ne nous permet pas d'obtenir des mesures directes du pH ni même des calculs. En effet, le pH dépend uniquement de l'activité des ions hydrogènes. De ce fait, le pH dépend de plusieurs autres facteurs découlant de cette activité. On peut par exemple parler de l'influence du solvant ou encore de la température. Il reste cependant possible d'obtenir des valeurs approchées du pH en utilisant ce calcul. Pour cela, il est nécessaire de faire appel à des définitions de l'activité. Cette définition formelle ne permet pas des mesures directes de pH, ni même des calculs. Le fait que le pH dépende de l’activité des ions hydrogène induit que le pH dépend de plusieurs autres facteurs, tels que l’influence du solvant. Toutefois, il est possible d’obtenir des valeurs approchées de pH par le calcul, à l’aide de définitions plus ou moins exactes de l’activité.
Trouvez un professeur physique ici.
La concentration en solides dissous
L'ozone, lorsqu'il est dissous dans l'eau, va réagir avec une très grande variété de matière comme des composés organiques ou encore des virus et bactérie par un phénomène que l'on appelle oxydation. En effet, l'ozone va se décomposer en dioxygène. Il peut être intéressant de noter que l'ozone se décompose de façon plus rapide dans de l'eau de ville que dans de l'eau distillée.
Besoin d'un prof physique chimie ?
L'environnement
L'ozone sous forme gazeux présente, de façon théorique, une demi-vie plus longue que l'ozone dissous dans l'eau. Cependant, dans la pratique, l'ozone va provoquer l'oxydation des éléments se trouvant autour de lui que ce soit des métaux, des murs ou même des cellules réduisant de ce fait sa demi-vie à quelques secondes.

Le déficit en ozone dans la protection terrestre
Des scientifiques de la NASA et de l'Administration nationale des études océaniques et atmosphériques (NOAA) ont constaté que le trou de la couche d'ozone dans la région polaire de l'hémisphère Sud a établi cette année un nouveau record de superficie et de profondeur. La couche d'ozone protège la vie sur terre car elle bloque les rayons ultraviolets nocifs du soleil. Le trou, qui est le signe d'une grave diminution de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique, est principalement causé par la présence de composés fabriqués par l'homme qui émettent du chlore et des gaz de brome dans la stratosphère. « Du 21 au 30 septembre, la superficie moyenne du trou de la couche d'ozone était la plus vaste que l'on ait jamais observée, soit 27,5 millions de kilomètres carrés », affirme Paul Newman, spécialiste de la science atmosphérique au Centre Goddard des vols spatiaux de la NASA, dans le Maryland. Selon un communiqué de presse conjoint de la NASA et de la NOAA daté du 19 octobre, lorsque les conditions météorologiques de la stratosphère sont normales, le trou de la couche d'ozone doit en principe mesurer de 23 à 24 millions de kilomètres carrés, soit environ la superficie de l'Amérique du Nord.
L'instrument de surveillance de l'ozone, placé sur le satellite Aura de la NASA, mesure la quantité totale d'ozone, du niveau du sol jusqu'à la couche supérieure de l'atmosphère, au-dessus de l'ensemble du continent antarctique. Le 8 octobre, cet instrument a enregistré une valeur basse de 85 unités Dobson au-dessus de la région est de la calotte glaciaire de l'Antarctique. Les unités Dobson mesurent la quantité d'ozone dans l'atmosphère au-dessus d'un point fixe. L'instrument de surveillance de l'ozone a été mis au point par l'Agence des Pays-Bas pour les programmes aérospatiaux de Delft, aux Pays-Bas, et par l'Institut météorologique d'Helsinki, en Finlande. Les scientifiques du Laboratoire de recherche des systèmes de la terre de la NOAA, au Colorado, se servent de ballons-sondes pour mesure l'ozone directement au-dessus du pôle Sud.
Destruction de la couche d'ozone stratosphérique
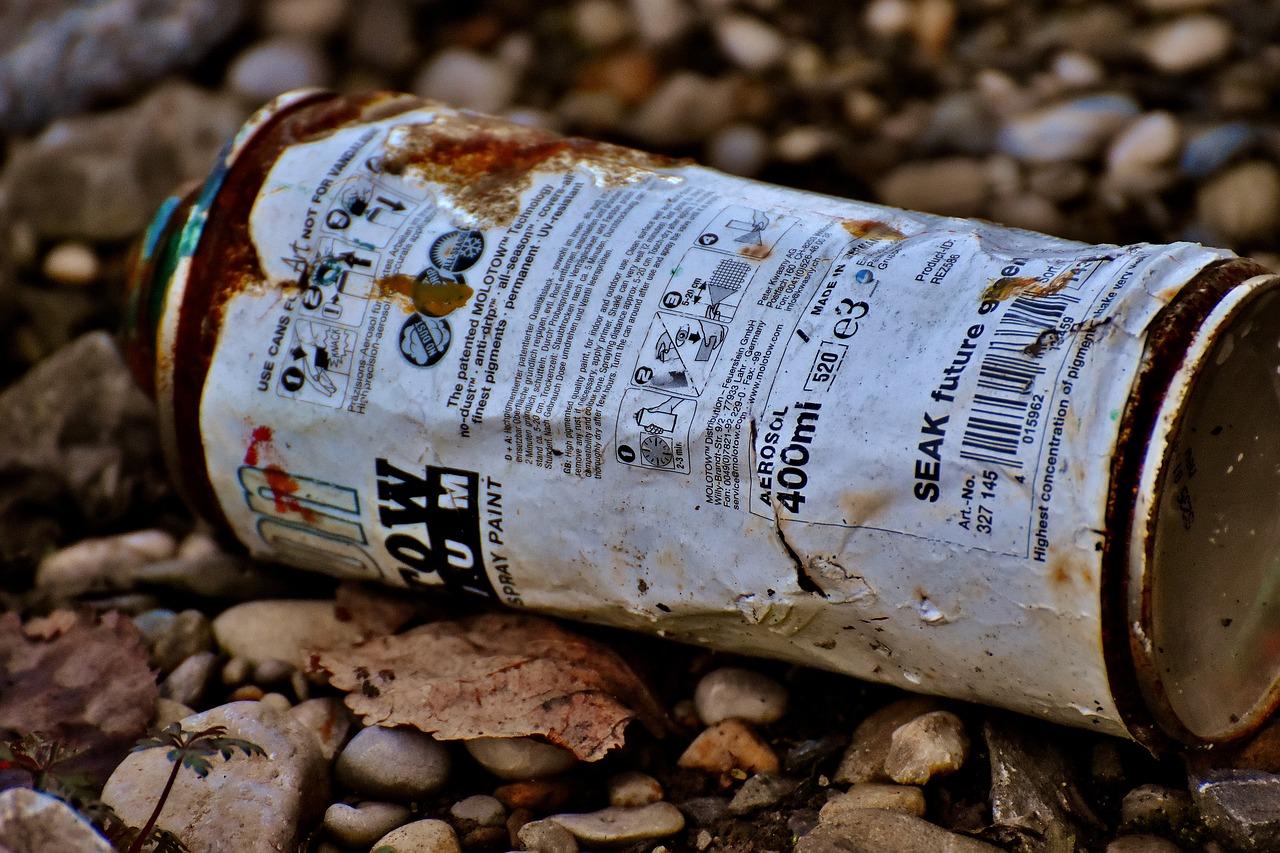
Le 9 octobre 2006 , la mesure de l'ozone avait fortement diminué, chutant de 300 unités Dobson à la mi-juillet à 93 unités Dobson, et presque toute l'ozone de la couche comprise entre 12,8 km et 21 km au-dessus de la surface de la terre avait été détruite. Dans cette couche cruciale, les instruments ont relevé une valeur record de 1,2 unité Dobson seulement, ce qui représente une chute vertigineuse par rapport aux 125 unités relevées en juillet-août dans des zones non affectées par l'appauvrissement de la couche d'ozone. « Ces chiffres signifient que l'ozone est quasiment inexistante dans cette couche de l'atmosphère », affirme David Hofmann, directeur de la Division de la surveillance mondiale du Laboratoire de recherche des systèmes de la terre de la NOAA. « La couche appauvrie en ozone est inhabituellement épaisse cette année. Il semble donc que le trou de la couche d'ozone atteindra des dimensions record en 2006. » Les observations d'Aura révèlent de très fortes concentrations de produits chlorés destructeurs d'ozone dans la basse stratosphère (environ 20 kilomètres d'altitude). Ces mesures élevées de chlore couvraient la totalité de l'Antarctique de la mi-septembre à la fin de ce mois et elles s'accompagnaient de très faibles mesures d'ozone.
Températures basses
La température de la stratosphère antarctique fait fluctuer l'ampleur du trou de la couche d'ozone d'année en année. Les températures plus basses que la moyenne produisent des trous plus larges et plus profonds que des températures plus chaudes. Les centres nationaux de prévision environnementale de la NOAA ont analysé les observations des températures stratosphériques relevées par les satellites et les ballons-sondes, et à la fin du mois de septembre 2006, les températures de la basse stratosphère au bord de l'Antarctique étaient inférieures d'environ 12,7 degrés Celsius à la moyenne, entraînant une augmentation de la superficie du trou qui est passée de 3,1 kilomètres carrés à 3,8 kilomètres carrés. La stratosphère de l'Antarctique se réchauffe avec le retour de la lumière solaire à la fin de l'hiver polaire et grâce à de vastes systèmes météorologiques (ondulations à l'échelle planétaire) qui se forment dans la troposphère et remontent dans la stratosphère. Lors de l'hiver et du printemps 2006 dans l'Antarctique, ces ondulations météorologiques planétaires ont été relativement faibles, entraînant des températures plus froides que la moyenne dans la stratosphère. « Le trou de la couche d'ozone vient d'atteindre des dimensions record », dit Craig Long des centres nationaux de prévision environnementale. Tandis que le soleil se lève plus haut dans le ciel de l'hémisphère Sud, aux mois d'octobre et de novembre, ce trou inhabituellement large et persistant peut laisser passer beaucoup plus d'ultraviolets que d'habitude jusqu'à la surface de la terre dans l'hémisphère Sud.

Rappel sur l'oxygène et le stress oxydatif
Le dioxygène est source de vie pour la majorité des organismes vivants sur terre, cependant il est également responsable de du vieillissement des cellules. En effet, l'oxygène a la propriété de former des radicaux libres, éléments très réactifs allant perturber les processus biologiques. Ainsi, c'est à cause de ces radicaux libres qu'il est possible d'observer la formation de rides de la peau et certains cancers notamment. Chimiquement, on considère un radical libre comme étant est un atome (ou une molécule) qui a perdu ou gagné un électron. Cette entité est par définition très instable car les électrons "veulent" toujours s'apparier (c'est pourquoi les atomes forment des molécules). L'instabilité des radicaux libres leur confère une grande réactivité avec les molécules du vivants. Ils ont en plus tendance à former de nouveaux radicaux libres par échanges d'électrons, ce qui entraîne de nombreuses réactions en chaîne, perturbant le cycle biochimique normal des cellules. Ce phénomène est également appelé stress oxydatif. Ainsi, de nombreuses marques cosmétiques, vantent les mérites de produits anti-oxydants efficaces pour traiter l'apparition des rides. Ces molécules ont la propriété d'être plus facilement attaquée que la peau, et donc échangent préférentiellement les électrons avec les radicaux libres pour former des éléments stables réduisant le risque de réaction en chaîne. Cependant, il ne faut pas rêver, il n'y a pas de miracle ! D'autant que souvent les principes actifs dans les produits cosmétiques ne sont pas très concentrés, ce qui limite leur champ d'action.
Résumer avec l'IA :














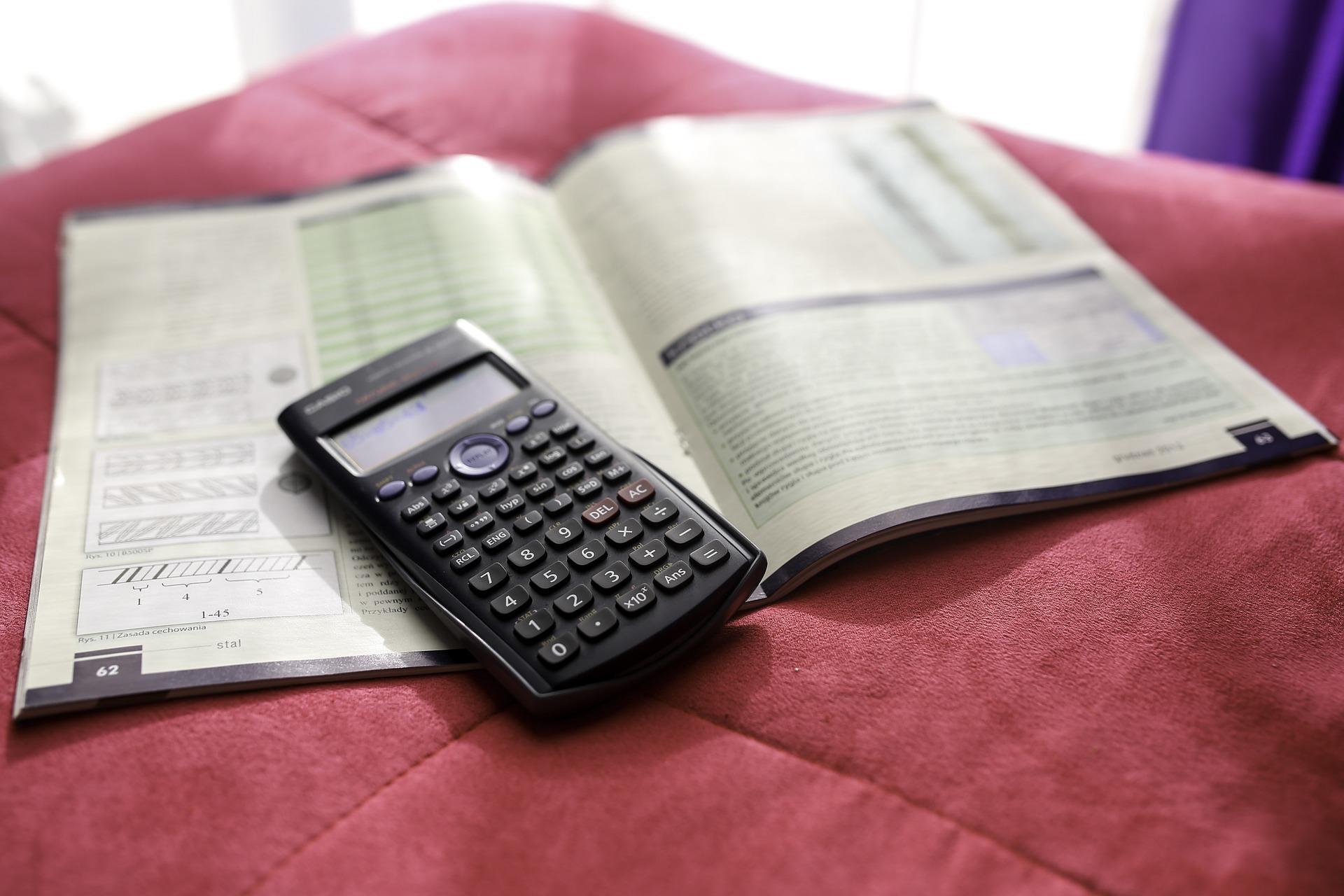




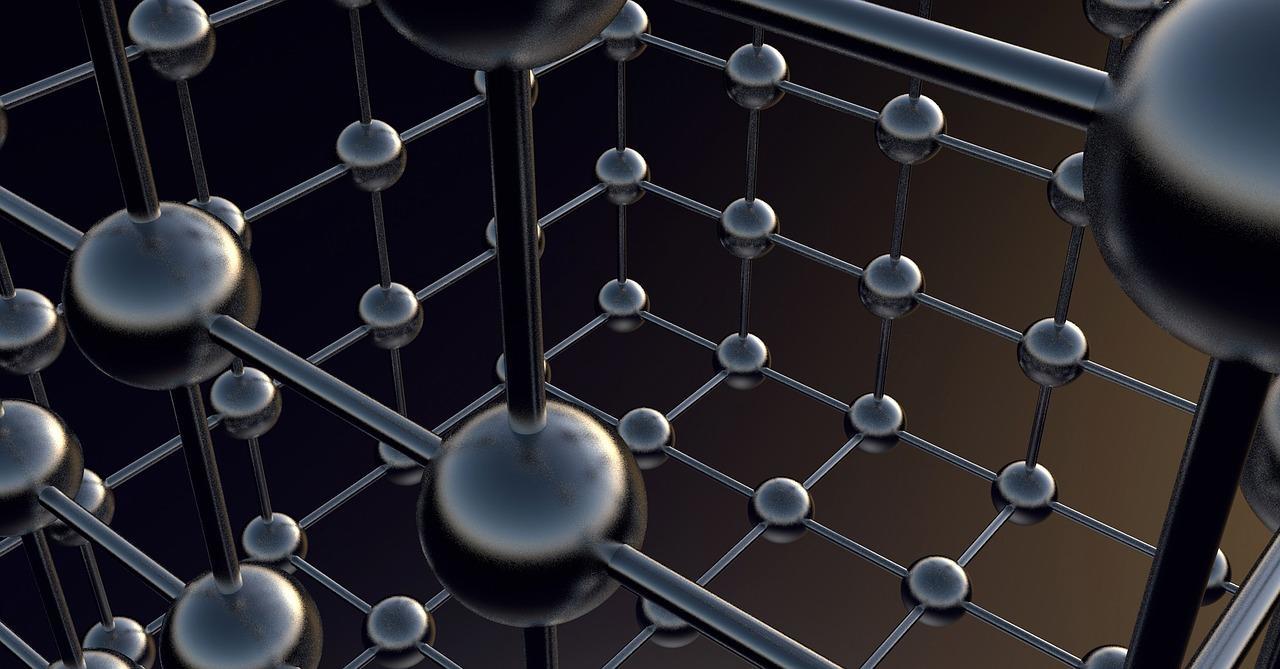



Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !