Chapitres

Notions étudiées et contenu associé

- Description des entités chimiques moléculaires
- Schéma de Lewis d’une molécule ou d’un ion polyatomique.
- Liaison covalente localisée et délocalisée.
- Ordres de grandeur de la longueur et de l’énergie d’une liaison covalente.
- Structure géométrique d’une molécule ou d’un ion polyatomique.
- Méthode VSEPR.
- Liaison polarisée.
- Molécule polaire.
- Moment dipolaire.
- Système physico-chimique
- Constituants physico-chimiques.
- Corps purs et mélanges : concentration molaire, fraction molaire, pression partielle.
- Composition d’un système physico-chimique.
- Forces intermoléculaires
- Interactions de van der Waals.
- Liaison hydrogène.
- Ordres de grandeur énergétiques.
- Les solvants moléculaires
- Grandeurs caractéristiques : moment dipolaire, permittivité relative.
- Solvants protogènes (protiques).
- Mise en solution d’une espèce chimique moléculaire ou ionique.
Capacités exigibles
- Établir un ou des schémas de Lewis pour une entité donnée et identifier éventuellement le plus représentatif.
- Identifier les écarts à la règle de l’octet.
- Identifier les enchaînements donnant lieu à délocalisation électronique.
- Mettre en évidence une éventuelle délocalisation électronique à partir de données expérimentales.
- Représenter les structures de type AXn, avec n ≤ 6.
- Prévoir ou interpréter les déformations angulaires pour les structures de type AXpEq, avec p+q =3 ou 4.
- Relier la structure géométrique d’une molécule à l’existence ou non d’un moment dipolaire permanent.
- Déterminer direction et sens du vecteur moment dipolaire d’une molécule ou d’une liaison.
- Recenser les constituants physico-chimiques présents dans un système.
- Décrire la composition d’un système à l’aide des grandeurs physiques pertinentes.
- Lier qualitativement la valeur plus ou moins grande des forces intermoléculaires à la polarité et la polarisabilité des molécules.
- Prévoir ou interpréter les propriétés liées aux conformations ou aux propriétés spectroscopiques d’une espèce.
- Prévoir ou interpréter les propriétés physiques de corps purs par l’existence d’interactions de van der Waals ou de liaisons hydrogène inter ou intramoléculaires.
- Interpréter la miscibilité ou la non-miscibilité de deux solvants.
- Élaborer et mettre en œuvre un protocole pour déterminer la valeur d’une constante de partage.
- Justifier ou proposer le choix d’un solvant adapté à la dissolution d’une espèce donnée, à la mise en œuvre de certaines réactions, à la réalisation d’une extraction et aux principes de la chimie verte.
Où trouver des cours de physique en ligne ?
Description des entités chimiques moléculaires
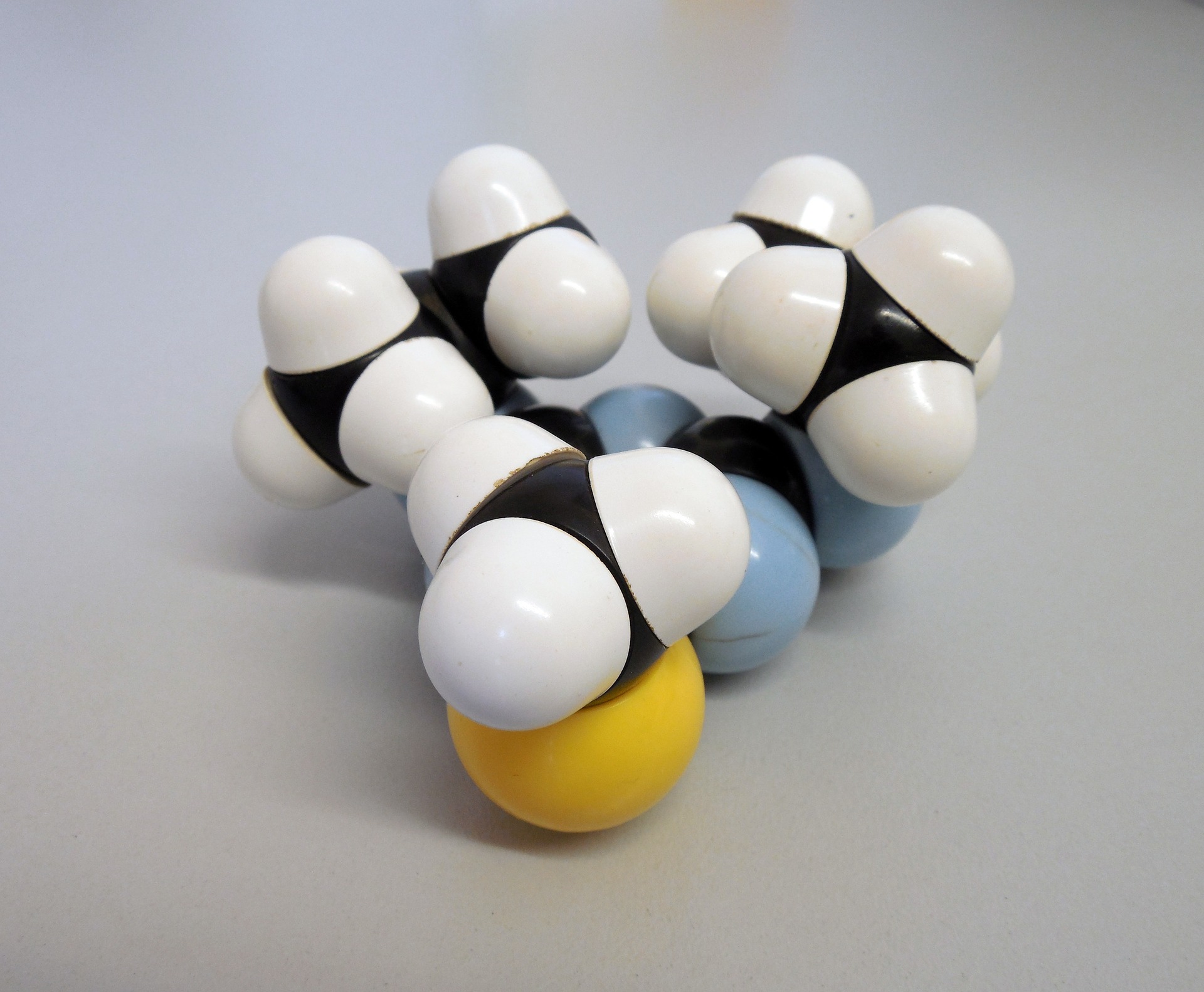
La représentation de Lewis
La représentation de Lewis d'une molécule fait apparaître tous les atomes de la molécule ainsi que tous les doublets liants et non liants le cas échéant.
Dans la représentation de Lewis, la règle du "duet" doit être satisfaite pour chaque atome d'hydrogène et la règle de "l'octet" doit être satisfaite pour tous les autres atomes.
Les doublets liants ont été définis précédemment comme les doublets mis en commun entre deux atomes. Ce sont eux qui assurent les liaisons entre les atomes.
Les doublets non liants sont les paires d'électrons qui ne servent pas de liaisons entre deux atomes.
Établir une représentation de Lewis d'une molécule
- Déterminer le nombre d'électrons périphériques apportés par chaque atome de la molécule.
- Déterminer le nombre total n d'électrons périphériques de la molécule.
- En déduire le nombre de doublets (liants et non liants) à répartir dans la molécule. Pour cela il suffit de diviser n par 2.
- Déterminer le nombre de liaisons qu'établit chaque atomes de la molécule (voir 1.2). Cette opération donne le nombre de doublets liants.
- En déduire le nombre de doublets non liants et les répartir autour des atomes en respectant la règle de l'octet.
- Les doublets liants sont représentés par un tiret rouge et les doublets non liants sont représentés par un tiret bleu.
Exemple : on veut représenter le modèle de Lewis de la molécule de chlorure d'hydrogène HCl. (H: Z=1; Cl: Z=17.)
- H: 1 électron périphérique. Cl : 7 électrons périphériques.
- n=1+7 ou n=8
- Le nombre de doublets est alors 4
- H établit 1 liaison covalente et Cl établit 1 liaison covalente. Ce qui correspond à un doublet liant mis en commun entre ces deux atomes.
- Il reste donc 3 doublets non liants qui seront répartis autour de l'atome de chlore de façon à respecter la règle de l'octet. Le respect de la règle du duet est assuré pour l'atome d'hydrogène par la présence du doublet liant.
Besoin d'un professeur physique chimie ?
Molécules et représentation en perspective de Cram
Certaines molécules à géométrie spatiale (3 dimensions) sont difficiles à représenter dans le plan de la feuille (2 dimensions). On utilise alors un mode de représentation dit représentation de Cram dont les conventions sont les suivantes :
- Les liaisons situées dans le plan de la feuille sont dessinées en traits pleins.
- Les liaisons situées en avant du plan de la feuille sont dessinées en traits épaissis.
- Les liaisons en arrière du plan de la feuille sont dessinées en pointillés.
Les conventions et deux exemples sont représentés ci-contre (1) conventions, (2) méthane, (3) ammoniac).
Molécule et géométrie : La théorie VSEPR

La théorie VSEPR , signifiant en Anglais Valence Shell Electron Pair Repulsion, encore noté RPECV en Français, signifie « répulsion des paires électroniques de la couche de valence ». Cette théorie correspond à une méthode destinée à prédire la géométrie des molécules. Cela est possible en se basant sur la théorie de la répulsion des électrons de la couche de valence, également connue sous le nom de « théorie de Gillespie »
Prérequis et supposition
Exemple : avec une formule VSEPR, c'est à dire Valence Shell Electron Pair Repulsion, en AX5, le pentachlorure de potassium, de formule PCl5, possède une structure en bipyramide trigonale. Cela signifie qu'il possède deux types de chlore dont :
- Trois atomes de chlore équatoriaux, c'est à dire à 120° les uns des autres
- Et deux atomes de chlore apicaux.
Labilité de la structure
Une fois que l'on est sûr que la molécule est la bonne, il peut être intéressant d'avoir recourt à une formule VSEPR, c'est à dire Valence Shell Electron Pair Repulsion, afin de décrire la structure de la molécule.
En effet, en prenant l'exemple d'une structure en bipyramide trigonales, on considère la molécule présente une structure labile. Cela signifie que, par une pseudorotation de Berry, les deux atomes apicaux peuvent s'échanger avec deux atomes équatoriaux tandis que le troisième atome, qui reste donc inchangé, est appelé pivot de la pseudorotation.
On peut alors, via la description VSEPR d'une molécule, décrire sa labilité.
Prérequis et supposition
La méthode VSEPR est fondée sur un certain nombre de suppositions qui concernent principalement la nature des liaisons entre atomes :
- les atomes dans une molécule sont liés par des paires d'électrons ;
- deux atomes peuvent être liés par plus d'une paire d'électrons. On parle alors de liaisons multiples ;
- certains atomes peuvent aussi posséder des paires d'électrons qui ne sont pas impliqués dans une liaison. On parle de doublets non liants ;
- les électrons composant ces doublets liants ou non liants exercent les uns sur les autres des forces électriques répulsives. Les doublets sont donc disposés autour de chaque atome de façon à minimiser les valeurs de ces forces ;
- les doublets non liants occupent plus de place que les doublets liants ;
- les liaisons multiples prennent plus de place que les liaisons simples.
Notation
Dans la théorie VSEPR, il y a certains usages de notation à respecter :
- On note l'atome central de la molécule étudiée A.
- Les doublets non-liants, et donc les paires d'électrons appartenant à l'atome central A qui se sont pas impliqués dans les liaisons sont notés E et m leur nombre.
- Les doublets liants, et donc paires d'électrons qui sont impliqués dans des liaisons entre l'atome central A et un autre atome sont notés X. Le nombre de doublets liants sera noté n.
Les molécules simples, dont la géométrie est facilement définissable grâce à la méthode VSEPR sont donc notés suivant la notation vu ci-dessus et se présentent donc sous la forme : AXnEm
Formation d'une molécule : la liaison covalente
Définition
Une liaison covalente entre deux atomes correspond à la mise en commun entre ces deux atomes de deux électrons de leurs couches externes pour former un doublet d'électrons appelé doublet liant.
Le doublet liant, mis en commun entre les deux atomes, est considéré comme appartenant à chacun des atomes liés.
Nombre de liaisons covalentes établies par un atome
Le nombre de liaisons covalentes que peut former un atome est égal au nombre d'électrons qu'il doit acquérir pour saturer sa couche externe à un octet d'électrons (ou un duet pour l'atome d'hydrogène).
Forces intermoléculaires
Les forces de Van Der Waals
Nommées ainsi en l'honneur de Johannes Diderik van der Waals, un physicien néerlandais du XIX ème siècle, ces forces peuvent se décrire comme les interactions électroniques entres les atomes ou molécules, qui les lient ensemble.
Johannes Diderik van der Waals fut le premier a les prendre en compte dans es calculs en 1873. Cela lui valut de recevoir en 1910 le prix Nobel de physique.
Un prix Nobel, Nobelpriset de son nom original en suédois, est une récompense au niveau mondial qui gratifie son détenteur d’être l’une des personne ayant apporté le plus grand bénéfice à l’humanité. C’est un prix qui se remet tous les ans.Le premier a été remis en 1901. Ils récompensent des découvertes ou un travail en faveur de la paix.
Il en existe 5 : le prix Nobel de physique, le prix Nobel de chimie, le prix Nobel de la paix, le prix Nobel de médecine et de physiologie et le prix Nobel de littérature.
Ce phénomène s'explique par la répartition des charges au sein d'une molécule ou au sein des couples d'atomes. Pour plus de détails, il faut néanmoins se plonger dans la physique quantique pour en comprendre les principes les plus poussés.
On peut leur trouver trois origines :
- L'interaction électrostatique attractive entre deux multipôles induits, il s'agira dans ce cas des forces de London ;
- L'interaction attractive entre un multipôle permanent et un multipôle induit et il s'agira des forces de Debye ;
- L'interaction électrostatique attractive ou répulsive entre deux multipôles permanents selon leurs orientations, il s'agit alors des forces de Keesom.
Les exemples les plus flagrants des effets des forces de Van Der Waals sont les absorptions par capillarité ainsi que les systèmes d'accroche des pattes de gecko qui peuvent coller aux murs.
La polarisation
Électronégativité des atomes
Dans le domaine de la chimie, on décrit l'électronégativité comme étant une grandeur physique caractérisant la capacité d'un atome à attirer un ou plusieurs électrons lors de la formation d'une liaison chimique avec une autre espèce.
Selon leur configuration électronique, certains atomes capteront les électrons facilement alors que d'autres n'y arriveront pas. Par exemple, l'atome de fluor a pour configuration k2l7, il gagnera facilement un électron pour saturer la couche l.
La facilité des atomes à capter un électron s'appelle l'électronégativité. Dans le tableau périodique, les atomes les plus électronégatifs se trouvent en haut à droite.
Polarité d'une liaison chimique
Lorsque deux atomes sont liés chimiquement, c'est qu'ils mettent en commun deux électrons. Les deux électrons sont alors en orbite autour des deux noyaux, ils forment alors la liaison.
Dans le cas de deux atomes identiques, le doublet est également partagé et symétrique par rapport à l'axe de liaison.
Dans le cas où, les deux atomes sont différents, celui qui est le plus électronégatif attire plus fortement le doublet. Le nuage électronique est alors plus dense du côté de l'atome le plus électronégatif et crée une charge négative à cet endroit et positive sur l'autre atome. Une telle molécule possède deux pôles électriques, on dit qu'elle est polarisée.
Cristaux, solution et solvant
On appelle solution électrolytique toute solution obtenue par la dissolution d'une substance appelée soluté dans un liquide que l'on appelle solvant. Le soluté peut être sous la forme de solide, de gaz ou de liquide et si l'eau constitue le solvant de la solution, on parle alors de solution aqueuse. De ce fait, une solution électrolytique correspond à une solution contenant des ions. Elle est alors conductrice tout en étant électriquement neutre.
Le cristal ionique et ses propriétés

Les cristaux ioniques sont constitués d'anions et de cations tenus entre eux par l'attraction électrique. Cette attraction est responsable de la structure géométrique qu'adoptent les ions pour former un cristal. Un ion positif va s'entourer d'ions négatifs et réciproquement et de la même manière que les atomes ou molécules forment les solides, les ions forment les cristaux.
Exemple : Dans un cristal de chlorure de sodium NaCl, les ions adoptent une structure cubique où un anion est entouré de 6 cations. Un cristal ionique est toujours électriquement neutre donc il y a autant de charges positives que négatives. Par conséquent, certains cristaux possèdent plus d'anions et de cations (ou inversement).
Cohésion des cristaux ioniques
Les ions étant jointifs, la distance qui les sépare correspond à la distance entre leur centre. La cohésion du cristal est due à l'interaction coulombienne qui correspond à la force qui lie deux ions. La valeur de cette force peut paraître faible mais elle est bien plus importante par rapport au poids de l'ion. A cette échelle, c'est la force électrique qui domine. La température de fusion des solides ioniques est assez élevée (801 °C) pour le sel, ce qui veut dire que les liaisons entre ions sont très solides.
La loi de Coulomb
Coulomb, un physicien français, a établi en 1758 que le champ doit varier comme le carré inverse de la distance entre les charges à une précision de 0,02 sur l'exposant avec l'aide d'un dispositif appelé balance de Coulomb. Cette balance est constituée d'un fil de torsion en argent sur lequel est fixé des matériaux chargés. Ainsi, la loi d'attraction entre deux charges ponctuelles notées q1 et q2 , fixes dans le référentiel défini et séparées par une distance r, se définit ainsi :
- La force est dirigée selon la droite reliant les deux charges ;
- Elle est attractive si les charges sont de signes opposée et répulsive sinon ;
- Son intensité est proportionnelle aux valeurs de q1 et q2 et varie en raison inverse du carré de la distance r.
Il est alors possible de traduire ces caractéristiques en une formule exprimant la force exercée par q1 sur q2 : [ overrightarrow{ f _ { e } } = \frac { 1 } { 4 pi epsilon _ { 0 } } \frac { q _ { 1 } q _ { 2 } }{ r ^ { 2 } } overrightarrow { e _ { r } } ] Avec :
- [ overrightarrow { e _ { r } } ] le vecteur unitaire de la droite reliant q1 et q2 qui est dirigée dans le sens 1 vers 2
- [ epsilon _ { 0 } ] la permittivité diélectrique du vide
Ce qui peut rendre la compréhension de cette formule compliquée est la notion de force à distance. En effet, comment une charge peut savoir qu'une autre charge ponctuelle se trouve à une certaine distance d'elle et alors exercer sur force sur cette charge en fonction de la distance qui les sépare. Dans ce cas, tout comme pour un champ gravitationnel, il peut être utile de séparer dans la loi de force ce qui dépend de la charge subissant la force et donc d'obtenir la relation suivante : [ \begin{cases} overrightarrow { f } = q _ { 2 } left[ \frac { 1 } { 4 pi epsilon _ { 0 } } \frac { q _ { 1 } } { r ^ { 2 } } overrightarrow { e _ { r } } right] = q _ { 2 } overrightarrow { E } overrightarrow{ E } = \frac { 1 } { 4 pi epsilon } \frac { q _ { 1 } } { r ^ { 2 } } overrightarrow { e _ { r } } \end{cases} ] Avec :
- [ overrightarrow { E } ] un champ électrique électrostatique créé à partie de la charge q1 au point où se trouve la seconde charge q2
Ainsi, avec cette relation, il est plus aisé d'interpréter l’existence d'une force à distance. En effet, la charge considérée comme "source", c'est-à-dire q1, crée en tout point de l'espace un champ électrique dont la forme est donnée par la relation exprimée ci-dessus, et une charge quelconque considérée comme "test" subira l'effet de ce champ sous la forme d'une force égale au produit de cette charge par le champ électrostatique. Dans ce cas, ce champ électrostatique apparaîtra comme la force entre deux particules ponctuelles fixes par unité de charge.
Résumer avec l'IA :
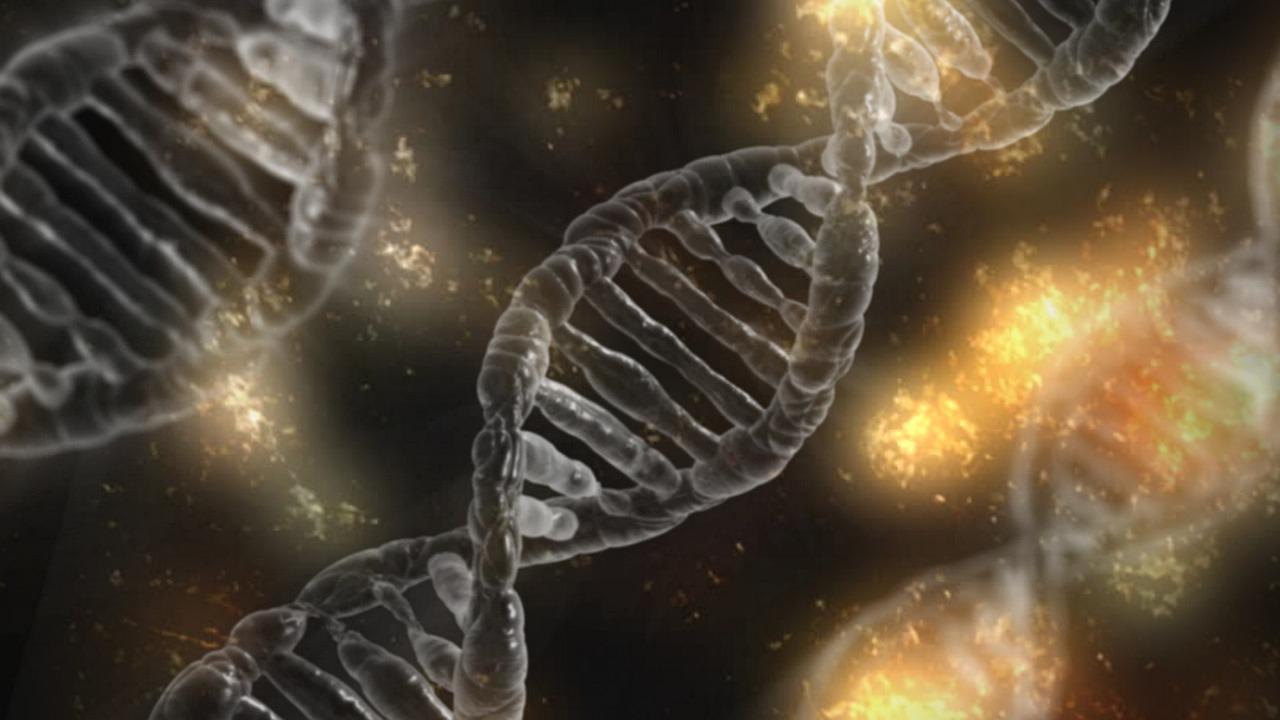













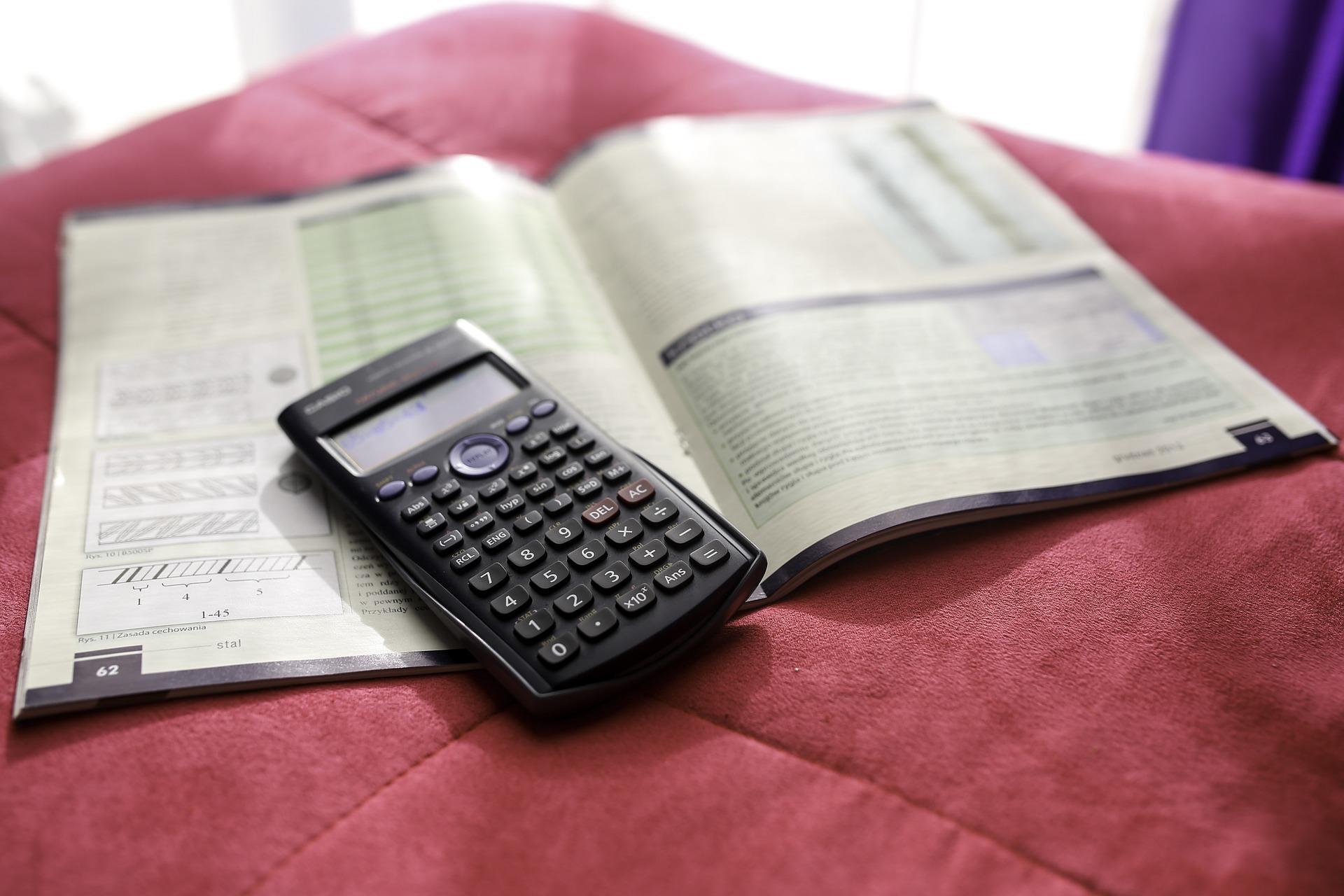




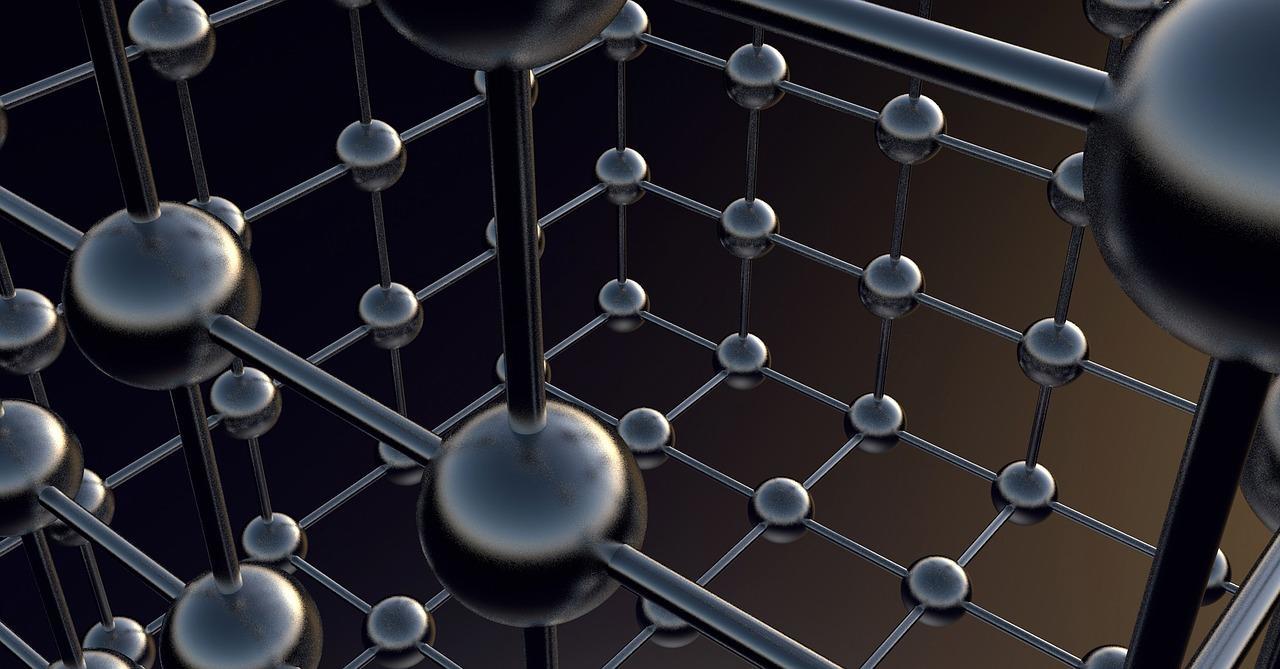


Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !