Chapitres
- 01. La radioactivité
- 02. L'histoire de la radioactivité
- 03. Le vocabulaire de la radioactivité
- 04. Fission et fusion nucléaire
- 05. Fission et fusion
- 06. La décroissance radioactive d'un radioisotope
- 07. L'activité d'une source radioactive
- 08. Pierre et Marie Curie
- 09. Voyage dans l'espace : attention à la radioactivité

La radioactivité

La radioactivité bêta
La radioactivité bêta est un type de désintégration radioactive où une particule bêta (électron ou positron) est émise. On parle de radioactivité bêta + quand un positron est émis mais on parle de radioactivité – quand c’est un électron qui est émis
La radioactivité alpha
La radioactivité alpha est un rayonnement provoqué par une désintégration alpha qui est une désintégration radioactive où un noyau atomique éjecte une particule alpha qui se transforme en un autre noyau dont le nombre de masse est diminué de 4 et le numéro atomique de 2 à cause de la particule alpha manquante qui est analogue au noyau d’hélium 4
Il est possible de considérer le Soleil comme un puissant générateur nucléaire car, en son sein, de nombreuses réactions atomiques se produisent
La radioactivité gamma
La radioactivité gamma est un rayonnement provoqué par une désintégration gamma. Le plu souvent, ces désintégrations accompagnent des désintégrations alpha ou bêta. En effet, quand il émet un rayon alpha ou bêta, le noyau devient excité. Lors de l’émission d’un rayonnement électromagnétique gamma, le noyau peut donc redescendre à un état plus stable
L'histoire de la radioactivité

Marie Skłodowska-Curie est une physicienne et chimiste d’origine polonaise. Elle est très connue pour sa découverte de la radioactivité naturelle et des éléments 84 et 88 : le polonium et le radium. Elle reçut de multiples prix et distinctions pour ses recherches. Elle reçut en 1903 le prix Nobel de physique et en 1911 le prix Nobel de chimie. C’était la première femme à recevoir ce genre de distinction et encore à ce jour elle est la seule à en avoir reçu deux
Le vocabulaire de la radioactivité
Le vocabulaire associé pour comprendre la notion
Isomère nucléaire
Des isomères nucléaires sont des atomes qui partagent le même noyau mais dans états énergétiques différents. C’est à dire qu’ils comportent un spin et une énergie d’excitation spéciaux. Dans leur état d’énergie le plus bas, on dit qu’ils atteignent l’état fondamental.
Capture électronique
La capture électronique, aussi appelée désintégration ε, est un processus de physique radioactive lors duquel un noyau d’atome qui est en manque de neutrons absorbe un électron de la couche électronique de son atome
Produit de désintégration
On appelle produit de désintégration le nucléide descendant d’un désintégration radioactive d’un nucléide précédent
Fission spontanée
La fission spontanée est un phénomène de désintégration radioactive selon lequel un noyau lourd d’un atome se divise pour former au moins deux noyaux plus petits
Période radioactive
On appelle période radioactive le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux d’un isotope radioactif se désintègre de manière naturelle. Cette période n’est influencée en aucun cas par les conditions de l’environnement, que ce soit la température, la pression ou encore le champ magnétique, elle est propre à l’isotope en question. Statistiquement, on peut dire que la période radioactive est le temps à l’issue duquel le noyau de l’atome a 50 % de chances de s’être désintégré
Bombe H
Une bombe H, connue sous les noms de bombe à hydrogène, bombe à fusion ou encore bombe thermonucléaire est une bombe nucléaire qui tire son énergie de la fusion de noyaux légers comme ceux de l’hélium ou du deutérium par exemple
Bombe A
Une bombe A, connue également sous le nom de bombe atomique, bombe nucléaire ou encore bombe à fission est une bombe nucléaire qui tire son énergie de la fission d’éléments radioactifs comme le plutonium ou l’uranium. Ce fut les premières bombes atomiques ayant servi d’armes nucléaires lors de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi les seules bombes ayant été utilisés lors de conflits. Little Boy et Fat Man, les bombes nucléaires de l’armée américaine ayant touché respectivement Hiroshima et Nagasaki en sont deux exemples. 
Fission et fusion nucléaire
Fission et fusion
La fission : les centrales nucléaires
La fission spontanée est un phénomène de désintégration radioactive selon lequel un noyau lourd d’un atome se divise pour former au moins deux noyaux plus petits
Plus précisément, la fission est une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau père lourd se scinde en noyau plus léger sous l'impact d'un neutron. Les noyaux qui peuvent subir la réaction de fission sont des noyaux dits fissiles.
La réaction de fission libère deux ou trois autres neutrons qui vont pouvoir encore à leur tour casser d'autres noyaux, c'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Elles ne sont pas contrôlées dans les bombes atomiques : Bombe A.
Une bombe A, connue également sous le nom de bombe atomique, bombe nucléaire ou encore bombe à fission est une bombe nucléaire qui tire son énergie de la fission d’éléments radioactifs comme le plutonium ou l’uranium. Ce fut les premières bombes atomiques ayant servi d’armes nucléaires lors de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi les seules bombes ayant été utilisés lors de conflits. Little Boy et Fat Man, les bombes nucléaires de l’armée américaine ayant touché respectivement Hiroshima et Nagasaki en sont deux exemples Une bombe H, connue sous les noms de bombe à hydrogène, bombe à fusion ou encore bombe thermonucléaire est une bombe nucléaire qui tire son énergie de la fusion de noyaux légers comme ceux de l’hélium ou du deutérium par exemple
La fusion
Réaction nucléaire au cours de laquelle des noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd. Le type de réaction qui a lieu sur les étoiles en général est une réaction qui n'est pas contrôlée. Pour amorcer cette réaction, il faut des températures très élevées (thermonucléaires).
La décroissance radioactive d'un radioisotope
Quelque soit le radioisotope, il a autant de chance qu'un autre radioisotope de la même espèce de se désintégrer à un instant t. Il faut néanmoins savoir que la désintégration ne dépend pas des condition physico-chimique dans lesquels le nucléide étudié se trouve. En effet, on parle de la loi de désintégration radioactive comme étant une loi statique. La loi s'énonce ainsi : Soit N(t) le nombre de radionucléides d'une espèce donnée présents dans un échantillon à un instant t quelconque. Puisque la probabilité de désintégration d'un radionucléides quelconque ne dépend ni du milieu qui l'entour, ni de la présence d'autres espèces de radionucléide, le nombre total de désintégration, noté dN, pendant un intervalle de temps dt est proportionnel au nombre N de radionucléide de la même espèce présents mais aussi proportionnel à la durée dt de l'intervalle de réaction. On obtient alors la formule : [ text { d} N = - lambda times N times text{ d} t ] On peut observer le signe - puisque le nombre N de radionucléides diminue au cours du temps. Si on intègre l'expression obtenue précédemment, on trouve alors la loi de décroissance exponentielle du nombre N(t). Ainsi, si on note N0 le nombre de radionucléides présents à l'instant t = 0, on obtient l'expression suivante : [ N left( t right) = N _ { 0 } times e ^{ - lambda times t } ] Si on note t1/2 la demie vie de l'élément étudié, il est possible d'obtenir l'expression suivante : [ lambda = \frac { ln left( 2 right) } { t _ { \frac { 1 } { 2 } } } ]
L'activité d'une source radioactive

Pour un échantillon de noyaux radioactifs, le temps de demi-vie est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux présents à un instant t se soit désintégrée.
Pour rappel, il faut des millions de Becquerels pour que cela devienne dangereux pour l'Homme. Dans le cas où les radioisotopes sont dans un mélange, plus la demie-vie de celui-ci est courte et plus son activité massique sera forte.
Pierre et Marie Curie
La première chronique de l'année scolaire met à l'honneur une femme de Sciences française d'origine polonaise, née en 1867, connue et admirée par tous, Marie Curie. Célèbre pour son immense talent scientifique qui lui valut deux prix Nobel, elle a formé avec son mari Pierre Curie, excellent physicien également un couple scientifique de renom.
Excellente élève, passionnée par ses études, elle vient à Paris en 1892 pour les poursuivre en Sciences Physiques et Mathématiques sur les bancs de la Sorbonne. En trois ans elle obtient brillamment les licences dans les deux matières. En 1895, elle épouse Pierre Curie et en 1896, elle est reçue première à l'agrégation de Physique.
C'est en 1897 qu'elle débute ses travaux sur les rayonnements émis par l'uranium, découvert par Becquerel rejointe dès 1898 par son mari. Dans des conditions très inconfortables, ils parviennent cependant à découvrir deux nouveaux éléments radioactifs, le polonium et le radium et recoivent pour leurs travaux sur la radioactivité le prix Nobel de Physique avec Becquerel.
En 1906, Pierre Curie décède brutalement, renversé par une voiture à cheval. Elle le remplace pour ses cours à la Sorbonne et devienr professeur titulaire en 1909. Elle est alors la première femme nommée à ce poste! En 1911, elle reçoit le prix Nobel de Chimie pour ses travaux sur les éléments chimiques radium et polonium.
Grâce à elle, ouvre en 1914 l'institut du radium chargé de la recherche contre le cancer et son traitement par radiothérapie. Pendant la seconde guerre mondiale, elle organise les services radiologiques aux armées et crée en particulier des voitures de radiologie, les "Petites Curies", qui s'approchent du front.
Elle meurt en 1934 d'une leucémie, due à une exposition trop importante aux rayons mais elle travaille jusqu'au bout.
Pierre et Marie Curie ont eu deux filles : Eve et Irène. C'est Irène qui poursuivra l'aventure scientifique de sa mère. Elle aussi formera avec son mari, Frédéric Joliot un couple de physiciens célèbre.
Voyage dans l'espace : attention à la radioactivité
Dans l'espace, les rayonnements nucléaires auxquels peuvent être soumis les astronautes ne proviennent pas de matériaux radioactifs qui auraient pu être embarqués dans les stations spatiales. En effet, ces rayonnements ont pour source le Soleil où de nombreuses fusions nucléaires à très grande échelle ont lieu. Ainsi, lors de ces fusions, des noyaux légers, tels que l'hydrogène, fusionnent afin de constituer des noyaux plus lourds tout en libérant une importante quantité d'énergie sous la forme de rayonnement radioactif. Il serait alors intéressant de calculer l'activité nucléaire du Soleil : La notion d'activité est étroitement liée avec la décroissance radioactive. En effet, l'activité d'une source correspond à l'expression du nombre de désintégrations par secondes d'un atome composé d'un certain nombre de noyaux radioactifs. Cette grandeur s'exprime habituellement en becquerels de symbole Bq. On peut donc en déduire un taux de désintégration des noyaux atomiques. Cependant, l'utilisation de cette unité pose parfois des problèmes. En effet, le becquerel est une unité petite. Par exemple, un élément radioactif dont la durée de demie-vie est d'un million d'années, une mole de cet élément aura une activité de 20 x 109 Bq.
Pour un échantillon de noyaux radioactifs, le temps de demi-vie est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux présents à un instant t se soit désintégrée.
Pour rappel, il faut des millions de Becquerels pour que cela devienne dangereux pour l'Homme. Dans le cas où les radioisotopes sont dans un mélange, plus la demie-vie de celui-ci est courte et plus son activité massique sera forte.
Résumer avec l'IA :














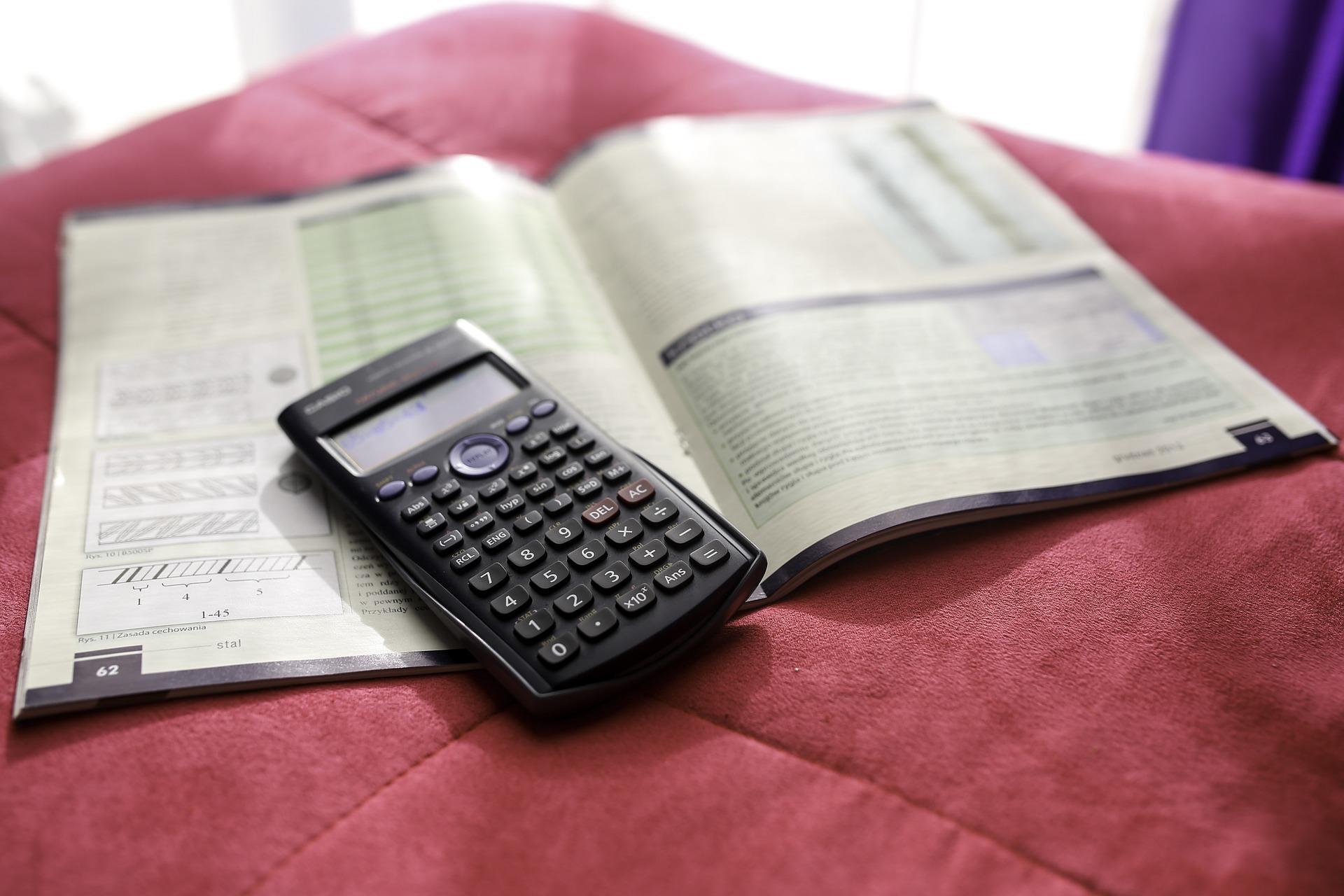




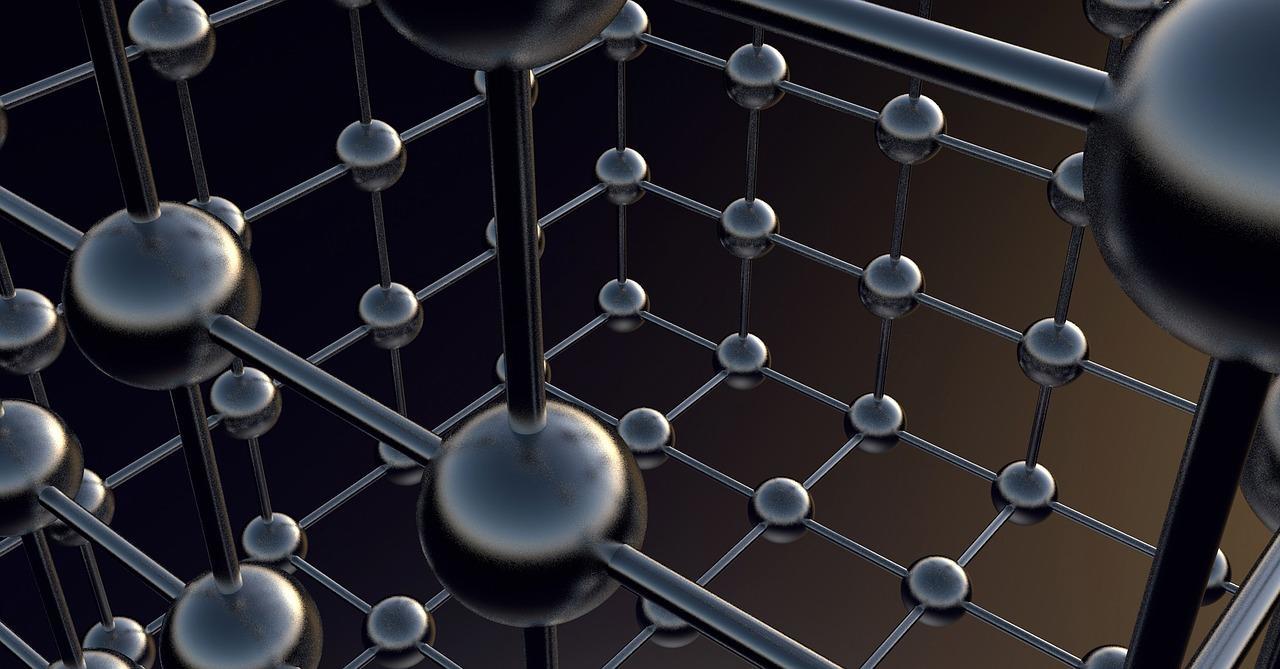



Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !
bonsoir , comment passez vous de la fréquence sonore a la longueur d’onde du son?
Bonjour,
Pour obtenir la longueur d’onde à partir de la fréquence, il suffit d’utiliser l’égalité suivante : \[ \lambda = \fraccf \] donc \[ f = \fracc\lambda \]
Une femme et une scientifique admirable ! Merci de nous la faire (re-)découvrir.