Chapitres
| Lecture Analytique & Commentaire : De ( Première S |


1 : Introduction. ( Présentation de l'auteur, remise en place du contexte )
L'esclavage est acceptée unanimement au 17e – siècle.
L'esclavage est sois disant utile économiquement car l'esclavage
apparaît comme un pilier du développement des colonies nouvelles
surtout sur le plan de l'agriculture. Le « Code Noir »
conçu par Colbert incite à réprimer toutes formes d'insoumissions
et ce code continue d'être appliqué au 18e – siècle.
Les philosophes des Lumières soulèvent ce problème en réclamant
l'égalité et non sans contradiction : Voltaire engage des capitaux
auprès d'armateurs qui pratiquent la traite des Noirs. Après la
déclaration de l'homme et du citoyen en 1789, le pouvoir économique
de la bourgeoisie obtient le rétablissement de l'esclavage.
Montesquieu vient d'une famille de parlementaires, fait des études
de droit et finit par se consacrer avec culture : C'est la
publication en 1721 des lettres persanes qui le rend célèbre. En
1728, il débute un grand voyage en Europe. A travers celui-ci, il
multiplie les rencontres et s'informe sur les mœurs, les systèmes
politique, l'économie...
Au fur et à mesure, le romancier s'efface au profit de l'historien
( notamment lors de la publication de son œuvre majeure : De
l'esprit des Lois en 1748. ).
Les lettres persanes montrent deux persans qui arrivent à Paris et
qui s'étonnent des actuels coutumes françaises. Cela permet à
l'écrivain de se moquer du pouvoir et de faire réfléchir le
lecteur sur ses préjugés.
De l'esprit des Lois s'interroge sur les systèmes politiques et sur
les liens entre les types de gouvernement, la mode, le climat et
l'économie du pays. En 1748, ce livre est dénoncé par l'église et
interdit par le pape.
En résumé, Montesquieu se moque de la monarchie absolu de façon
ironique et légère dans son premier ouvrage, mais de manière
beaucoup plus rigoureuse et théorique dans son dernier. Pour
Montesquieu, le pouvoir idéal repose sur la monarchie modérée et
sur la séparation des pouvoirs.
L'homme doit refuser l'autorité quand elle est injuste ou
déraisonnable...
2 : Lecture Analytique du Texte.
| I : Une 1 : La posture du 2 : Des arguments 3 : L'ironie à II : Un plaidoyer 1 : Un plaidoyer 2 : Un réquisitoire 3 : Un
|
3 : Rédaction du Commentaire.
Dès le départ,
l'auteur exprime le contraire de sa pensée. La phrase d'introduction
avec l'utilisation de la première personne situe Montesquieu non pas
du côté des opposants mais du côté des esclavagistes. C'est en
adoptant ce point de vue que l'auteur en montre l'absurdité. Les
expressions « si j'avais à soutenir » et « ce que
je dirais » montrent par l'emploi du conditionnel que
l'hypothèse est théorique et que l'argumentation développée ne
correspond pas en réalité aux sentiments de l'auteur. C'est le
choix de l'ironie.
A travers l'utilisation
d'arguments absurdes et spécieux le narrateur souligne l'absurdité
de l'argumentaire des esclavagistes :
✖ Il montre comme
logique le fait de légitimer l'esclavage des noirs d'Afrique,
sachant que les peuples ont exterminé les peuples d'Amérique. Il
fait d'une injustice abominable la cause d'une autre injustice ce qui
relève de la totale mauvaise foi.
✖ L'égoïsme
économique : Il justifie l'esclavage par l'importation de produit de
luxe comme le sucre. Par cette idée, il dénonce également le
comportement des capitalistes et le fonctionnement du marché de
consommation.
✖ La contradiction par
rapport aux préceptes religieux : La religion catholique qui dit
l'amour de Dieu pour les hommes et d'égalité des hommes devant Dieu
devrait prôner la reconnaissance des noirs comme des frères
humains. Cependant, c'est tout le contraire qu'affirme l'esclavagiste
: « On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu [ … ] ait mis
un âme, surtout une âme bonne dans un corps tout noir. ».
✖ L'usage de
l'antiphrase qui est l'outil principal de l'ironie : Le narrateur se
sert à de multiples reprises de l'antiphrase pour faire entendre de
ce qu'il dit : « Ils ont le nez si écrasé qu'il est presque
impossible de les plaindre ». La phrase est d'une stupidité
évidente et l'auteur veut ici faire saillir sont intention ironique.
« Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui
constitue l'essence de l'humanité. » et « il est
impossible que nous supposions que ces gens-là sont des hommes ».
Ces deux idées sont données comme des présupposés, des préjugées
qui amène à des conclusions infondées.
A la fin du texte,
Montesquieu nous dit ceci : « De petit esprits exagèrent trop
l'injustice que l'on fait aux Africains ». L'auteur fait ici le
pari de l'intelligence de son lecteur, car celui-ci doit comprendre
que les petits esprits ne reflète en fait, que les philosophes. Ces
quatre dernières lignes du textes sont très incisives, car
Montesquieu s'y montre particulièrement cinglant à l'égard des
politiques dont il souligne l'incompétence de façon implicite. Les
politiques selon lui font tellement de loi déjà inutiles qu'il
n'est pas possible de penser qu'il n'en est pas faite pour lutter
contre une injustice réel faite aux Africains. Or c'est le cas, donc
cela redouble d'incompétence.
Ce texte est donc à la
fois un réquisitoire contre l'esclavage et un plaidoyer pour
l'égalité entre les hommes.
L'utilisation
d'arguments absurdes est une première façon d'attirer la complicité
du lecteur qui à la fois s'offusque et rit d'arguments
particulièrement stupide. Mais il y a un deuxième éléments dans
le texte : c'est l'utilisation de « on » ( pronom
caméléon ) : « On ne peut se mettre » ou « on ne
peut juger » ont pour effet de rendre le raisonnement objectif
( qui est conforme à la réalité ), et on a un glissement vers le
« nous » à la fin du texte ( L-20 ) qui concrétise
encore d'avantage cette complicité dans la moquerie. De plus, la
référence répétée aux « nations policées » renvoie
à une supériorité théorique. Celle-ci vient en contradiction avec
la stupidité du propos ce qui créer à nouveau une mise à
distance.
Ce texte est donc bien
un plaidoyer pour l'égalité et la défense des esclaves ce qui est
particulièrement perçu à la fin du texte où l'auteur lance un
véritable appel aux autorités politiques pour qu'elles prennent
position et adopte une loi universelle ( L-24 & 25 )
« miséricorde et la pitié » par leurs caractères
universelles dépasse les aprioris racistes et renvoi au respect
naturel et à la dignité qui sont dus à un être humain quelque
soit son origine.
Les vertus qui relèvent
de l'humanité ( la pitié et la miséricorde ) devraient faire
l'objet d'une convention politique ce qui veut dire qu'elles ne sont
pas naturels chez ses gens-là... Et les politiques sont accusés de
faire des conventions inutiles. C'est en particulier dans cette
dernière phrase qu'éclate au grand jour la dimension ironique du
texte directement adressée aux politiques.
Ce passage de l'esprit
des Lois à donné lieu à de multiples débats car certains ont pu
lire aux premier degré et ne pas comprendre l'ironie de ce texte.
Cependant, Montesquieu veut ici, ouvertement user de la provocation
et de l'ironie, qui repose sur la complicité du lecteur qui fait
semblant d'adhérer à des arguments stupides et fallacieux et
retourne par la suite l'argumentaire contre les esclavagistes.
Ce texte est donc bien
un réquisitoire fort, contre l'esclavage et un plaidoyer en faveur
de l'égalité entre les hommes, gage du bonheur humain.
RdM...
Résumer avec l'IA :
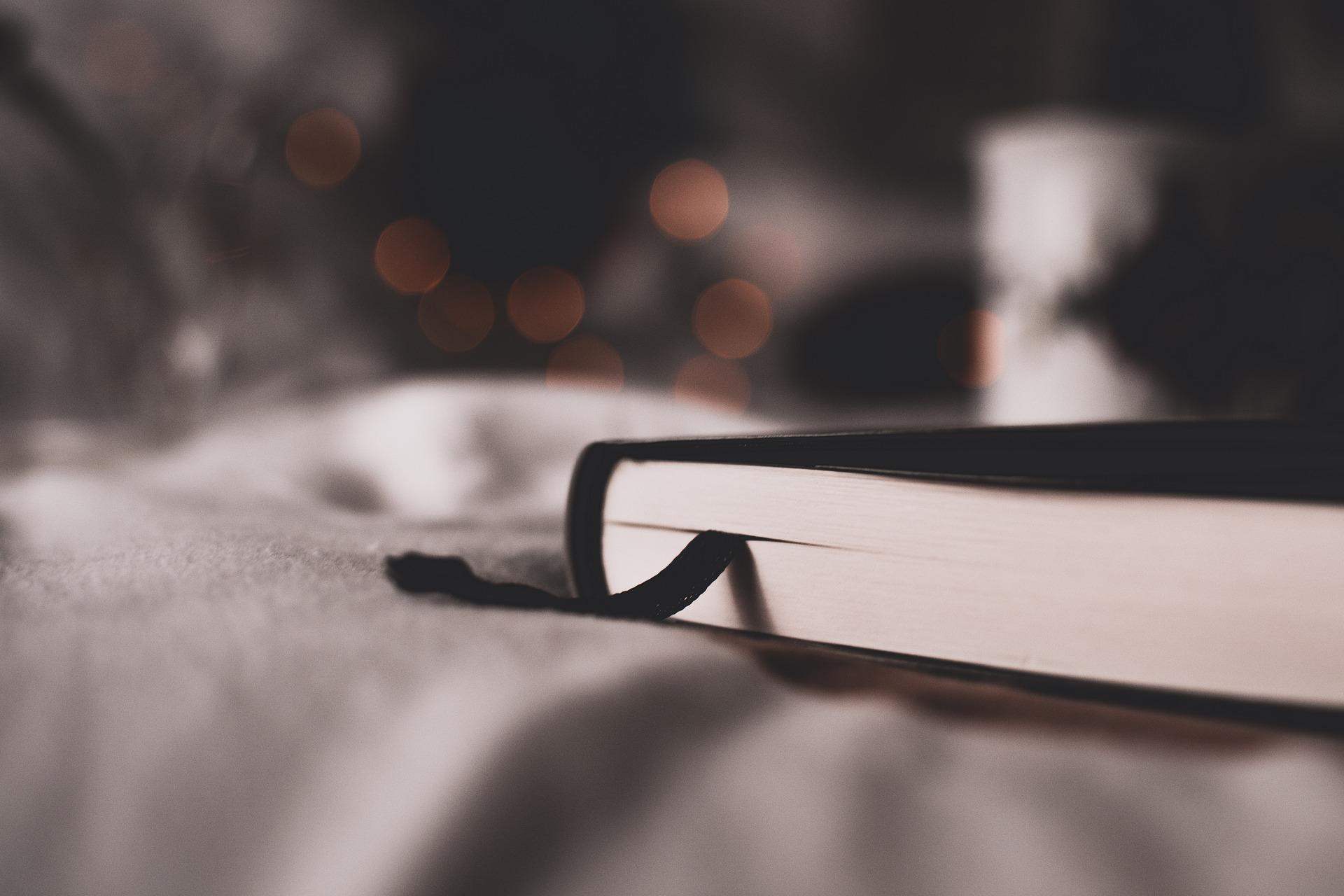






















Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !
Dans cet article, on l’ouvrage « De l’esprit des lois » est mal cité. En effet, on peu lire dans l’article la ‘citation’ suivante « si j’aurais à soutenir » alors que dans l’ouvrage il est bien écrit « Si j’avais à soutenir (…) ». De plus, « si j’aurais » est une faute de français!
Pour moi, cela remet en question la crédibilité de cette analyse.
Bonjour ! Effectivement, c’est une belle coquille, c’est corrigé, merci à vous !
Je trouve formidable ce commentaire. Ce n’est pas le meilleur mais se soutient bien ;)