Chapitres

Rappel de la méthode générale en dissertation
Comprendre le sujet
D'abord, il vous faut décortiquer les termes du sujet.
Reformuler le sujet
A partir de cette première analyse, vous pouvez également reformuler le sujet (souvent très utile).
Diviser le sujet en sous-questions
Ces sous-questions peuvent notamment vous être utiles pour établir vos parties et vos sous-parties.
Chercher des idées
Les idées doivent s'appuyer sur des exemples, lesquels doivent, inversement, vous offrir les idées. Ainsi :
- appuyez-vous sur le corpus du sujet pour vos exemples
- trouvez, à partir de votre cours et de vos connaissances, d'autres exemples
Le choix du plan
A partir de ces travaux préparatoires, vous devez finalement dégager un plan, généralement en trois parties et trois sous-parties, chacune étayée d'exemples tirés du corpus et de vos connaissances personnelles.
Les enjeux du sujet les œuvres du passé
Lorsque vous vous confrontez au sujet d’une dissertation, il vous faut bien identifier les termes qui posent un problème, ou qui témoignent d’une tension. Munissez-vous de stabylos de couleurs différentes, et surlignez les mots qui doivent faire l’objet d’une attention toute particulière.
A la fin de votre analyse du sujet, essayez donc de reformuler la question ! C’est souvent un bon moyen pour établir votre propre problématique, et pour vérifier si vous avez bien saisi le propos.
Ici :
- Le sujet fait référence à la longévité des œuvres littéraires et leur intérêt potentiellement intemporel
- Le sujet propose de lui-même une direction : les œuvres du passé ont un intérêt, mais lequel ?
- D’après cette alternative, le sujet vous invite à un plan thématique, c’est-à-dire qu’il vous faudra donner des réponses qui ne s'opposent pas mais se renforcent plutôt
- Le sujet convoque n'importe quelles « œuvres » : prenez garde à varier les exemples parmi tous les genres littéraire !

Trouver des idées
D’abord, scindez votre sujet en plusieurs sous-questions qui, dans l'idéal, constitueraient l'ébauche d'un plan de rédaction :
- Pourquoi les œuvres du passé peuvent faire rêver ?
- Pourquoi l'histoire passée nous concerne-t-elle encore ?
- Qu'est-ce qui est commun entre nos époques ?
- Pourquoi une œuvre ancienne est-elle capable de me faire rire ?
- Pourquoi une œuvre passée a-t-elle encore quelque chose d'actuel ?
Faites ensuite une liste d’œuvres variées présentant l'aspect sous-entendu par ces trois questions. N’oubliez pas les œuvres dont proviennent les extraits de votre sujet !
Enfin, pour votre rédaction, n’oubliez pas l’ordre suivant :
- Une affirmation
- Un argument
- Un exemple (tiré de la littérature)
La rédaction de la dissertation
Introduction
Si la lecture constitue une part importante des tâches scolaires, elle reste aussi une activité de loisir pour beaucoup de collégiens et de lycéens. Mais bien souvent, les seules œuvres qui emportent leur adhésion sont celles contemporaines, tandis que les textes dit « classiques » sont considérés comme ringards. Pour autant, l'exemple de Netflix adaptant une série sur Arsène Lupin montre que les œuvres anciennes peuvent encore plaire aux jeunes générations. Cela témoigne le potentiel « indémodable » de certains écrits, pour peut que l'on choisissent de s'y attarder.
Annonce de la problématique
Dès lors, quels intérêts les œuvres du passé peuvent-elles recéler pour les générations contemporaines ?
Annonce du plan
Nous verrons d'abord que la différence d'époque peut être, plutôt qu'un frein, un avantage conféré aux œuvres du passé. Il y a aussi des choses intemporelles : l'humour comme la beauté sont susceptibles de traverser les époques. En dernier lieu, nous mettrons au jour l'éternelle humanité dont traite toujours les grandes œuvres, l'éternelle humanité étant ce qui les rend définitivement intemporelles.
Développement
Les œuvres du passé, matière à rêver
La différence entre les époques peut se révéler être à l'avantage des œuvres anciennes. Il y a d'abord le mystère des mythes qui font rêver les plus rationnels d'entre nous. Mais il y a également la grande Histoire, dont la littérature se fait le véhicule, soit qu'elle nous réapprend des choses oubliées, soit qu'elle nous met en garde contre les erreurs du passé.
La mythologie, jamais démodée
La mythologie est littéralement une matière à rêver. Elle est à la racine de n'importe quelle culture et, encore aujourd'hui, elle sert à élaborer des fictions modernes. L'Iliade, long poème épique écrit par le poète grec Homère, raconte ainsi la fameuse guerre de Troie qui vit les Troyens et les Grecs s'affronter pour la plus belle femme du monde, Hélène de Troie. Cette guerre convoque des héros surhumains, tels Achille ou Ulysse, et des dieux qui s'immiscent dans les affaires des Hommes, comme Zeus ou Héra. Le fait que ce récit de l'origine ait donné un péplum avec Brad Pitt (Troie) est peut-être la meilleure preuve qu'il fait encore rêver notre modernité.

Les mystères d'une époque révolue
Certaines œuvres fascinent également parce qu'elles permettent de témoigner d'une époque que le temps qui passe fait oublier. Il n'y avait pas, ainsi, de documents audiovisuels datant du Moyen-Âge, qui nous serviraient pour mieux comprendre cette époque révolue. Mais des romans courtois comme ceux de Chrétien de Troyes, avec Lancelot ou le Chevalier de la Charette ou encore Yvain ou le Chevalier au Lion, nous renseignent sur les us et les coutumes de la vie médiévale. Nous pourrions citer d'autres exemples venus d'autres genres et d'autres époques, comme, par exemple, les Fables de La Fontaine, précieux témoin de la vie à la cour sous le Roi-Soleil.
Les erreurs du passé
Enfin, certaines œuvres se font les témoins de leur époque pour mieux mettre en garde les générations futures. Car des écrivains se donne ce but : témoigner de leur époque pour que leurs œuvres soient lues par les générations futures afin qu'elles soient conscientes des dérives de l'humanité. Louis-Ferdinand Céline déplore les horreurs de la Première Guerre Mondiale dans son roman Voyage au bout de la nuit, tandis qu'Albert Camus alerte sur la manière dont l'horreur nazie se diffuse lentement au sein des populations, dans son roman La Peste. Plus tard, il y a encore Eugène Ionesco, dans sa pièce Rhinocéros, qui s'indigne des dérives du totalitarisme.
Transition
Mais il y a aussi des raisons plus futiles qui expliquent la persistance des œuvres du passé dans nos bibliothèques. Car, simplement, elles sont capables de plaire encore.
Des sentiments intemporels
Ainsi, certains sentiments sont capables de traverser les époques et de toucher encore le public contemporain. Qu'il s'agisse de tristesse, d'humour ou de beauté, les cœurs sont remués de la même manière d'une société à une autre.
La tristesse
La tristesse fait partie de ces sentiments qui traversent les époques. Qui ne s'émeut pas pour un enfant mort ou une guerre dévastatrice ? Ces deux sujets sont ainsi convoqués par Victor Hugo dans son poème « L'enfant », qui est écrit en réaction à la destruction de l'île de Chios par l'armée turque, qui voulait étouffer les velléités d'indépendances des Grecs. Dans un paysage dévasté, le poète s'adresse à un enfant qu'il trouve au milieu des débris, et propose de lui offrir n'importe quoi, mais la réponse de la victime est sans appel :
Veux-tu, pour me sourire, un bel oiseau des bois,
Qui chante avec un chant plus doux que le hautbois,
Plus éclatant que les cymbales ?
Que veux-tu ? fleur, beau fruit, ou l’oiseau merveilleux ?
– Ami, dit l’enfant grec, dit l’enfant aux yeux bleus,
Je veux de la poudre et des balles.
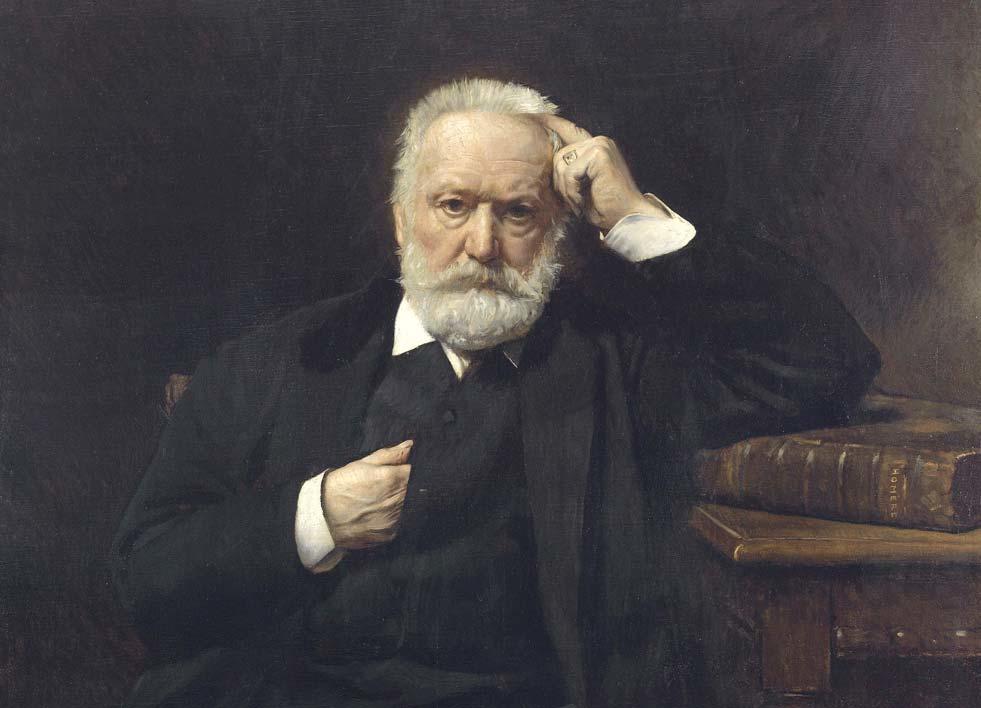
L'humour
L'humour est également l'une des grandes sensations intemporelles. Qu'une plaisanterie soit dite en 1732 ou en 2021, elle est susceptible d'avoir le même effet sur son lectorat. C'est peut-être la raison pour laquelle Molière a encore autant de succès dans les salles de théâtre d'aujourd'hui. Il fut un grand maître de l'humour et, au-delà de la critique des mœurs de son temps, c'est souvent pour sa maîtrise des quiproquos ou de l'ironie qu'il est souvent salué. Sa pièce comique L'avare a même été reprise au cinéma dans un film avec Louis de Funès, autre grand maître de l'humour, mais au XXème siècle, et qui fait encore rire au XXIème siècle !
La beauté
S'il est vrai que la beauté a ses canons temporels (c'est-à-dire qu'elle a changé à travers les époques), la littérature recèle cependant des perles que chaque génération s'accorde à trouver belles. Comme les tableaux que l'on expose dans les musées, certaines œuvres rassemblent les lecteurs parce qu'elles offrent de belles images à travers les mots. Comment, ainsi, ne pas succomber devant le rythme et la perfection des vers du poème « Que la vie en vaut la peine », de Louis Aragon ? Citons-en ici les derniers quatrains, pour le simple plaisir de la beauté :
Malgré l’âge et lorsque soudain le cœur vous flanche
L’entourage prêt à tout croire à donner tort
Indiffèrent à cette chose qui vous mord
Simple histoire de prendre sur vous sa revancheLa cruauté générale et les saloperies
Qu’on vous jette on ne sait trop qui faisant école
Malgré ce qu’on a pensé souffert les idées folles
Sans pouvoir soulager d’une injure ou d’un criCet enfer
Malgré tout cauchemars et blessures
Les séparations les deuils les camouflets
Et tout ce qu’on voulait pourtant ce qu’on voulait
De toute sa croyance imbécile à l’azurMalgré tout je vous dis que cette vie fut telle
Qu’à qui voudra m’entendre à qui je parle ici
N’ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci
Je dirai malgré tout que cette vie fut belle
Transition
Ces sentiments intemporels sont surtout le signe, précisément, de l'intemporalité. Car ce qui persiste avant tout entre les époques, c'est l'humanité elle-même. Et c'est ce dont parle toujours la littérature.
L'humanité pérenne des œuvres du passé.
L'humanitas
On parlait encore il n'y a pas si longtemps de faire ses humanités, pour suivre des études classiques de littérature. C'est dire que dans « l'humanitas » il y a bien plus que le présent volage de notre durée de vie et de nos intérêts présents. L'Œdipe du dramaturge grec Sophocle, éminent représentant de cette « humanité » classique, n'a cessé de parler à toutes les générations qui l'ont abordé, jusqu'à Freud qui en a fait un constituant essentiel de notre personnalité psychique, avec son fameux « complexe d'Œdipe ».

Les classiques et l'immortalité
Il est indéniable et même nécessaire que bien des œuvres disparaissent ; mais certaines demeurent. Ce n'est jamais leur âge qui est significatif de l'intérêt que nous leur portons, car une œuvre véritable atteint une forme d'intemporalité.
Horace, dans son ode XXX, écrivait : « exegi monumentum aere perennius », soit « J'ai bâti un monument pour le souvenir, plus durable que l'airain ». Il voulait bien sûr parler de son œuvre, qui deviendra plus durable que l'acier lui-même. Il y a dans toute œuvre la marque de ce désir de traverser le temps, le désir de susciter l'intérêt des générations futures. Stendhal, par exemple, était certain de ne pouvoir être compris que cent ans après sa mort - c'est dire la prétention des génies !
Les questions éternelles
Ces œuvres et ces génies sont susceptibles de devenir immortelles parce qu'ils soulèvent des questions qui resteront à jamais sans réponse. Il n'y a ainsi pas, et il n'y aura jamais, de réponse à cette fameuse question que le dramaturge anglais Shakespeare faisait poser à son personne resté seul sur scène, en proie avec lui-même : « To be or not to be ? », soit « Être ou ne pas être ? ». Les œuvres classiques, elles, en tout cas, sont, parce qu'elles posent les bonnes questions, pour l'éternité laissée sans réponse.
Conclusion
Les œuvres d'art crée leur propre temporalité, c'est à dire quelles constituent les modalités suivant lesquelles elle échappent au temps. C'est par cette éternelle recréation d'elles-mêmes qu'elles atteignent l'éternité.
Si certaines restent fatalement prisonnières de leur époque et ont cessé de nous intéresser parce qu'elles ne nous concernent plus, beaucoup sont devenues des pièces essentielles de notre personnalité, car c'est la culture dans laquelle nous avons grandi nous-mêmes qui s'est construite sur leur mémoire.
Nous avons ce besoin constant de nous comprendre comme homme, comme femme, et ce besoin passe par la compréhension de ceux qui nous ont précédés. Une œuvre détruite c'est un monde qui disparaît et une part de nous-même qui nous échappe. C'est cela qui rend nécessaire l'héritage qui doit être transmis.






















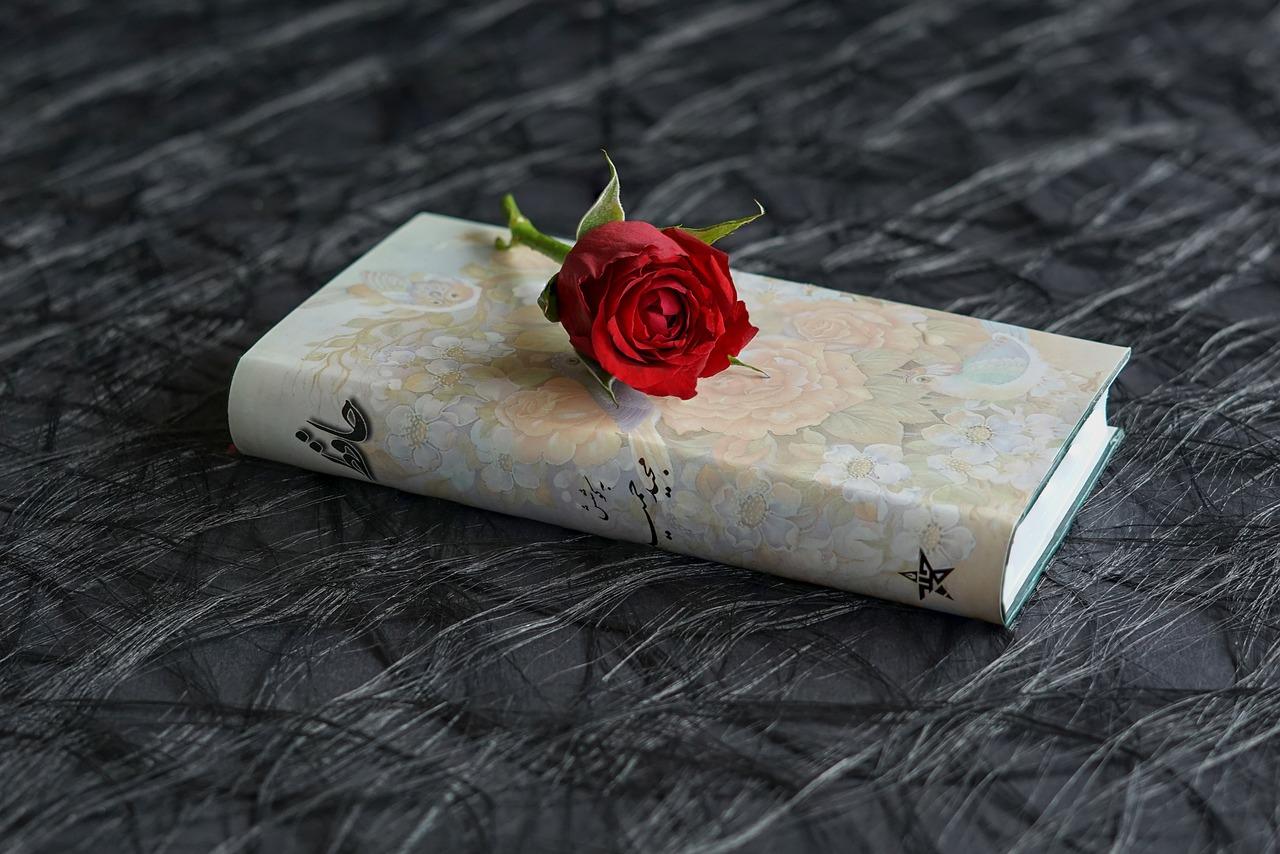
Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !
Merci d’avoir indiqué vos sources! Bravo de rendre hommage à l’auteur.