Chapitres
Le théâtre offre une variété de types de comique, tels que le comique de situation, le comique de caractère, le comique de répétition, le comique de mots, le comique de gestes, le comique de moeurs, le comique de l'absurde, le comique de stand-up ou encore le comique de mime.
L'écoulement du temps a permis d'utiliser ces différents procédés, assez bien identifiables, que l'on retrouve dans beaucoup de comédies, passées et présentes. Découvrons ensemble, exemples à l'appui, ces différents types de comique qui font rire les spectateurs.
| Type de Comique | Explication | Exemple |
|---|---|---|
| Comique de Situation | L'humour naît des situations absurdes ou comiques dans lesquelles les personnages se trouvent. | Les quiproquos dans "Le Malade Imaginaire" |
| Comique de Caractère | L'humour est basé sur les traits de personnalité excentriques ou stéréotypés des personnages. | Le personnage de Monsieur Jourdain dans "Le Bourgeois Gentilhomme" |
| Comique de Répétition | Les rires sont provoqués par la répétition d'une action ou d'un gag comique. | La scène des portes qui claquent dans "Le Dîner de Cons" |
| Comique de Mots | L'humour est créé à travers des jeux de mots, des calembours et des dialogues comiques. | Les jeux de mots de Molière dans "Tartuffe" |
| Comique de Gestes | L'humour est basé sur des gestes physiques exagérés, des mimiques faciales et des gags physiques. | Les mimiques et mouvements de Charlie Chaplin dans ses films muets |
| Comique de Burlesque | Les comédies burlesques utilisent l'exagération et le déguisement pour créer des scènes humoristiques. | Les numéros exagérés de slapstick dans les films de Laurel et Hardy |
| Comique de l'Absurde | L'humour se fonde sur des idées ou des dialogues totalement déconnectés de la réalité. | Les dialogues surréalistes de "La Cantatrice Chauve" d'Eugène Ionesco |
| Comique de Stand-up | Les comédiens de stand-up racontent des histoires drôles, font des blagues et interagissent avec le public en direct. | Le spectacle humoristique de Gad Elmaleh |
| Comique de Mime | L'humour est créé principalement par des gestes, des expressions faciales et des mouvements corporels, sans utiliser de mots. | Les sketches muets de Marcel Marceau |
Mais avant cela, un peu de philosophie afin de comprendre d'où vient réellement le rire, ce qui le provoque au fondement de nous-même, et comment le décortiquer.

Analyse bergsonienne du rire
Dès les premières lignes de son essai consacré au rire[1], Henri Bergson précise qu’il ne s’attellera pas à circonscrire le rire en une définition.

Son argument ? Le rire est quelque chose de vivant qui ne supporterait donc d’être engoncé dans un carcan définitionnel.
Le rire est donc du côté de la vie. Son essai comprend trois grands chapitres : Du comique en général, Le comique de situation et de mots et Le comique de caractère.
Au cours de ces articles[2], l’auteur énonce des lois[3], déduites de ses hypothèses, dont celle-ci, qui caractérise la pensée de l’auteur : le comique résulte d’une mécanisation artificielle du corps humain[4].
Cette assertion implique
idées.
- Le comique est essentiellement humain : Il n’y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain. (p. 2) ; ce qui suppose que l’homme est à la fois la source d’émission du comique et l’objet principal du risible
Plusieurs [philosophes] ont défini l’homme « un animal qui sait rire ». Ils auraient aussi bien pu le définir un animal qui fait rire, car si quelque autre animal y parvient, ou quelque objet inanimé, c’est par une ressemblance avec l’homme, par la marque que l’homme y imprime ou par l’usage que l’homme en fait.(p.3)
- Le comique naît d’un décalage entre des attentes et une réalisation : un homme marche tranquillement et brutalement chute.
Pour qu’il y ait du comique, il faut par ailleurs d’autres conditions ; il requiert en effet une insensibilité. Le rire n’a pas de plus grand ennemi que l’émotion (p.3) et un contact avec d’autres rieurs, car le rire est avant tout social, voire sociétal. Notre rire est toujours le rire d’un groupe (p. 5). Plus encore, le rire a une fonction sociale[5].
Un cas particulier: l’autodérision
L’autodérision est la faculté de se moquer de soi-même, de se prendre comme objet du rire. Cette faculté est dépeinte par Baudelaire comme une forme de sagesse [6]… c'est dire s’il est difficile de rire ou de se moquer de soi. L’autodérision est par ailleurs un concept assez riche : on se moque de soi mais on en fait également rire les autres.
L’autodérision implique une prise de distance de soi par rapport à soi-même mais aussi une bonne connaissance de ses failles.
L'humour noir
Enfin, notons que l’autodérision comme mise à distance de ses propres défauts ou craintes peut véhiculer un humour noir. C’est le cas de l’humour de Pierre Desproges qui n’hésitera pas à exorciser la peur de la mort et la douleur qu’elle provoque chez ceux qui restent en imitant sur scène son propre père, décédé d’un cancer de la gorge. La réaction des spectateurs montre qu’il va loin, trop peut-être au goût de certains, allant jusqu’à choquer.
Dans un second temps, les spectateurs entrent dans le jeu et finissent par rire avec lui de ce qui par définition est tout sauf drôle : la maladie et la mort. La mise à distance de cette crainte opère donc à l’échelle de la salle. Plus tard, il se moquera même de la maladie qui est en train de le ronger. Un cas ultime d’autodérision, qui prouve, nous en reparlerons qu’il faut savoir rire de tout.
Le comique de situation
Le comique de situation repose, comme son nom l'indique, sur la situation : c'est d'elle que vient le rire. Elle met en scène les personnages de la pièce dans des situations improbables ou tout simplement drôles en elles-mêmes.
La comédie est un genre traditionnel du théâtre, ayant des origines anciennes. Pendant l'Antiquité grecque, les dramaturges participaient à des concours dramatiques, présentant trois tragédies sérieuses et un drame satyrique, qui était une forme de "tragédie amusante" caractérisée par des éléments comiques et burlesques. Cette tradition a jeté les bases du genre comique, qui continue d'apporter de l'humour au théâtre à travers les siècles.
Dans Le Jeu de l'amour et du hasard, de Marivaux (1730), Silvia est une jeune fille noble qui se fait passer pour sa servante, Lisette, afin de mieux observer le fiancé qu'on lui a promis, du nom de Dorante. Seul problème dans ce plan parfait : celui-ci a eu exactement la même idée, et il se présente chez Silvia sous les traits de son valet, Bourguignon. Le spectateur peut donc assister à une drôle de conversation, dont il est le seul à connaître les dessous :
Dorante
À l’égard du tutoiement, j’attends les ordres de Lisette.
Silvia
Voilà la glace rompue ! Fais comme tu voudras, Bourguignon, puisque cela divertit ces messieurs.
Dorante
Je t’en remercie, Lisette, et je réponds sur-le-champ à l’honneur que tu me fais.
Monsieur Orgon
Courage, mes enfants ; si vous commencez à vous aimer, vous voilà débarrassés des cérémonies.
Mario
Oh ! doucement ; s’aimer, c’est une autre affaire ; vous ne savez peut-être pas que j’en veux au cœur de Lisette, moi qui vous parle. Il est vrai qu’il m’est cruel ; mais je ne veux pas que Bourguignon aille sur mes brisées.
Silvia
Oui ! le prenez-vous sur ce ton-là ? Et moi, je veux que Bourguignon m’aime.
Dorante
Tu te fais tort de dire je veux, belle Lisette ; tu n’as pas besoin d’ordonner pour être servie.
Les retournements de situation burlesques
Dans le comique de situation, on trouve également des retournements de situation. Ainsi de la scène 2 de L'Avare, pièce écrite par Molière (1688) : Harpagon, pingre parmi les pingres, découvre que son fils, Cléante, est un très grand dépensier, tandis que celui-ci apprend que son père est un usurier (un homme qui prête de l'argent avec des taux d'intérêts exorbitants).
Cette découverte mutuelle est donc l'occasion d'une conversation succulente pour le spectateur :
Harpagon
Comment ?
Maître Simon, montrant Cléante.
Monsieur est la personne qui veut vous emprunter les quinze mille livres dont je vous ai parlé.
Harpagon
Comment, pendard ! c’est toi qui t’abandonnes à ces coupables extrémités !
Cléante
Comment, mon père ! c’est vous qui vous portez à ces honteuses actions !
Le quiproquo au théâtre
Mais le comique de situation le plus connu, c'est assurément le quiproquo. Celui-ci résulte d'une situation où deux personnes pensent parler d'une même chose, alors que ce n'est pas le cas. Peuvent s'ensuivre des discussions amusantes pour le spectateur qui, lui, est conscient de la méprise.
➡️ Il y a l'exemple de la pièce de Georges Feydeau, La Puce à l'oreille (1907). Cette pièce est entièrement fondée sur le principe du quiproquo : deux personnages, Chandebise, un garçon d'hôtel, mari de Raymonde, et Poche, garçon d'hôtel, se ressemblent à l'extrême et sont confondus par tous les personnages, qui se soupçonnent par ailleurs tous d'adultères mutuels.

RAYMONDE, id.
Grâce ! Grâce ! Ne condamne pas sans m’entendre.
POCHE, ahuri.
Hein ?
TOURNEL, avec volubilité.
Les apparences nous accablent, mais je te jure que nous ne sommes pas coupables.
RAYMONDE, id.
Oui ! Il dit la vérité ! Nous ne pensions ni l’un ni l’autre à nous rencontrer.
TOURNEL, id.
Tout ça, c’est la faute de la lettre !
RAYMONDE, id.
La lettre, oui !… C’est moi, moi qui suis cause de tout ! Je l’avais fait écrire parce que…
TOURNEL.
Voilà ! voilà ! c’est l’exacte vérité !
RAYMONDE, s’agenouillant sur la marche.
Oh ! je t’en demande pardon !… Je croyais que tu me trompais.
POCHE
Moi !…
RAYMONDE
Ah ! dis-moi, dis-moi que tu me crois ; que tu ne doutes pas de ma parole.
POCHE
Mais oui ! Mais oui ! (Se tordant.) Mais qu’est-ce qu’ils ont ?
RAYMONDE, reculant effrayée par ce rire idiot qui lui paraît sardonique ; et avec énergie.
Ah ! je t’en prie, Victor-Emmanuel… ne ris pas comme ça ! Ton rire me fait mal.
POCHE, à qui l’injonction de Raymonde a coupé le rire comme avec un couteau.
Mon rire ?
RAYMONDE, revenant à lui.
Ah ! Oui ! Je vois !… Je vois !… tu ne me crois pas…
Le comique de geste

Le comique de geste appartient, plutôt qu'au domaine de la parole, à l'empire physique.
Ce sont des coups de bâtons, des positions ridicules, des expressions du visage, le ton de la voix, ou les costumes extravagants qui provoqueront les rires du public.
➡️ Un exemple fameux, c'est la leçon du Maître de philosophie à Monsieur Jourdain, alias le bourgeois gentilhomme, dans la pièce de Molière du même nom (1670) :
Maître de philosophie
Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l’ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres, et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus j’ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu’elles expriment les voix ; et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu’elles sonnent avec les voyelles, et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a cinq voyelles ou voix : A, E, I, O, U.
Monsieur Jourdain
J’entends tout cela.
Maître de philosophie
La voix A se forme en ouvrant fort la bouche : A.
Monsieur Jourdain
A, A. Oui.
Maître de philosophie
La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d’en bas de celle d’en haut : A, E.
Monsieur Jourdain
A, E, A, E. Ma foi ! oui. Ah ! que cela est beau !
On trouve encore chez Molière l'exemple d'un autre genre de comique de geste, cette fois dans la pièce Les Fourberies de Scapin.
Celui-ci tire son potentiel comique de la violence comme leçon du valet Scapin sur son maître Géronte. À l'acte III, scène 2, le valet trompe Géronte en lui faisant croire à l'arrivée de spadassins venus le molester et l'invite à se cacher dans un sac. Mais, à la fin, personne d'autre que lui ne frappe :
Scapin
Cachez-vous ; voici un spadassin qui vous cherche. (En contrefaisant sa voix.) « Quoi ! jé n’aurai pas l’abantage dé tuer cé Géronte, et quelqu’un, par charité, né m’enseignera pas où il est ! » (À Géronte avec sa voix ordinaire.) Ne branlez pas. « Cadédis, jé lé trouberai, sé cachât-il au centre dé la terre. » (À Géronte avec son ton naturel.) Ne vous montrez pas. (Tout le langage gascon est supposé de celui qu’il contrefait, et le reste de lui.) « Oh ! l’homme au sac. » Monsieur. « Jé té vaille un louis, et m’enseigne où put être Géronte. » Vous cherchez le seigneur Géronte ? « Oui, mordi, jé lé cherche. » Et pour quelle affaire, monsieur ? « Pour quelle affaire ? » Oui. « Jé beux, cadédis, lé faire mourir sous les coups de vaton. » Oh ! monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui, et ce n’est pas un homme à être traité de la sorte. « Qui ? cé fat dé Géronte, cé maraud, cé velître ? » Le seigneur Géronte, monsieur, n’est ni fat, ni maraud, ni belître ; et vous devriez, s’il vous plaît, parler d’autre façon. « Comment, tu mé traites, à moi, avec cette hautur ? » Je défends, comme je dois, un homme d’honneur qu’on offense. « Est-ce que tu es des amis dé cé Geronte ? » Oui, monsieur, j’en suis. « Ah ! cadédis, tu es de ses amis, à la vonne hure. » (Donnant plusieurs coups de bâton sur le sac.) « Tiens boilà cé que jé té vaille pour lui. » Ah, ah, ah, ah, monsieur. Ah, ah, monsieur, tout beau. Ah, doucement. Ah, ah, ah. « Va, porte-lui cela de ma part. Adiusias. » Ah ! diable soit le Gascon ! Ah !
Les mimiques et grimaces, puissants facteurs de rire
La principale source de comique issu du décalage réside dans la grimace.
Prenez un minois adorable (Monica Belluci ou Jude Law) et faites lui tirer la langue, déformer la bouche, écarter les narines, exorbiter les yeux…et voyez si l’icône sensuelle se donne toujours comme un modèle !
La grimace est ridicule parce qu’elle déforme, elle différencie, marque un décalage entre le modèle original, celui auquel on est habitué, et l’horreur que l’on voit. Cette horreur naît du caractère animalier (ou en tout cas moins humain) des traits du visage.
Imaginez maintenant que la grimace en question soit permanente…la grimace n’est drôle qu’à partir du moment où ce décalage est provisoire, où on le sait provisoire. Exemple : Notre –Dame de Paris de Victor Hugo. La figure de Quasimodo.

L’aspect du personnage principal fait rire au premier abord les foules rassemblées pour le jour de la fête des fous. Chacun doit, dans l’encadrement d’une ouverture de Notre-Dame, faire la plus terrible des grimaces.
C’est Quasimodo qui remporte l’élection haut la main et qui est élu Pape des fous. La foule rit de ses grimaces jusqu’à ce qu’elle s’aperçoive que ladite grimace n’en est en fait pas une mais que le visage est naturellement difforme. Le monstre laisse place au comique grimacier et l’effroi de la foule succède à ses rires.
Ainsi, on pourra trouver, encore chez Molière, une dernière incarnation du comique de geste, dans les mimiques s'imprimant successivement sur les visages de Frosine et d'Harpagon, les personnages de L'Avare (acte II, scène 6) :
Frosine
J’aurois, monsieur, une petite prière à vous faire. J’ai un procès que je suis sûr le point de perdre, faute d’un peu d’argent (Harpagon prend un air sérieux.) et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès, si vous aviez quelque bonté pour moi. Vous ne sauriez croire le plaisir qu’elle aura de vous voir. (Harpagon reprend un air gai.) Ah ! que vous lui plairez, et que votre fraise à l’antique fera sur son esprit un effet admirable ! Mais surtout elle sera charmée de votre haut-de-chausses attaché au pourpoint avec des aiguillettes. C’est pour la rendre folle de vous ; et un amant aiguilleté sera pour elle un ragoût merveilleux.
Harpagon
Certes, tu me ravis de me dire cela.
Frosine
En vérité, Monsieur, ce procès m’est d’une conséquence tout à fait grande. (Harpagon reprend son air sérieux.) Je suis ruinée si je le perds ; et quelque petite assistance me rétabliroit mes affaires… Je voudrais que vous eussiez vu le ravissement où elle étoit à m’entendre parler de vous. (Harpagon reprend son air gai.) La joie éclatoit dans ses yeux au récit de vos qualités, et je l’ai mise enfin dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu.
Le comique de mots ✍️

Évidemment, dans les leviers pour provoquer le rire du spectateur, il y a les mots... et il s'agit là, forcément, du comique de mots. Les dramaturges utilisent donc les répliques qu'ils mettent dans la bouche de leurs personnages pour ajouter des touches comiques aux caractères, aux situations, ou aux gestes.
➡️ Il y a, évidemment, Molière, dont on pourrait citer des exemples pléthoriques. Contentons-nous d'un extrait de la pièce Les Femmes savantes, acte II, scène 6 :
Bélise (à la bonne)
Veux-tu offenser toute ta vie la grammaire ?
Martine
Qui parle d'offenser grand-mère ni grand-père ?
Il y a aussi Eugène Ionesco qui, dans La Cantatrice chauve (1950), s'amuse avec la langue et les sons :
MONSIEUR MARTIN
Allons gifler Ulysse.
MONSIEUR SMITH
Je m'en vais habiter ma Cagna dans mes cacaoyers.
MADAME MARTIN
Les cacaoyers des cacaoyères donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao ! Les cacaoyers des cacaoyères donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao ! Les cacaoyers des cacaoyères donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao.
MADAME SMITH
Les souris ont des sourcils, les sourcils n'ont pas de souris.
Le comique de caractère

Parmi les genres de comique, il y en a un plus diffus : c'est le comique de caractère. L'auteur, pour faire rire, accentue volontairement à l'excès les défauts d'un ou de plusieurs de ses personnages. Il s'agit en quelque sorte de faire la caricature des personnages.
➡️ On pourra ainsi citer :
L'avarice d'Harpagon dans L'Avare de Molière
La focalisation sur les bourgeois de M. Jourdain, dans Le Bourgeois Gentilhomme, de Molière
La cupidité mercantile de l'éditeur Moscat dans Vient de paraître d'Édouard Bourdet (1927)
L'autorité orgueilleuse de Pozzo dans En attendant Godot, de Samuel Beckett (1948)
L’art de la caricature repose sur une déformation, un grossissement d’un trait physique ou moral toujours déjà là. Son but est souvent de critiquer, de se moquer ou encore de dénoncer un état de fait difficilement supportable.
En 2025,
des Français considèrent la liberté d'expression et de caricature comme un droit fondamental.

Les défauts des autres hommes sont autant de failles, de brèches dans lesquelles se glisse le comique. Notons pour finir que l’on se moque plus volontiers du méchant, de l’odieux personnage.
Par ce rire, nous mettons à distance le danger qu’il représente éventuellement pour nous ; mais nous manifestons aussi par ce biais le désir d’être supérieur à lui, le temps d’une moquerie.
Il se joue donc des rapports de force dans le rire[7] : celui qui rit se sent supérieur à celui dont on rit à moins que le comique ne soit volontaire ou que la victime du rire ne rie avec nous.
Le comique de moeurs ☁️
Un autre comique diffus, c'est celui que l'on nomme comique de mœurs. Il s'agit pour le dramaturge de peindre les vices et les mœurs de son temps. ? Évidemment, Molière est un champion en la matière. Dans Le Malade imaginaire (1673), par exemple, l'auteur dresse un portrait satirique des médecins de son temps, coupables de dérives et d'élucubrations pseudo-scientifiques.
On en trouve un autre exemple dans la pièce Art, de Yasmina Reza (1994). L'auteure moque les milieux intellectuels et bourgeois pour leur snobisme en mettant en scène un personnage ayant acheté très cher une toile entièrement blanche, et qui est moqué par ses amis :
MARC
Bien sûr. J'ai ri. De bon cœur. Que voulais-tu que je fasse ? Il n'a pas desserré les dents. Vingt briques, c'est un peu cher pour rire, remarque.
Le comique de répétition
Le dernier grand type de comique consacré et identifiable, c'est le comique de répétition. Il s'agit de ce que l'on nomme running gag en anglais.
Il consiste en la répétition, tout au long de la pièce, d'une même chose, qu'il s'agisse d'une réplique, d'une gestuelle, ou d'une situation. À force, la survenue de cette chose, inlassablement répétée, sera à même de provoquer le rire du spectateur.

➡️ Convoquons à nouveau le maître Molière, avec sa pièce Les Fourberies de Scapin (1671). À l'acte II, scène XI, Géronte n'a qu'une réplique à la bouche :
Géronte
Que diable allait-il faire dans cette galère ?
Scapin
Il ne songeait pas à ce qui est arrivé.
Géronte
Va-t’en, Scapin, va-t’en vite dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui.
Scapin
La justice en pleine mer ! Vous moquez-vous des gens ?
Géronte
Que diable allait-il faire dans cette galère ?
Scapin
Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes.
Géronte
Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l’action d’un serviteur fidèle.
Scapin
Quoi, Monsieur ?
Géronte
Que tu ailles dire à ce Turc qu’il me renvoie mon fils, et que tu te mettes à sa place jusqu’à ce que j’aie amassé la somme qu’il demande.
Scapin
Hé ! Monsieur, songez-vous à ce que vous dites ? Et vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d’aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils ?
Géronte
Que diable allait-il faire dans cette galère ?
Scapin
Il ne devinait pas ce malheur. Songez, monsieur, qu’il ne m’a donné que deux heures.
Cette réplique, "Que diable allait-il faire dans cette galère ?", est répétée
en tout dans la scène XI !
Par ailleurs, ce comique-là s'est particulièrement bien fondu dans la culture populaire. On peut en trouver de nombreuses applications :
Au cinéma : par exemple, dans OSS 117, Rio ne répond plus, avec un Chinois toujours différent qui trouve Hubert Bonisseur de la Bath pour lui dire : « Tu as tué mon frère à Gstaad, tu vas mourir ! ».
En bande dessinée : par exemple, dans Astérix et Obélix, les pirates qui coulent à chaque rencontre avec les Gaulois.
Les différents comiques au théâtre : exercices !
Lisez les descriptions suivantes et déterminez quel type de comique est illustré dans chaque exemple. Choisissez parmi les options suivantes : comique de situation, comique de geste, comique de mots, comique de caractère ou comique de répétition.
Un personnage trébuche sur une peau de banane et tombe de manière comique.
Comique de geste : Le rire est provoqué par les actions physiques du personnage, à savoir le trébuchement et la chute.
Un personnage répète une phrase incohérente à plusieurs reprises, provoquant des rires.
Comique de répétition : Le rire résulte de la répétition de la phrase incohérente.
Un personnage excentrique avec une obsession pour les détails provoque des situations humoristiques.
Comique de caractère : Le personnage excentrique avec son obsession pour les détails crée des situations humoristiques en raison de sa personnalité particulière.
Deux personnages utilisent des jeux de mots et des calembours pour faire rire le public.
Comique de mots : Les jeux de mots et les calembours sont des éléments du comique de mots.
Un personnage se retrouve dans une série de situations maladroites et embarrassantes.
Comique de situation : Le personnage se retrouve dans des situations maladroites et embarrassantes, créant un humour basé sur les circonstances.
À présent, vous voici avec toutes les cartes en main pour mieux comprendre les différents types de comique au théâtre : à vous de jouer !
Sources
- Bergson, Le Rire : Essai sur la signification du comique. Quadrige PUF, 1940.
- Publiés dans la Revue de Paris les 1er et 15 février, 1er mars 1899.
- Qu’il nomme aussi règles ou théorèmes, conférant à son analyse un caractère fortement scientifique.
- Il dira encore : « du mécanique plaqué sur du vivant » p. 29.
- Bergson, Ibid, p.2-7 : lire cette première partie du chapitre I qui pose les fondements de la théorie bergsonienne.
- Cf. Baudelaire, Salon de 1856, « De l’essence du rire ».
- Cf. Baudelaire et sa conception du rire satanique, rire de supériorité.
Résumer avec l'IA :














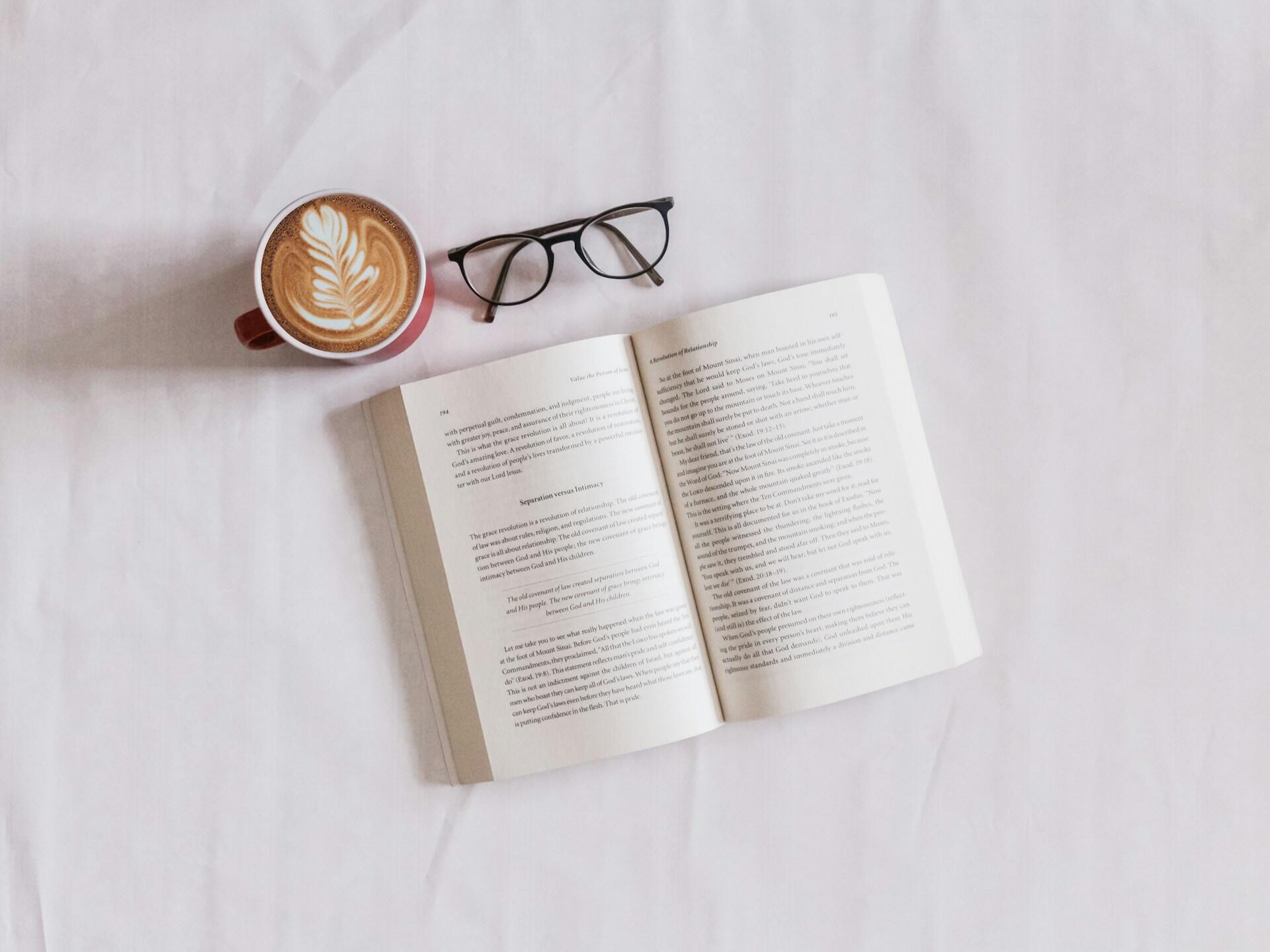


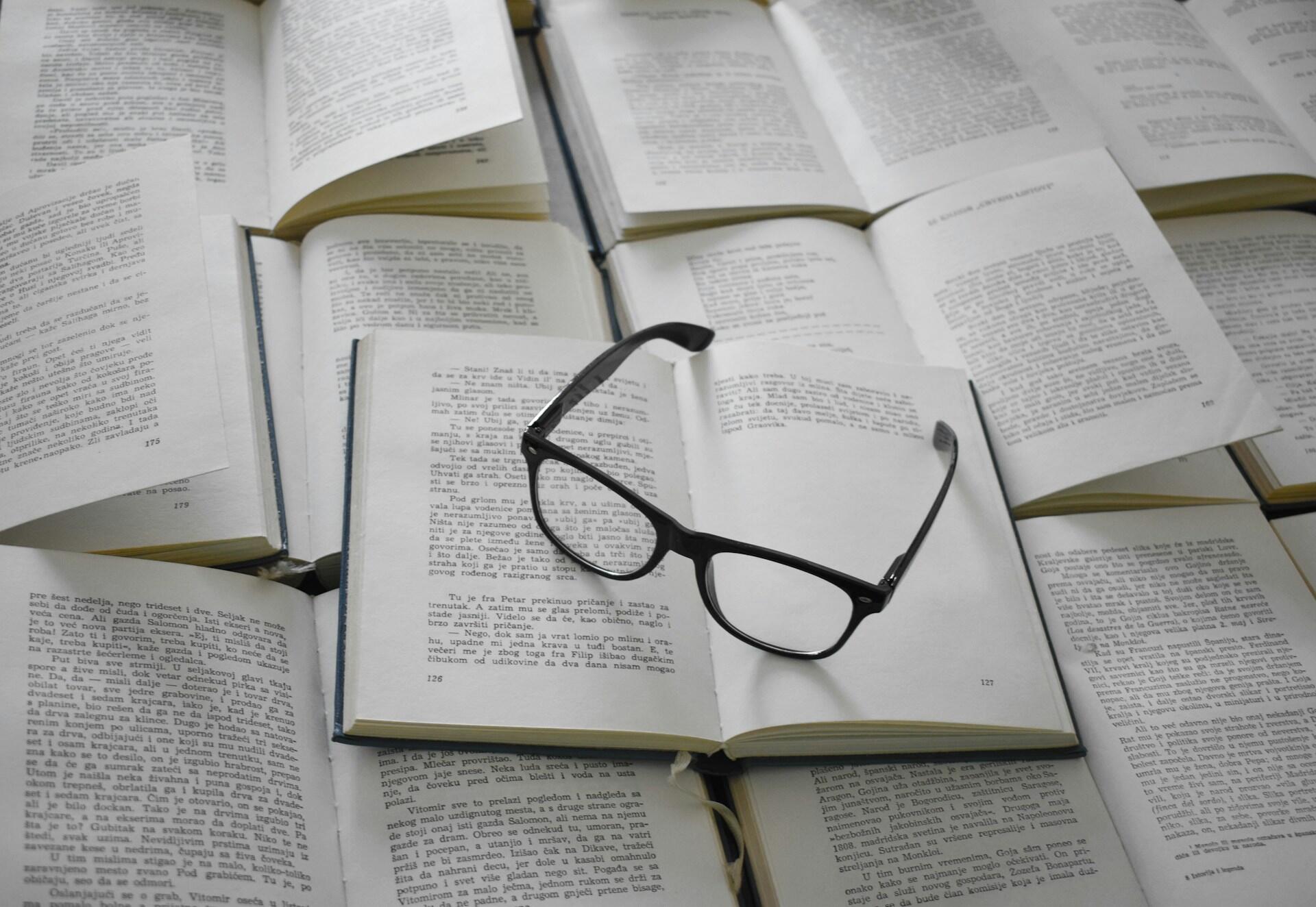
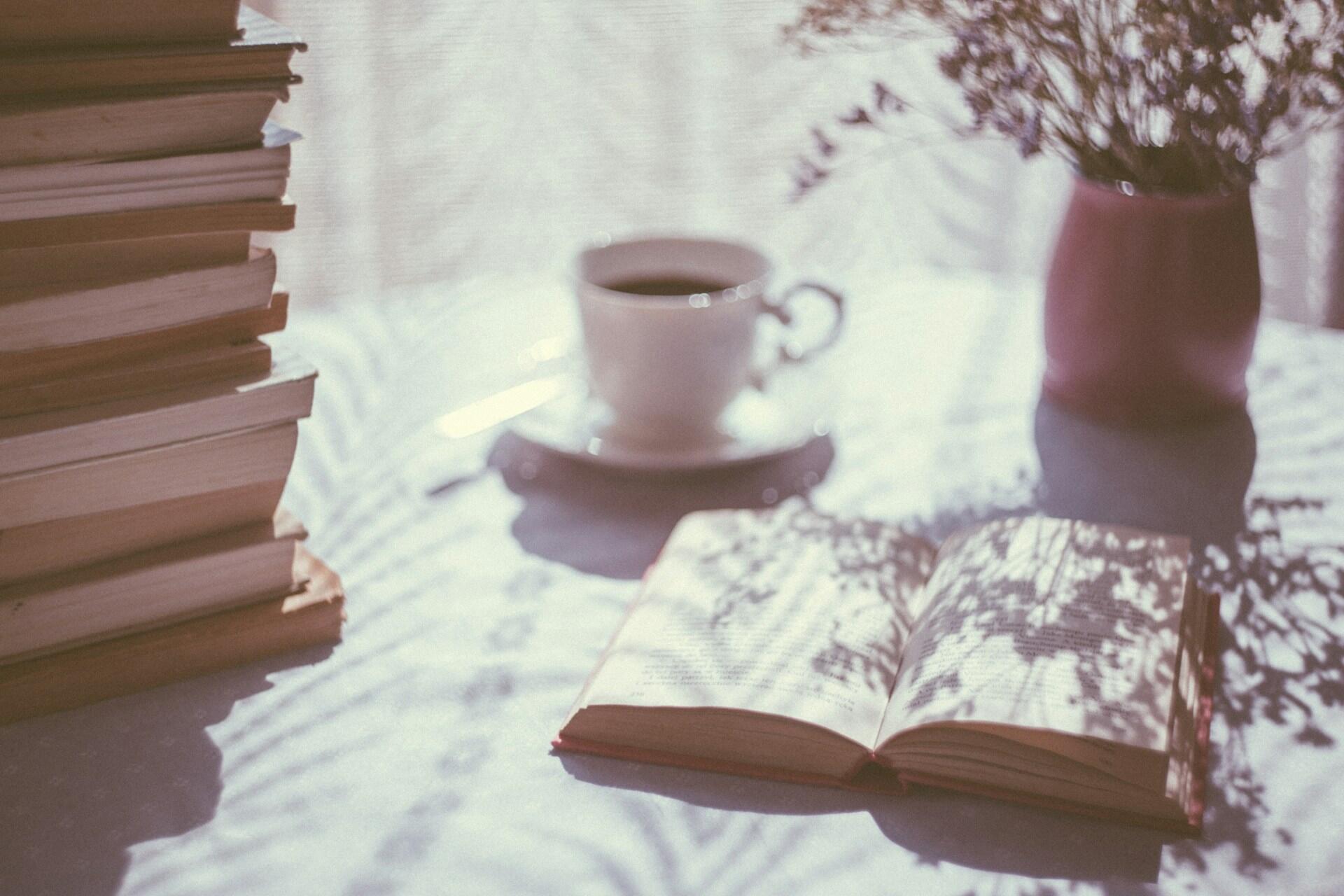


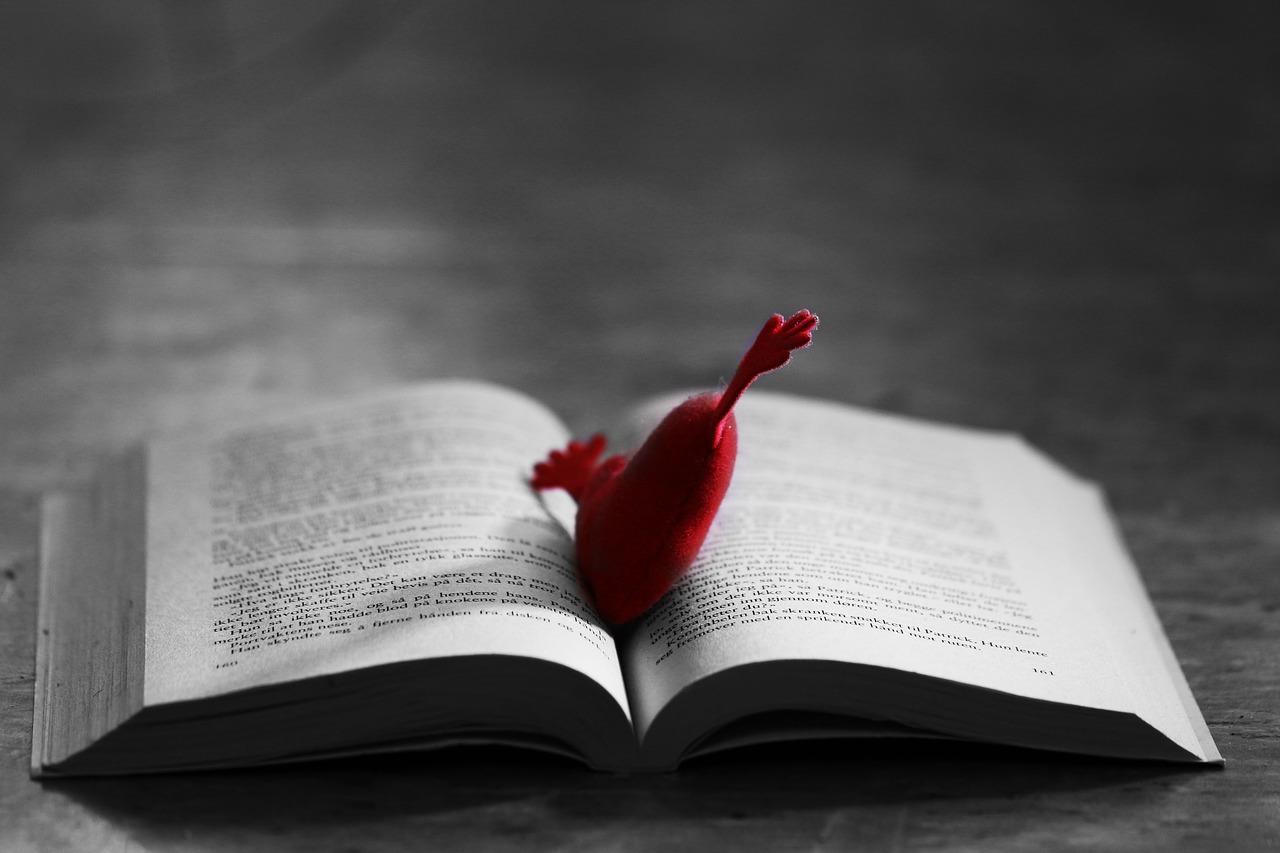

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !
Les explications bien détaillées ainsi que tous les exemples sont merveilleux! Vraiment pratique!
Merci Shawn pour votre commentaire !
Merci. Très utile pour moi.
Je veux une scène comique
Très utile, Merci.
Moi aussi