Être professeur dans un établissement scolaire, en collège ou en lycée, n'est pas une tâche facile, surtout lorsque l'on débute. Du chef d'établissement aux enseignants en passant par les représentants du personnel, il est du devoir de chaque personne de faire usage de son pouvoir disciplinaire pour appliquer la procédure disciplinaire.
Mais bien entendu, dès qu'il s'agit de punitions scolaires et autres mesures disciplinaires, il est crucial de le faire de la bonne manière, dans le respect des droits des élèves, et ce, en gardant constamment à l'esprit la visée éducative de ladite punition. C'est d'ailleurs pour cela que les sanctions éducatives sont encadrées par la loi avec :
- Le Règlement intérieur
- Le Code de l'éducation
- Nombreuses circulaires
- Etc.
Le cadre légal est ainsi très clair sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas en ce qui concerne la discipline en classe avec par exemple, les châtiments corporels interdits.
Les punitions scolaires et la discipline en classe doivent respecter un cadre légal strict en France. Les humiliations sont contraires à la loi et les châtiments corporels interdits. Les enseignants peuvent appliquer des sanctions éducatives et mesures disciplinaires autorisées (carnet de correspondance, excuses, retenue…) pour maintenir un climat propice aux apprentissages.
En d'autres termes, il s'agit d'envisager les sanctions éducatives comme des mesures de prévention et de responsabilisation pour l'élève. Le but : lui permettre de recevoir un accompagnement éducatif approprié à ses besoins. Cela implique également que la punition, quelle qu'elle soit, doit être à la fois proportionnée, individualisée et motivée.
Sanctionner un non-respect au règlement intérieur école est donc un acte utile qui fait partie de l'exercice du pouvoir du professeur, mais un cours qui se passe bien est tout de même bien plus intéressant. Ainsi, Superprof vous propose d'apprendre à utiliser les différentes sanctions éducatives disciplinaires existantes sans en abuser et au bon moment.
Envie de donner des cours ?
Rejoins la communauté Superprof et partage tes connaissances avec des centaines d’élèves curieux et motivés
Le cadre légal des punitions scolaires en France
Les textes de référence
Pour remplir votre rôle d'enseignant(e), que vous soyez à l'école maternelle, primaire, au collège ou au lycée, il y a 3 textes de référence que vous devez impérativement connaître. Rassurez-vous, personne ne vous demandera de maîtriser chaque article et chaque circulaire dans les moindres détails.
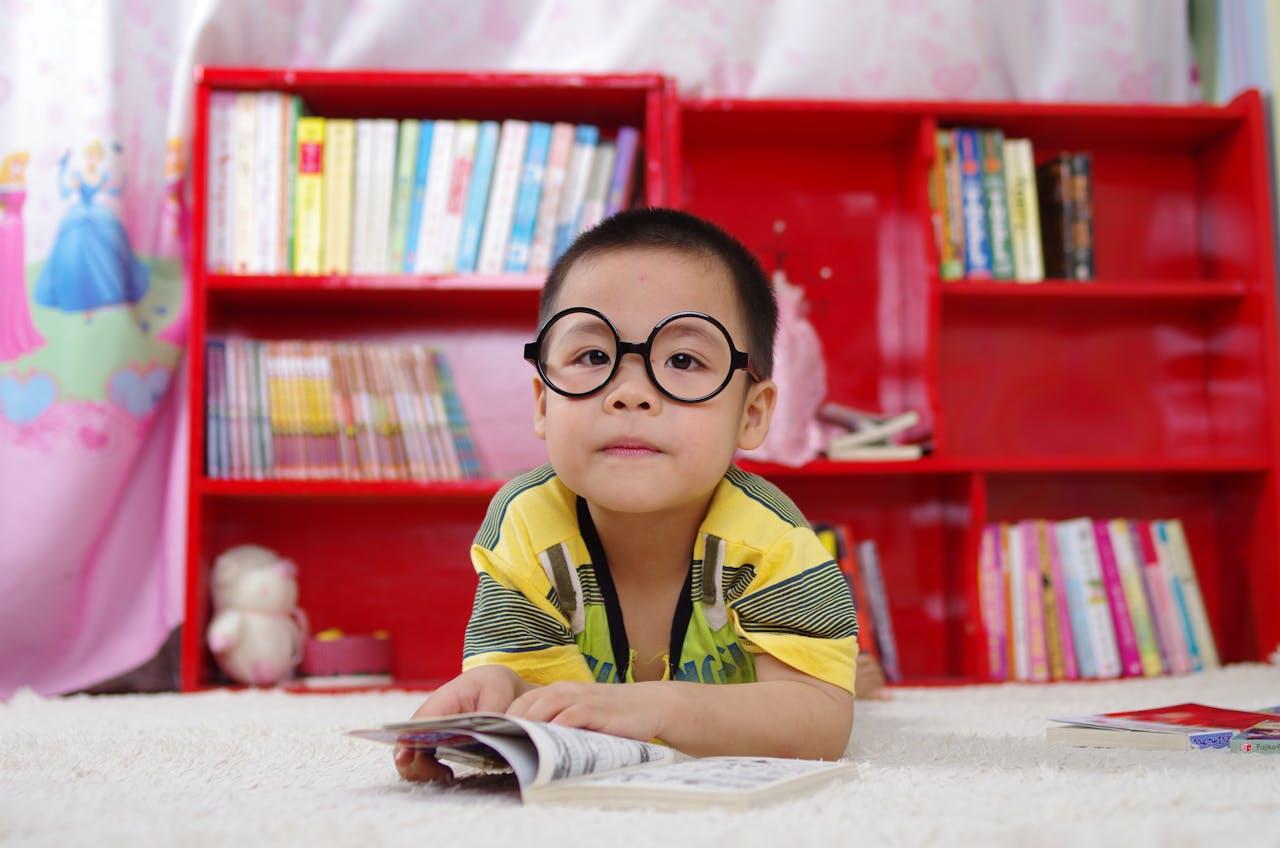
En revanche, il est important que vous en connaissiez les grandes lignes :
1er texte
Circulaire n°2014-088 du 9 juillet 2014
Cette circulaire a pour fonction de fixer le règlement type départemental (RTD) au sein des écoles maternelles et élémentaires. C'est ce qui va constituer la base du règlement intérieur (RI), qui lui-même comporte une section destinée à la discipline des élèves. Il est donc question des réprimandes et punitions, qui doivent toujours être à visée éducative, mais aussi adaptées à l'âge de l'enfant. Il y est également question des interdits, tels que les humiliations ou encore les châtiments corporels. Cette circulaire encadre aussi la procédure de demande de réinscription dans une autre école en cas de situation grave ou persistante.
2ème texte
Code de l’éducation
Comme son nom l'indique, ce Code regroupe l'ensemble des législations concernant l'éducation, dont la question des mesures disciplinaires. Il y est par exemple mentionné que le RI doit préciser les conditions des droits et obligations de chacun et que c'est le conseil d'école qui le vote (pour le primaire). Concernant plus précisément les collèges et lycées, ce Code dit que le RI doit reproduire l'échelle des sanctions ainsi que les mesures de prévention et d'accompagnement en se référant aux sanctions applicables selon ce qui a été défini dans les textes, mais aussi par rapport à ce qui a été décidé au conseil de discipline.
3ème texte
Règlement type départemental (RTD)
Le RTD est arrêté par le DASEN (Directeur académique des services de l'Éducation nationale). Il a pour objet de cadrer le fonctionnement des écoles et de guider la rédaction du RI. Diverses thématiques sont ainsi portées à l'étude, comme la question de l'admission, de l'assiduité, de l'accueil, de la surveillance, du dialogue avec les familles, de l'hygiène, de la sécurité ou encore des règles de vie. Et bien sûr, de la discipline en classe !
Les punitions scolaires autorisées
Vous l'aviez deviné, c'est le Code de l'éducation, et plus exactement l'article R.511-13, qui s'occupe d'encadrer l'échelle des sanctions éducatives et qui impose au RI de reproduire cette échelle.
Légalement, les punitions scolaires, contrairement aux sanctions éducatives disciplinaires, sont des mesures d'ordre intérieur. Cela signifie qu'elles ne sont ni inscrites au dossier administratif, ni susceptibles de recours. De plus, bien que nous utilisions "punition" et "sanction" comme des synonymes dans le langage courant, elles diffèrent légalement : un(e) enseignant(e) est habilité(e) à donner uniquement des punitions lorsqu'il ou elle fait la discipline en classe.
Voici donc les 4 principales punitions scolaires autorisées :
1ère punition autorisée
L'inscription sur le carnet de correspondance
Punition la plus connue, vous-même l'avez peut-être reçue lorsque vous étiez plus jeune, il s'agit de ce fameux "mot" rédigé par l'enseignant(e) dans le carnet de correspondance à l'intention des parents pour relater le comportement de l'élève. Dans cette situation, la signature d'un parent ou d'un représentant légal est requise.
2ème punition autorisée
L'excuse publique (orale ou écrite)
Le but de cette punition est que l'élève puisse prendre réellement conscience du manquement dont il a fait preuve. Bien entendu, cette punition comporte une limite, elle doit rester juste et éducative, donc ne pas mener à une humiliation publique.
3ème punition autorisée
La privation partielle de récréation
Bien que légale, cette punition encadrée par la circulaire 2014-088 (RTD) est accompagnée d'une forte réserve. Pour commencer, une privation totale est interdite et il est recommandé qu'elle soit effectuée à titre exceptionnelle. En outre, les conditions de cette privation sont strictes : elle doit se dérouler sous surveillance continue dont les modalités doivent être précisées dans le RI.
4ème punition autorisée
La retenue sous surveillance
Dans le cadre de cette punition, l'élève doit rédiger sous surveillance un devoir ou un exercice qui sera corrigé par l'enseignant(e) qui a donné la retenue. De plus, lorsqu'un élève écope d'une retenue, cette dernière doit faire l'objet d'une information écrite aux parents.
Vous souhaitez donner des cours particuliers ?
Les punitions scolaires interdites
Vous vous en doutez, si nous avons parlé des punitions autorisées, c'est qu'il en existe des interdites. D'ailleurs, cette thématique dépasse le cadre du RI, du Code de l'éducation ou même le cadre national. En effet, cette question mobilise une convention internationale, celle des droits de l'enfant (CIDE).
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention.
Article 28-2 (CIDE)
Il est du rôle de l'enseignant(e) ou futur(e) enseignant(e) de connaître son existence dans le cas où vous constatez dans votre établissement un manquement à des droits aussi fondamentaux que ceux de l'enfant.
Voici donc 4 punitions formellement interdites dans le cadre de la discipline en classe :
1ère punition interdite
Châtiments corporels interdits (fessée, coups, etc.)
L'interdiction doit être clairement explicite au sein du RI en ces termes : "tout châtiment corporel ou traitement humiliant est strictement interdit".
2ème punition interdite
Humiliations publiques (mise au piquet, moqueries…)
Tout comme la première punition, les humiliations publiques doivent légalement être clairement interdites, car elles portent tout autant atteinte à la dignité et aux droits des enfants.
3ème punition interdite
Les punitions collectives
Une punition ne peut pas être collective parce que c'est le principe de l'individualisation qui prône. Circulaire 2014-059 : "Les punitions ou sanctions collectives sont prohibées". Cependant, dans le cas d'une infraction au RI commise par un groupe d'élèves identifiés, il est évident que vous punirez l'ensemble des élèves impliqués.
4ème punition interdite
L'exclusion non encadrée
Lorsqu'il y a exclusion, l'élève ne peut en aucun cas se retrouver livré à lui-même. L'établissement doit obligatoirement avoir un dispositif de prise en charge, tel qu'être surveillé par un assistant d'éducation. En outre, dans le cadre d'une exclusion lors d'un contrôle par exemple, il est illégal pour le ou la professeur(e) de donner un 0 à l'élève.
Punitions scolaires déconseillées (mais non interdites) et explications pédagogiques
Donner des devoirs supplémentaires comme punition
Cette punition est déconseillée car l'élève pourrait perdre sa motivation pour l'apprentissage à l'école. En effet, psychologiquement, celui-ci va associer les devoirs à une sanction, alors qu'il est important qu'ils les voient au contraire comme une manière positive de progresser.
De plus, légalement, les textes précisent bien que si ce type de punition est donné, elle doit s'effectuer dans l'enceinte de l'établissement sous supervision et être corrigée par un adulte. En outre, la punition doit être en lien avec l'apprentissage pour respecter la portée éducative.
Faire copier des lignes
Cette punition consiste en une tâche répétitive, et donc, vide de sens. Elle a une faible valeur d'apprentissage, provoquant un désintérêt envers le professeur et ses cours, ce qui s'éloigne de la visée éducative que doit comporter une punition selon les textes. Par extension, s'il n'y a pas (ou peu) de valeur d'apprentissage, la punition ne permettra pas à l'élève de réfléchir sur son comportement et de le modifier.

C'est même le contraire : une telle punition peut créer un sentiment d'ennui dans le meilleur des cas, et du ressentiment de la part de l'élève dans le pire des cas. Elle est donc loin des meilleures pratiques pédagogiques ...
Faire rester un élève debout ou isolé dans un coin
Cette punition est dangereusement proche de l'humiliation. Non seulement cela ne va pas automatiquement permettre à l'élève de mieux comprendre la règle qu'il a enfreinte, mais en plus, il risque de se sentir isolé et d'éprouver un sentiment d'injustice.
Vous le savez, ce type de sentiment nous est arrivé à tous : il s'agit d'une émotion qu'en général, nous n'oublions pas et qui reste gravée en nous. Cela peut alors nuire au climat scolaire et même au plaisir d'apprentissage.
Demander à l'élève de dénoncer un camarade
Il s'agit de la punition idéale pour créer des tensions entre pairs. En effet, l'élève pourrait "dénoncer" son camarade à cause de la pression de l'enseignant(e). Mais en parallèle, il sera considéré comme un "délateur" par les autres élèves, ce qui créera des tensions, des conflits et peut mener à du harcèlement scolaire.
Il ne faut pas oublier que l'école, la classe, c'est un micro-environnement au sein duquel les enfants et adolescents doivent constamment se fréquenter. En cas de tension, la vie peut rapidement devenir un enfer pour une partie des élèves.
Ainsi, pour éviter ce type de situation, les pratiques pédagogiques et les recommandations officielles privilégient la médiation par les pairs, le traitement collectif des conflits ou encore la justice restaurative.
Envoyer un élève seul hors de la classe (sans surveillance)
Vous le savez, sur le principe, c'est interdit, encore plus à l'école primaire. Cependant, même si cela l'est tout autant au collège et au lycée, dans la pratique, cette punition est souvent mal encadrée. Par exemple, l'élève expulsé du cours se retrouve seul et se rend ainsi à l'endroit indiqué par l'enseignant(e) sans accompagnement. Autrement dit, l'élève, livré à lui-même, pourrait même partir et sortir de l'établissement sans que personne ne le remarque.
Quoi qu'il en soit, cette punition est dans tous les cas déconseillée pour son manque d'efficacité pédagogique. L'élève peut le ressentir comme une injustice ou encore être amené à une rupture d'apprentissage. En effet, l'élève ne va ni se responsabiliser, ni réellement comprendre la règle enfreinte.
Punir devant toute la classe (remarques cinglantes, mise en accusation publique)
Là aussi, l'enseignant(e) est proche de l'humiliation publique, ce qui est donc officiellement proscrit, car étant contraire aux droits des élèves. Plutôt que de l'améliorer, la relation professeur(e)-élève sera dégradée, tout comme le climat scolaire. L'élève va ainsi se replier naturellement sur lui-même et, s'il s'agit d'actions répétées, pourrait finir par éprouver de la phobie scolaire.
Et bien évidemment, plutôt que de se régler, le problème de fond va s'aggraver.
Priver systématiquement de récréation
Vous le savez déjà, une privation totale est interdite. Si privation il y a, elle ne doit être que partielle. De plus, d'un point de vue pédagogique, il est fortement déconseillé de répéter régulièrement cette punition, car elle perdrait son sens.
C'est une question de santé et de besoins fondamentaux : les enfants doivent se dépenser et socialiser avec les autres. Cela leur permet de s'appaiser, mais aussi d'améliorer leur concentration, et leurs fonctions cognitives en général, lors des périodes de classe.
Demander des tâches de nettoyage comme punition
Nous en revenons une fois encore au sentiment d'humiliation et d'atteinte à la dignité que peut ressentir l'élève. Le nettoyage est bien sûr une valeur importante à transmettre aux enfants qui peut appartenir aux pratiques pédagogiques. Cependant, elle doit l'être au sein d'un contexte éducatif approprié, pour une meilleure compréhension tant de l'hygiène que du vivre-ensemble, et non pas être perçue comme une sanction disciplinaire.
Les principes pédagogiques sous-jacents aux punitions scolaires
La finalité éducative
Cela a été répété maintes fois : une punition dans le cadre de la discipline en classe doit toujours avoir une visée éducative tout en respectant les droits des élèves. Dans le cas contraire, administrer une punition n'aurait aucun sens.
Pourquoi punir un coupable quand il n'y a plus aucun bien à tirer de son châtiment - Denis Diderot
Le philosophe des Lumières qu'était Diderot éclaire une fois de plus nos lanternes : les infractions au règlement intérieur école doivent être sanctionnées, mais de manière intelligente, sans être trop dures inutilement. Cependant, une exclusion temporaire ou une exclusion définitive est parfois indispensable.
Bien sûr, nous sommes dans le cadre scolaire. Cependant, il ne s'agit pas seulement de l'étude de matières comme le français, les mathématiques ou encore l'anglais. Il est question de savoir-être, et donc, d'amener les enfants et les adolescents à se responsabiliser ainsi qu'à avoir des prises de conscience.
La responsabilité est une valeur essentielle à inculquer. Il est important que les plus jeunes puissent se responsabiliser en prenant conscience de la portée de leurs actes et de leurs conséquences. Par exemple, dans un cadre de harcèlement scolaire, l'élève doit être en mesure de comprendre ce que ses actions ont engendré sur sa victime. Mais parallèlement, pour que la responsabilisation et la prise de conscience soient totales, il est aussi nécessaire que l'élève comprenne pourquoi il ou elle a agi ainsi.
D'ailleurs, la prise de conscience est favorisée par deux textes :
- La circulaire 2014-059 place la prévention et le dialogue préalable au coeur de la réponse aux manquements. La réponse devant être réellement éducative et explicite
- La circulaire 2011-111 donne le droit à l'élève de présenter sa version des faits afin que la réponse éducative à son manquement soit, là aussi, la plus efficace possible
Enfin, c'est le règlement intérieur école (RI) qui est garant des règles de la vie collective, puisque c'est ce document qui les rappelle. Il précise les règles et les devoirs de chacun, faisant de lui le vecteur numéro 1 pour un climat social serein.
Proportionnalité et individualisation
Cet élément a été mentionné lors du point sur les punitions collectives : c'est l'individualisation qui constitue le principe de base. Cela démarre avec un autre principe, celui de la proportionnalité. Bien qu'il s'agisse de bon sens, il est essentiel de le rappeler, car cela constitue un principe juridique : la punition doit être proportionnelle au manquement. La sanction doit donc être graduée selon la gravité de l'acte commis par l'élève.

Les droits des élèves seront ainsi respectés. Ils ne ressentiront pas de sentiment d'injustice. Mais en plus, sur le plan pédagogique, le principe de proportionnalité leur permet de situer la portée de leur acte. En outre, cela signifie aussi que le rôle de l'enseignant(e) consiste à prendre garde à ne pas se laisser influencer par l'attitude de l'élève au quotidien ou par ses manquements précédents.
Si par le passé, l'élève a commis un manquement plus grave, la punition ou la sanction disciplinaire doit rester appropriée à ce manquement-ci et ne pas prendre le précédent en considération.
C'est ainsi qu'intervient naturellement le principe d'individualisation. Pour rappel, la circulaire 2011-111 insiste sur le fait que la punition doit être individualisée pour qu'elle soit la plus efficacement éducative possible. Le contexte dans lequel l'élève a commis son manquement doit donc impérativement être pris en compte et toutes les parties doivent être écoutées. Ici, c'est le rôle de la commission éducative (pour les collèges et lycées). La réponse pourra alors être la plus adaptée possible.
Envie de donner cours particuliers rennes ?
Les alternatives aux punitions traditionnelles
Prévention et responsabilisation
L'objectif, pour tout membre de l'Éducation nationale, est de pouvoir éviter les punitions, les sanctions éducatives et les mesures disciplinaires en faveur d'une éducation positive. C'est là où intervient la prévention, afin de responsabiliser les élèves et éviter qu'ils commettent des manquements. Pour cela, plusieurs outils, techniques et pratiques pédagogiques ont été mis en place :
1er outil
La médiation
Il s'agit d'un processus de résolution de conflit qui nécessite un tiers formé pour faciliter le dialogue et rechercher une issue constructive. Bien que le tiers soit généralement un élève, une formation est nécessaire, ainsi qu'une charte et un suivi de la part des adultes. La commission éducative a également un rôle, celui d'examiner la situation et de rechercher une réponse éducative personnalisée. De fait, elle développe la médiation entre pairs et assure le suivi des mesures de prévention et de responsabilisation. En outre, dans le cadre de la prévention du harcèlement, des élèves ambassadeurs sont formés, dont le statut est officiel, puisqu'inscrit dans la politique nationale anti-harcèlement.
2ème outil
Les ateliers émotionnels
Il s'agit ici du développement des compétences psychosociales (CPS) afin d'améliorer le bien-être, les relations et tout comportement favorable à la santé. Cela passe par exemple par la généralisation des cours d'empathie qui ont été mis en place à la rentrée 2024 dans les maternelles. L'un des buts est ainsi de renforcer la prévention du harcèlement.
3ème outil
Les contrats de comportement
Il s'agit officiellement d'un outil préventif qui prend la forme d'un engagement écrit concernant des objectifs précis de travail et / ou de comportement, décidé d'un commun accord avec l'élève (et sa famille). Cet outil se retrouve dans la circulaire 2014-059 et le RI, parmi les mesures préventives et d'accompagnement. L'objectif de ces contrats est la responsabilisation individuelle de l'élève, mais aussi l'implication de la famille, en tant qu'alternatives à l'exclusion.
Education positive et approches bienveillantes
Les mentalités ont évolué et nous constatons des progrès dans l'éducation. Ainsi, les approches bienveillantes commencent avec le renforcement positif. Le rôle de l'enseignant(e) est alors de ne pas seulement pointer les comportements mauvais ou inapropriés de l'élève, mais également de faire remarquer avec plaisir ses comportements positifs et attendus.
Un intérêt juste doit être accordé aux comportements positifs de l'élève - Eduscol
Il existe des outils que vous trouverez sur Eduscol comme le Good Behaviour Game (GBG), qui met en avant :
- Les règles explicites
- Le comportement positif
- L'observation active
Au sein de l'éducation positive, s'ajoute, parmi les pratiques pédagogiques, l'approche de la communication non violente (CNV), dans un esprit de prévention et d'adhésion aux règles. Cette communication consiste en l'écoute combinée à la reformulation des besoins et des émotions. L'objectif pédagogique est d'encourager l'élève à la parole, plutôt que de lui transmettre de la culpabilisation.

Enfin, un levier utilisé est la collaboration avec les familles dans le cadre de la coéducation. Sur le plan légal, il s'agit cette fois d'un cadre ministériel, avec une circulaire datant de 2013 pour renforcer la coopération entre l'école et les parents en termes d'informations, mais aussi d'actions co-construites. Officiellement, les parents sont membres à part entière de la communauté éducative.
Vous connaissez désormais tout ce qu'il faut savoir pour donner des punitions (et non des sanctions) aux élèves sans en abuser ou vous faire marcher sur les pieds. De quoi donner cours particuliers lyon ou ailleurs avec sérénité. Pour en savoir plus sur le métier de professeur, vous pouvez consulter nos autres articles sur Superprof !
Envie de donner des cours ?
Rejoins la communauté Superprof et partage tes connaissances avec des centaines d’élèves curieux et motivés
Résumer via IA :






La sanction n’est pas de la compétence d’un professeur. La punition, oui.