Chapitres
- 01. Les premiers fondements de la théorie atomique
- 02. Rutherford, Bohr et la naissance de la physique atomique moderne
- 03. Structure interne de l’atome : noyau, électrons et nucléons
- 04. Défaut de masse : qu’est-ce que c’est ?
- 05. Énergie de liaison nucléaire
- 06. Radioactivité : découverte, formes et fonctionnement
- 07. Définition et découverte historique
- 08. Les types de radioactivité
- 09. Réactions nucléaires contrôlées : fission et fusion
- 10. Énergie libérée et variation de masse
- 11. Vocabulaire à connaître
- 12. Conclusion
La compréhension de l’atome, la découverte de la radioactivité et l’étude du fonctionnement nucléaire ont transformé la science, la technologie et notre vision du monde. Cet article propose un panorama complet : des premières idées de l’atome aux notions modernes de défaut de masse, énergie de liaison, radioactivité, fission et fusion.

La découverte de l'atome fut l'une des plus grandes découvertes bouleversant notre monde scientifique. La connaissance de son existence a donc permis d'aboutir à une autre grande découverte : l'énergie nucléaire. Bien qu'elle révolutionnaire par ses principes de fonctionnement tels que la fission nucléaire, aujourd'hui les scientifiques se rendent de plus en plus comptes des dégâts et des traces qu'elle laisse sur notre monde. De nouvelles formes d'énergie nucléaire sont en cours de recherches comme la fusion nucléaire mais il est encore trop incertain de pouvoir l'utiliser. Son utilisation serait encore une grande avancée car, contrairement à la fission, elle présente de nombreux autres avantages. Il n'y aurait quasiment plus de déchets radioactifs, et les risques d'accidents nucléaires dévastateurs seraient nuls. L'énergie nucléaire a été une des plus grandes et fantastiques découvertes de l'humanité. Elle a été un grand tournant dans notre histoire mais aujourd'hui elle est dans une phase critique de son évolution. Elle favorise le réchauffement climatique et aggrave donc la « santé » de notre Terre d'après certains scientifiques. Cette phase critique remet donc en cause cette énergie et déterminera son avenir.

Les premiers fondements de la théorie atomique
Les idées sur l’atome remontent à l’Antiquité. Vers 400 av. J.-C., le philosophe Démocrite avançait que toute matière est composée de particules indivisibles, les « atomes » (atomos signifiant “indivisible”). Bien que cela soit encore philosophique, cette idée ouvrait la voie à de futures découvertes.
Les Grecs découvrirent également l’**électricité statique** : l’ambre frotté sur de la fourrure attire des objets légers. Ce simple phénomène fut l’une des premières manifestations de la charge électrique, longtemps avant que la structure atomique ne soit connue.
Rutherford, Bohr et la naissance de la physique atomique moderne
Au début du XXᵉ siècle, Ernest Rutherford mit en évidence que l'atome possède un noyau dense concentrant la charge positive et la majeure partie de la masse. Autour, gravitent des électrons dans un espace quasi vide. Ce modèle permit de rejeter l’idée d’un atome homogène.
Ensuite, Niels Bohr introduisit des notions clés de quantification : les électrons occupent des niveaux d’énergie discrets. Lorsqu’ils passent d’un niveau supérieur à un niveau inférieur, ils émettent un photon. Cela explique l’émission lumineuse de certains gaz excités et est un fondement de la mécanique quantique.
Structure interne de l’atome : noyau, électrons et nucléons
A l'heure actuelle les physiciens et les chimistes pensent qu'un atome peut être modélisé par une structure présentant un noyau autour duquel existe une zone sphérique centrée sur le noyau et dans laquelle il y a une certaine probabilité de trouver les électrons. Cette partie de l'atome est appelée nuage électronique. On donne ci-contre un dessin d'un modèle probabiliste d'un atome d'hydrogène composé d'un noyau et d'un unique électron.
Un élément chimique regroupe tous les atomes ayant le même nombre de protons (numéro atomique Z). Ces éléments sont listés dans le tableau périodique. On connaît actuellement 118 éléments théoriques, avec environ 94 naturellement présents sur Terre.
Dans une réaction chimique, les électrons externes sont impliqués. En revanche, une réaction nucléaire agit sur le noyau — les protons et neutrons. Cela peut transformer un élément en un autre.
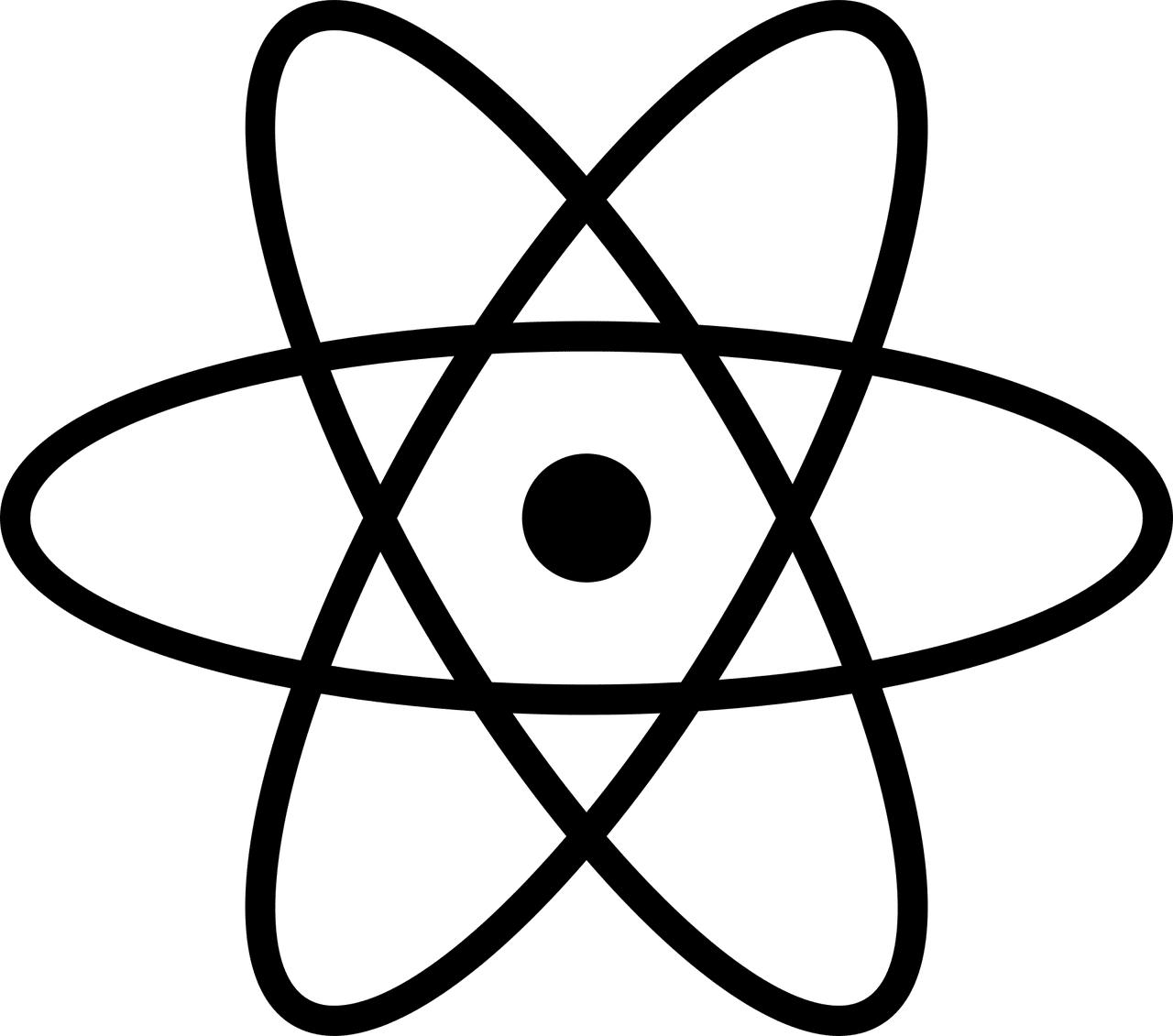
Le noyau de l'atome
Le noyau d'un atome se compose d'éléments que l'on appelle les nucléons. Ce sont eux qui définissent le nombre de masse d'un atome.
Dans ces nucléons se trouvent des protons dont la charge est positive et des neutrons à charge neutre. Ces deux composants sont très fortement liés entre eux. Le rayon d'un nucléon est d'environ 10-15 m alors que l'atome tout entier a un diamètre avoisinant les 10-10 m.
Le nombre de masse d’un atome est le nombre de nucléons qu’il contient. Il s’agit donc de la somme du nombre de protons et du nombre de protons qui constituent le noyau de l’atome
Les nucléons
Le noyau de l'atome est constitué de deux types de particules, les nucléons composés des neutrons et des protons.
Les isotopes
On appelle atomes isotopes les ensembles d'atomes caractérisés par le même numéro atomique Z et des nombres de nucléons A différents. Ce sont donc des ensembles d'atomes qui ne diffèrent que par le nombre de leurs neutrons.
La taille d'un atome
Elle est infiniment petite. En effet, le diamètre d'un atome vaut en moyenne 10-1 nm ( 1nm = 10 -9 m ) tandis que le diamètre du noyau vaut en moyenne 10-6 nm.

Le noyau est donc 100 000 fois plus petit que l'atome.
Entre les électrons et le noyau, il n'y a que du vide. On parle alors de la structure lacunaire de l'atome.
La charge électrique d'un atome
C'est la somme de la charge électrique + des particules du noyau et celle – des électrons.
Cette somme est nulle : On dit que l'atome est électriquement neutre.
Les charges électriques étant les même, il y a autant d'électrons qui gravitent autour du noyau que de particules le constituant.
Exemple : L'atome de fer a 26 électrons et 26 particules + dans son noyau.
La masse d'un atome
La masse des électrons est négligeable devant celle du noyau.
On dit que la masse d'un atome est concentrée dans son noyau.
Défaut de masse : qu’est-ce que c’est ?
La masse d’un noyau est inférieure à la somme des masses de ses composants séparés : protons + neutrons. La différence, appelée défaut de masse (Δm), correspond à la masse convertie en énergie de liaison.
Δm = Z × mₚ + (A − Z) × mₙ − m(noyau)
Énergie de liaison nucléaire
Grâce à la relation d’Einstein E = m × c², ce défaut de masse se convertit en énergie : l’énergie de liaison. C’est l’énergie qu’il faut fournir pour dissocier le noyau en nucléons séparés. Elle caractérise la stabilité du noyau.
L’énergie de liaison par nucléon (E/A) est souvent utilisée pour comparer la stabilité entre différents noyaux : plus elle est élevée, plus le noyau est stable.
Radioactivité : découverte, formes et fonctionnement
Définition et découverte historique
La radioactivité est une transformation spontanée d’un noyau instable en produit plus stable, avec émission de rayonnements (particules et photons). Elle fut découverte en 1896 par Henri Becquerel, en étudiant l’uranium. Marie et Pierre Curie poursuivirent ces travaux, isolant des éléments particulièrement radioactifs comme le polonium et le radium.
Prix Nobel de Physique en
pour Becquerel et le couple Curie
Par la suite, Rutherford, ainsi que d’autres scientifiques, identifièrent trois types de rayonnement : les particules α (alpha), β (bêta) et les rayons γ (gamma). Ces phénomènes révélèrent que certains noyaux sont instables et se modifient spontanément.
Les types de radioactivité
Radioactivité gamma
La radioactivité gamma est un rayonnement provoqué par une désintégration gamma. Le plu souvent, ces désintégrations accompagnent des désintégrations alpha ou bêta. En effet, quand il émet un rayon alpha ou bêta, le noyau devient excité. Lors de l’émission d’un rayonnement électromagnétique gamma, le noyau peut donc redescendre à un état plus stable.
Radioactivité bêta
La radioactivité bêta est un type de désintégration radioactive où une particule bêta (électron ou positron) est émise. On parle de radioactivité bêta + quand un positron est émis mais on parle de radioactivité – quand c’est un électron qui est émis.
Radioactivité alpha
La radioactivité alpha est un rayonnement provoqué par une désintégration alpha qui est une désintégration radioactive où un noyau atomique éjecte une particule alpha qui se transforme en un autre noyau dont le nombre de masse est diminué de 4 et le numéro atomique de 2 à cause de la particule alpha manquante qui est analogue au noyau d’hélium 4.
Réactions nucléaires contrôlées : fission et fusion
Fission : un noyau lourd (comme l’uranium ou le plutonium) se scinde en noyaux plus légers, dégageant des neutrons et une grande quantité d’énergie. Ce procédé est à la base des centrales nucléaires et parfois des armes atomiques.
Fusion : deux noyaux légers (généralement ceux de l’hydrogène) s’unissent pour former un noyau plus lourd, libérant aussi de l’énergie. C’est ce que font les étoiles, et l’espoir serait de maîtriser ce phénomène pour produire de l’énergie de façon propre.
| Caractéristique | Fission | Fusion |
|---|---|---|
| Principe | Un noyau lourd se scinde en deux noyaux plus légers | Deux noyaux légers fusionnent pour former un noyau plus lourd |
| Énergie libérée | ≈ 200 MeV par fission | ≈ 17 MeV par réaction (mais plus efficace par masse) |
| Applications | Centrales nucléaires, bombes atomiques | Étoiles, projets de réacteurs à fusion (ITER) |
| Conditions | Contrôle plus aisé | Nécessite très hautes températures et pressions |
Énergie libérée et variation de masse
À chaque réaction nucléaire (fission ou fusion), il y a une variation de masse du système. La différence de masse (Δm) est convertie en énergie selon :
ΔE = Δm × c²
Une autre façon de voir l’énergie libérée est de comparer les énergies de liaison avant et après la réaction : ΔE = Σ El(réactifs) − Σ El(produits)
Vocabulaire à connaître
Isomère nucléaire
Des isomères nucléaires sont des atomes qui partagent le même noyau mais dans états énergétiques différents. C’est à dire qu’ils comportent un spin et une énergie d’excitation spéciaux. Dans leur état d’énergie le plus bas, on dit qu’ils atteignent l’état fondamental.
Capture électronique
La capture électronique, aussi appelée désintégration ε, est un processus de physique radioactive lors duquel un noyau d’atome qui est en manque de neutrons absorbe un électron de la couche électronique de son atome
Produit de désintégration
On appelle produit de désintégration le nucléide descendant d’un désintégration radioactive d’un nucléide précédent
Fission spontanée
La fission spontanée est un phénomène de désintégration radioactive selon lequel un noyau lourd d’un atome se divise pour former au moins deux noyaux plus petits
Période radioactive
On appelle période radioactive le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux d’un isotope radioactif se désintègre de manière naturelle. Cette période n’est influencée en aucun cas par les conditions de l’environnement, que ce soit la température, la pression ou encore le champ magnétique, elle est propre à l’isotope en question. Statistiquement, on peut dire que la période radioactive est le temps à l’issue duquel le noyau de l’atome a 50 % de chances de s’être désintégré
Bombe H
Une bombe H, connue sous les noms de bombe à hydrogène, bombe à fusion ou encore bombe thermonucléaire est une bombe nucléaire qui tire son énergie de la fusion de noyaux légers comme ceux de l’hélium ou du deutérium par exemple
Conclusion
De la pensée philosophique de Démocrite, aux modèles atomiques modernes, l’exploration de la structure de l’atome et de ses composants — protons, neutrons, électrons — révèle la complexité de la matière. La radioactivité, la fission et la fusion montrent que les atomes ne sont pas statiques mais dynamiques.
Les applications de ces découvertes vont de l’énergie à la médecine, en passant par la recherche et la technologie, mais elles comportent aussi des responsabilités : sécurité, gestion des déchets, équilibre entre progrès et précautions. Comprendre les notions de défaut de masse, d’énergie de liaison, et la nature des réactions nucléaires est essentiel pour évaluer les bénéfices et les dangers liés à l’usage du nucléaire.
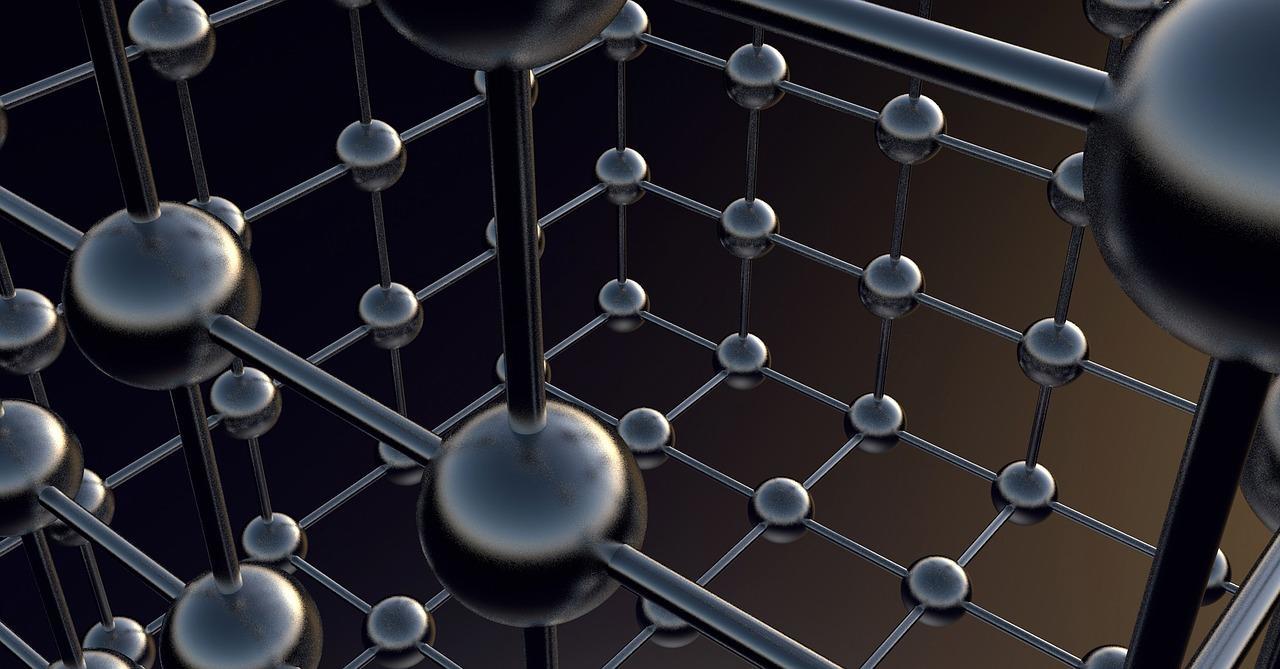













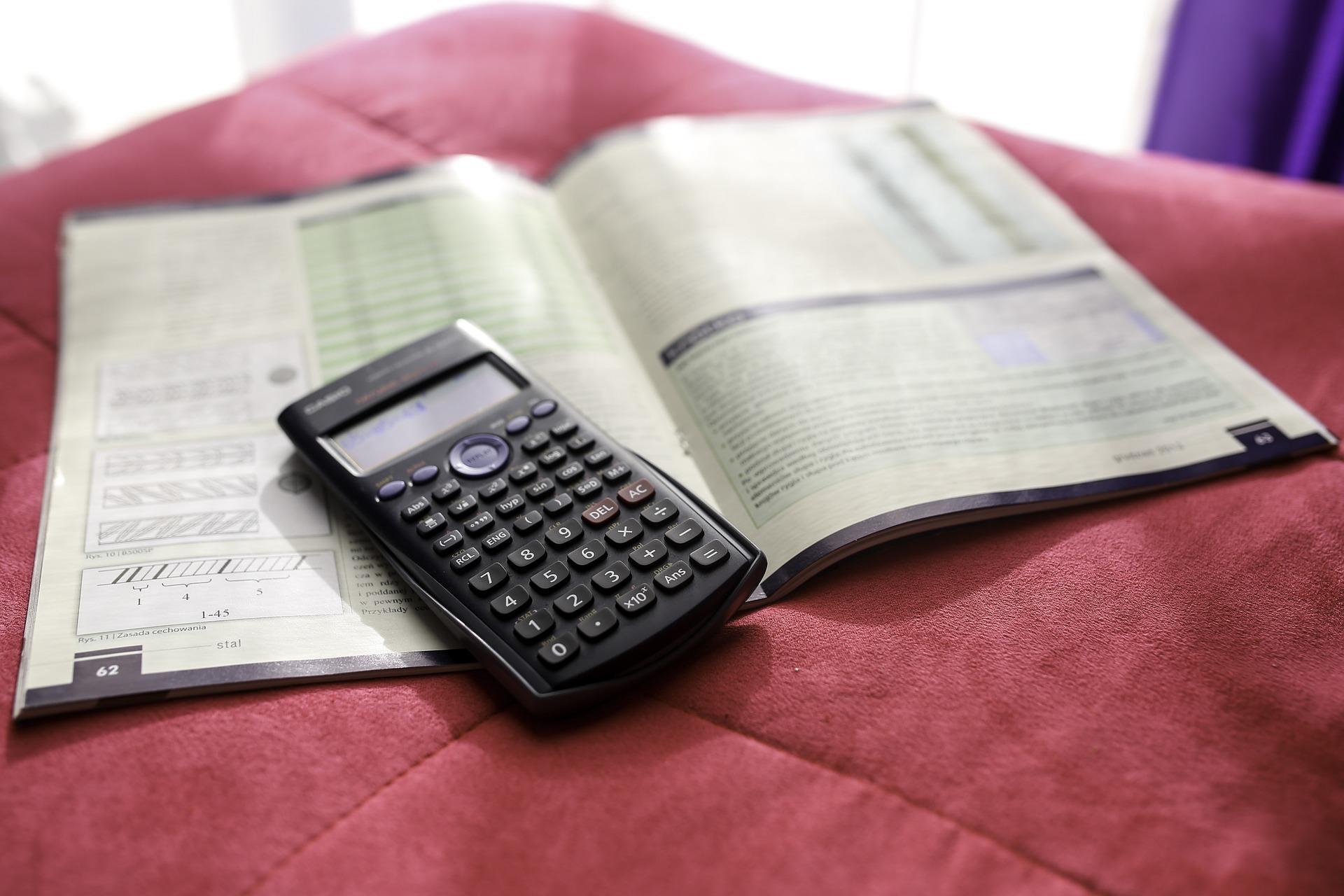








Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !