Chapitres
- 01. Introduction et annonce du plan
- 02. Les flux établis dans l’espace méditerranéen : de quelle manière unissent-ils les deux rives ?
- 03. Des flux importants de marchandises, mais un échange inégal.
- 04. En quoi l’espace méditerranéen est un espace uni par des flux intenses et variés ?
- 05. Pourquoi et comment les rives essaient de se rapprocher ?

Introduction et annonce du plan
La Méditerranée est étymologiquement la « mer au milieu des terres ». C’est une mer semi-fermée, qui communique avec l’océan Atlantique via le détroit de Gibraltar et, depuis le percement du canal de Suez (1869), avec la mer Rouge.
Elle établit aussi une communication avec la mer noire grâce au détroit du Bosphore. Cependant, sa position géographique fait qu’elle est en contact avec l’Eurasie et l’Afrique, c’est à la fois un espace complexe de : rencontres, curiosités, confrontations, et de toutes sortes de différences qu’elles soient religieuses culturelles, idéologiques, matérielles, sans oublier économiques.
Nous nous demanderons alors en quoi c’est une région qui génère des flux entre centres et périphéries, et comment cela modifie l’espace et les paysages méditerranéens. On verra premièrement, de quelle manière les deux rives sont unies par des flux intenses. Ensuite nous verrons quelles sont les différences qui les opposent, et enfin on montrera pourquoi et comment les rives essaient de se « rapprocher ».
Les flux établis dans l’espace méditerranéen : de quelle manière unissent-ils les deux rives ?
Le bassin méditerranéen occupe la première place dans le Monde pour l’accueil de touristes. Avec un peu plus de 5 millions d’arrivées internationales, la Tunisie est devenue la deuxième destination touristique de la rive sud de la Méditerranée, derrière l’Egypte et ses 9 millions de touristes par an.
Il s’agit d’un développement récent, où l’essor du tourisme s’explique par l’évolution des infrastructures (complexes hôteliers, ...) directement dépendantes du financement de l’état et de la venue de capitaux étrangers. Par exemple à Djerba, ce n’est que dans les années 1980-1990 que le développement s’est
intensifié, mais uniquement sur la côte.
Cependant, il n’y a pas que des flux touristiques ou financiers. . Les flux migratoires sont parfois, très prononcés et peuvent avoir un impact sur les pays de départ comme par exemple au Maroc où plus de 10% de la population a émigrée (essentiellement en Europe), avec pour la plupart le but de recherche de richesse qui a pour motivation une qualité de vie meilleur et qui se traduit par l’envoi d’argent de ces migrants à leur famille resté au pays.
En l’espace de 5 ans, les envois de fonds de travailleurs marocains ont plus que doublés évoluant de 2 milliards à plus de 4 milliards de dollars. Les motifs économiques ne sont pas la seule raison de ces flux migratoires, ont retrouve également des migrations liées à la fuite de conflits (guerre civile) et à des raisons politiques (dictatures, régime oppressant, ...).
Des flux importants de marchandises, mais un échange inégal.
Les échanges au sein de l’espace méditerranéen reflètent l’inégale puissance économique des Etats. Cela se traduit dans le volume des échanges : les pays rattachés à l’UE exportent six fois plus que l’ensemble des autres du bassin.
La nature des produits échangés : les biens peu élaborés (hydrocarbures, minerais, produits agricoles) occupent une place notable dans les exportations des PED méditerranées en direction du Nord. Pour l’Algérie et la Libye, les hydrocarbures représentent plus de 90 % des exportations. Les produits manufacturés en provenance d’Europe dominent dans les importations.
La forte polarisation géographique des flux de marchandises en provenance ou à destination des PED méditerranéens. Les PSEM, à l’exception d’Israël, échangent surtout avec l’UE. Chacun des Etats du Maghreb, Libye comprise, réalise avec l’Europe plus de 60 % de ses échanges.
On peut donc remarquer que les flux de marchandises laissent peu de place aux
échanges Sud/Sud.
En quoi l’espace méditerranéen est un espace uni par des flux intenses et variés ?
Après avoir vu ce qu’il les unis, nous allons voir ce qui opposent ces deux rives ;
La richesse, mesurée selon le PIB/habitant, révèle le fossé qui sépare les pays du bassin
méditerranéen. Les Etats du Nord-Ouest (PIB/habitant supérieur à 20 000 dollars) font figure de pays très riches. Dans les PSEM, les valeurs sont inférieures de moitié. Cependant ce constat doit
être nuancé : au Nord, en dehors de la Grèce, de la Slovénie et de la Croatie, le PIB/habitant demeure faible dans toute la péninsule des Balkans. Au Sud, Israël apparaît comme une enclave riche au sein d’Etats nettement plus pauvres, voire très pauvres comme les Territoires palestiniens. De leur côté, l’Algérie et la Libye bénéficient de la rente des hydrocarbures.
Cependant nous voyons que ces différences traduisent une insertion inégale dans la mondialisation économique. L’Espagne, la France, l’Italie et, à un moindre titre, la Grèce ont adapté leurs économies à la demande du marché européen mondial. Dans les PSEM, si le Maroc ou la Tunisie sont parfois regardés comme de nouveaux pays industriels, ce n’est que pour la Turquie, aux portes de l’UE, qui l’on peut parler de relative puissance industrielle. Au Sud, hormis Israël, l’agriculture intensive commerciale est plus ponctuelle : littoral atlantique du Maroc, région de Sfax et de Sousse en Tunisie…
Mais aussi les cartes révèlent l’ampleur des contrastes de développement entre les différentes rives de la Méditerranée. Des écarts importants, mesurés à partir d’indicateurs qui peuvent aller de l’IDH jusqu’au taux d’équipement en téléphone portable, s’inscrivent dans des espaces géographiquement très proches.
On constate donc une fracture Ouest-Est et Nord-Sud : au Sud, du Maghreb à la Turquie, l’IDH plus faible (entre 0,6 et 0,8 ) rappelle que les progrès économiques sont gommés par la croissance démographique. Au Nord-Ouest de l’espace méditerranéen, un petit nombre de pays fait partie des pays développés à très haut niveau de vie : Espagne, France, Italie, Belgique, Pays-Bas, ... contrairement à l’Europe de l’est pour qui la situation économique ne
permet pas de faire partie de la même « catégorie ».
Nous avons donc vu en quoi les différences entre ces deux rives renforcent cette fracture à la fois culturelle et économique.
Pourquoi et comment les rives essaient de se rapprocher ?
Précédemment, nous avons vus que l’espace méditerranéen était un espace de forts échanges migratoires, que c’est le premier bassin touristique mondial, et que d’importants flux de marchandises y transite. C’est un espace d’opportunités, qui compte pour l’Europe.
Lors de la, la Conférence de Barcelone en 1995
rassemblant l’Union européenne et tous les pays riverains de la Méditerranée (sauf la Libye), il s’agissait de penser les termes d’une stratégie de long terme pour l’ensemble de la région en développant une approche globale des principaux problèmes concernant les sociétés méditerranéennes.
Ses objectifs affichés : créer une zone de paix et de stabilité reposant sur des principes fondamentaux tels que le respect des droits de l’Homme et de la démocratie ; construire un espace de prospérité partagée par l’instauration progressive et régulée du libre-échange ; contribuer à une meilleur compréhension mutuelle des peuples de la région, notamment en encourageant les sociétés civiles à multiplier les échanges et les initiatives.
Cette conférence était donc destinée à promouvoir un « espace commun de paix et de
stabilité » par la « construction d’une zone de prospérité
partagée », notamment via l’objectif d’une zone de libre-échange à
l’horizon 2010.
Cependant, le programme d’aide dans le cadre financier principal de la coopération de l’Union européenne avec les pays méditerranéens (MEDA) qui avait un budget d’environ 6 milliards d’euros n’a pas donné les résultats escomptés. Le projet d’ un espace euroméditerranéen destiné à renforcer les coopérations et à accélérer le développement des pays du Sud demeure plus que jamais d’actualité.
Pour l’Europe, notamment la France, l’entretien des relations diplomatiques vont de pair avec les relations économiques.
Par exemple tout le monde se rappelle que la perspective d’un traité d’amitié franco-algérien, qui avait volé en éclat après le vote de la loi du 23 février 2005 consacrant le « rôle positif » de la colonisation, parut vraisemblablement enterré, l’Élysée insista sur la nécessité de coopérations « concrètes », en particulier sur le plan économique. Premier partenaire commercial de la France en Afrique, l’Algérie suscite, en effet, bien des convoitises. Paris entend défendre ses positions dans un pays vers lequel ses exportations sont équivalentes à celles vers la Russie, et dans lequel ses investissements ont crû de 111 % en un an.
Actuellement, les enjeux économiques sont la principale motivation pour entretenir une « union méditerranéenne » comme l’a fait Nicolas Sarkozy en 2008. Ceci montre qu’il y a une dépendance flagrante des pays Nord/Sud.
Résumer avec l'IA :















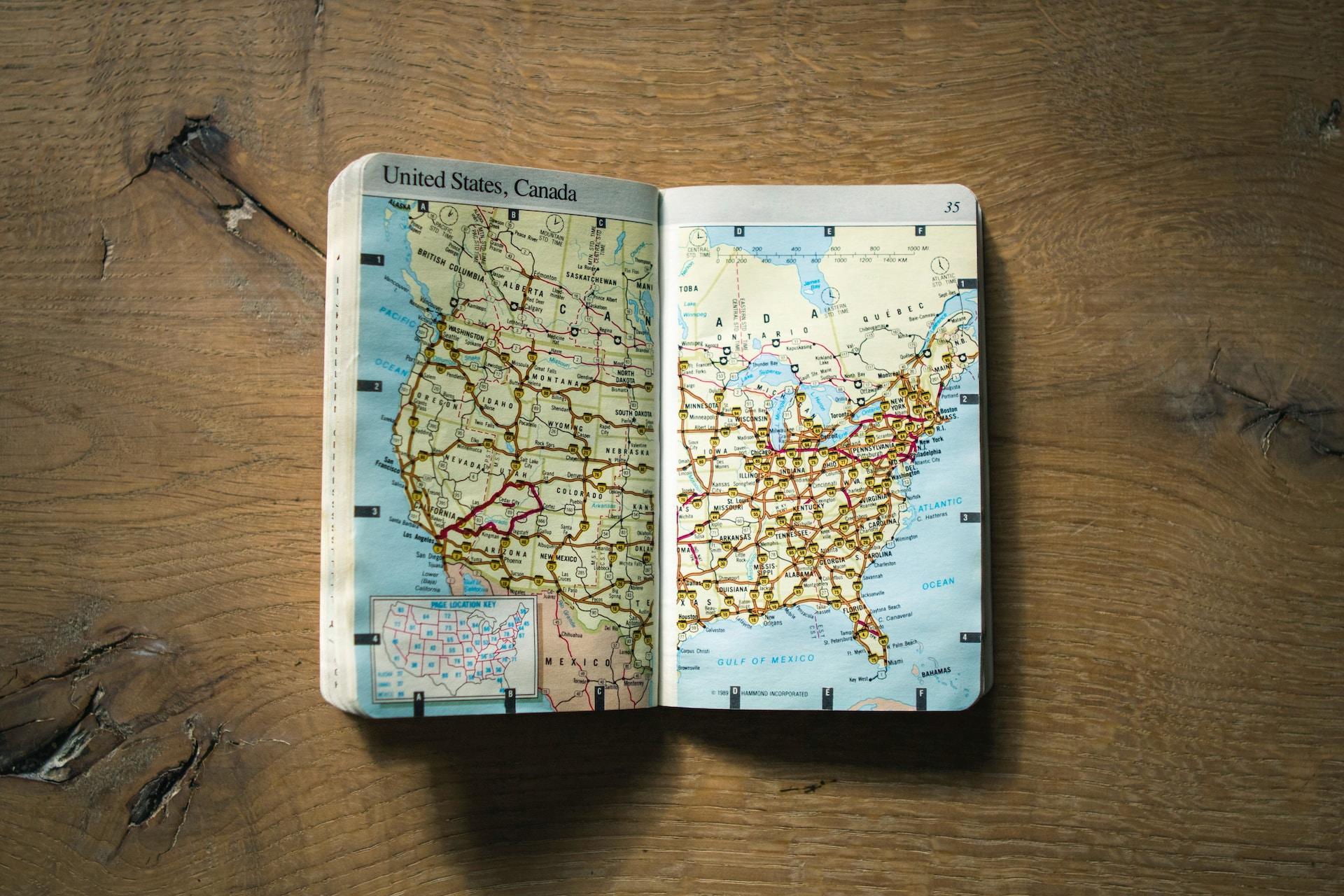

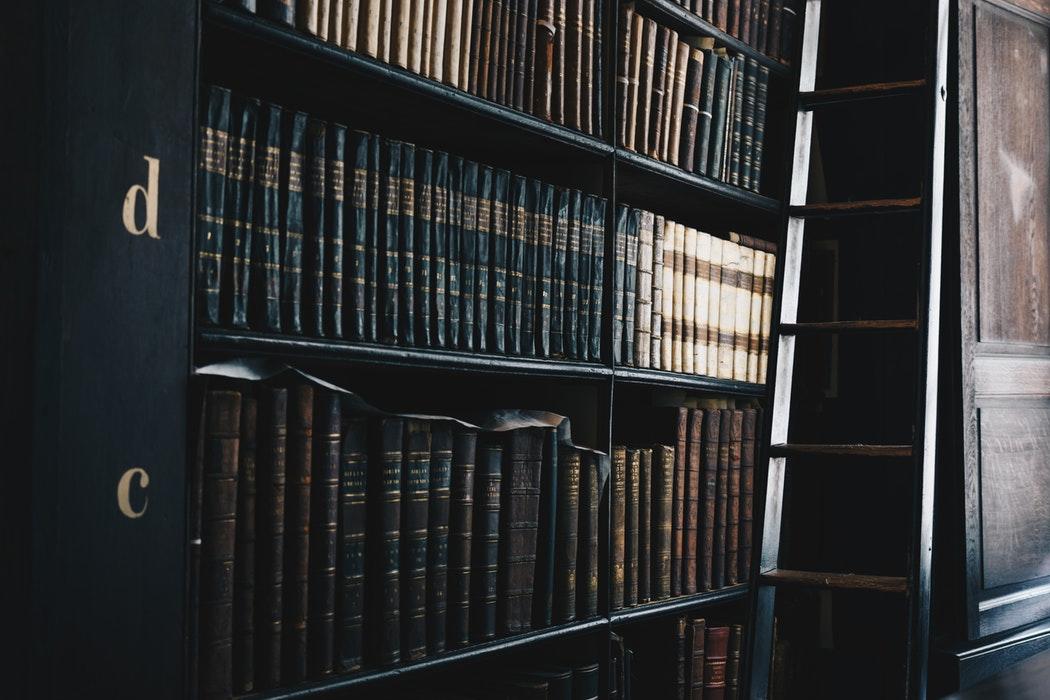



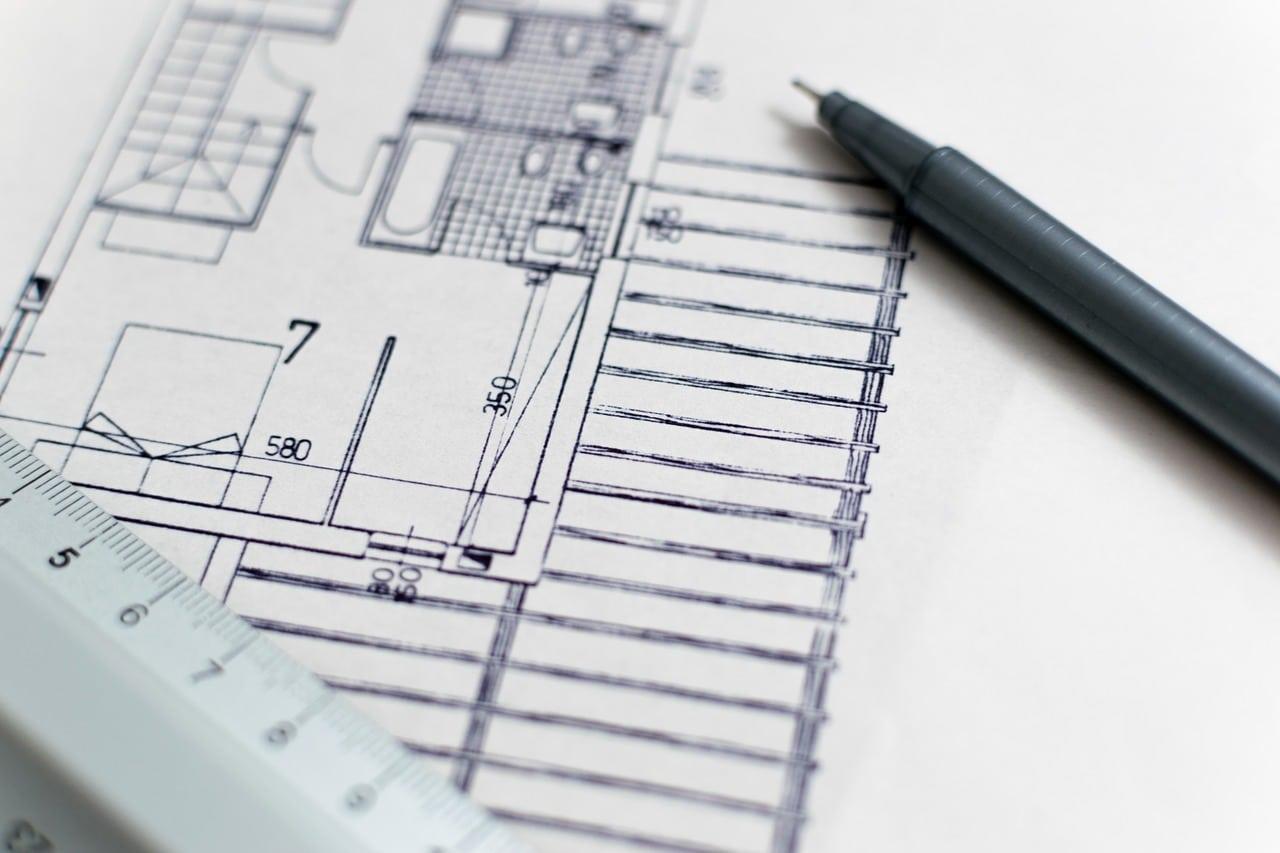

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !