Chapitres

Un pôle industriel au 19ème et milieu du 20ème
Des documents datant du 15ième
siècle stipulent déjà une utilisation du charbon dans le Nord-Est. Au début du
19ième siècle, la production annuelle avoisine les 105 000 tonnes.
Ainsi, dans le Nord-Est, la mise en valeur des ressources naturelles (fer,
charbon, sel) a donné naissance à une puissante industrie de base (sidérurgie
et chimie). La révolution industrielle a creusé
un écart de part et d'autre de la diagonale Le Havre-Marseille, le Nord
et l'Est s'industrialisant beaucoup plus rapidement que l'Ouest et le Sud du
pays. Les révolutions industrielles qui
marquent la France à partir de 1850
jusqu'en 1920 ont fortement contribuées à l'évolution de ces régions du
Nord-est.
Pendant près d'un siècle,
la Lorraine fut la grande région
sidérurgique française, le pays du fer et de l'acier. Par la masse de sa
productivité, par l'importance de sa main-d'œuvre et des capitaux engagés, par
le nombre des industries auxquelles elle fournissait du travail, la sidérurgie
joue le rôle d'une industrie pilote. Les mines de fer se modernisent au moyen
de machines géantes et battent des records de productivité. De plus
l'instauration en 1954 d'un marché commun du charbon et de l'acier ouvre pour les
sidérurgistes lorrains de vastes perspectives de débouchés.
Le Nord-Pas-de-Calais et les pays du Nord sont
marqués par les industries lourdes et textiles, dont la puissance est
longtemps écrasante et demeurent des activités essentielles de la région. Le
textile est toujours le secteur industriel qui fournit le plus d'emplois. Le
poids de la région s'est renforcé dans la sidérurgie : 22% des effectifs
nationaux , 1/3 des exportations métallurgiques. A l'intense activité
industrielle correspond une intense circulation des hommes et des
marchandises.
Jusqu'en
1950, les régions du Nord-est connaissent un profond développement industriel
et connaissent de fortes densités de population. Rien ne semble perturber
l'ascension de ces régions. Cependant, en 1960, la crise frappe durement ces
régions fortement industrialisées.
Le déclin des industries du Nord-est à partir 1950
Avec l'épuisement des ressources locales du Nord-est
telles le charbon et l'apparition de la concurrence des pays du Tiers-Monde,
qui peut produire plus vite
et à moindre coût, le Nord-est, et en particulier la région du
Nord-Pas-de-Calais, a été confronté dès 1950 à une grave crise économique. Les
industries traditionnelles, (le textile, l'exploitation du charbon, la
sidérurgie) ont particulièrement souffert de cette crise.
L'industrie textile va elle progressivement perdre
de son essor dans le Nord-est à partir de 1970. Les fabricants textiles avaient
longtemps associé « domestic system » et confection en ateliers. Sous
l'effet de la concurrence des pays en voie de développement qui produisent à
moindre coût, l'industrie textile va devoir réduire progressivement sa
production. La situation est complexe et la concurrence étrangère n'est pas le
seul problème. La situation des filatures de coton en plein centre ville, atout en 1850, est
devenue un sérieux handicap un siècle plus tard : comment faire manœuvrer
d'énormes camions dans les rues étroites ? Comment moderniser l'outil
technique dans ce bâtiment ancien ?
Les villes s'enfoncent dans le marasme et le
chômage.
Dès 1930, la croissance
considérable qu'avaient connue leshouillèresdu Nord-Pas-de-Calais semble se ralentir avec le début de la
crise : la production passe en six ans de 35 millions de tonnes en 1930 à
28,5 millions de tonnes. A partir de 1952, l'émergence du gaz
naturel et du pétrole a forcé l'industrie houillère à garder des prix bas. Les
houillères ont été progressivement fermées : le dernier puit du bassin
houiller du Nord-Pas-de-Calais à Oignies a fermé ses portes en décembre 1991. Parmi les usines sidérurgiques, seules les plus
modernes se maintiennent comme celles de
la zone industrialo-portuaire de Dunkerque qui utilisent du minerai de fer et
du charbon importés.
Animé
par l'esprit d'entreprise qui anime les protestants, les Alsaciens ont développé des industries plus variées : textile,
automobile, agroalimentaire (sucreries, brasseries). Ce qui a permis à la
région, non pas d'échapper à la crise économique, mais tout du moins de
résister et de réagir plus que d'autres.
Si l'industrie a constitué un atout
majeur de la Lorraine au XIXème siècle, elle n'a pas connu toute la
diversité de sa voisine. Fondée sur l'industrie lourde (extraction
charbonnière, sidérurgie), ou de base (chimie, textile), l'économie Lorraine a
subi la crise de plein fouet et presque simultanément dans ses divers secteurs
d'activité. Des dizaines de milliers d'habitants étaient au chômage, les
friches industrielles se sont multipliées.
Les myriades de petites entreprises
de Franche-Comté (horlogerie,
lunetterie) ont-elles aussi souffert de la crise. Seule la concentration de ses
activités du secteur secondaire (métallurgie, mécanique, automobile), a pu lui
permettre de survivre à la concurrence des pays ateliers.
La crise qui marque profondément ces régions est
la conséquence directe de la fin de l'extraction du charbon et du minerai de
fer, la fermeture des sites sidérurgiques vétustes et l'abandon d'ancestrales
activités textiles. Elle marquera profondément l'économie du Nord-Est qui en
subit encore les conséquences.
Une crise sociale
1.
Les mutations de
« l'après-mines »
Dans les anciennes régions minières du Nord-est, l'intensité de l'emprise minière était si
pesante et visible, qu'il a pendant longtemps été difficile de distinguer les problèmes liés aux mines. L'univers minier a longtemps influé
sur la population du Nord, que ce soit par des aspects professionnels et
résidentiels (maisons des corons) ou par les nombreuses structures
d'encadrement collectif (associations, syndicats, pratiques religieuses ou
politiques…). Cet « univers » minier a privilégié le groupe sur
l'individu, en mettant l'accent sur le solidaire. C'est la rétraction de cette
dimension et la régression de certaines structures collectives qui a laissé de
nombreuses personnes privées de leurs points de repères antérieurs.
La fin de l'exploitation des mines a entraîné un
chômage très important dans les régions du Nord et de l'Alsace. L'Alsace,
région la plus industrielle, présente un taux de chômage global inférieur à la
moyenne (5,3 % contre 9,1%) mais celui des jeunes reste très élevé. Le Nord-
Pas- de Calais connaît depuis des années l'un des taux de chômage les plus
élevés des régions métropolitaines. Le taux de chômage reste toujours élevé.
Or les zones où le chômage est le plus fort sont
aussi les zones ou la mortalité est la plus importante et où les classes sont les plus défavorisés comme le montre les cartes suivantes :
La crise sanitaire actuelle se développe sur la
fraction de population qui a connut une accumulation d'insécurité résultant des
mutations économiques et sociales depuis plusieurs dizaines d'années. Les
secteurs connaissant le plus de difficultés sanitaires sont celles où l'arrivée
du chômage est la plus ancienne. Le Nord et l'Est industriel sont qualifiés de
« défavorisées », les indicateurs de précarité y sont fréquents.
2. Une démographie contrastée
La démographie du Nord-est de la France est très différente
entre l'Alsace, le Nord et la Lorraine. Le
Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine et le nord de la Champagne-Ardenne présentent
des caractéristiques proches dans leur démographie, nous étudions donc plus
particulièrement le Nord-Pas-de-Calais :
-
L'Alsace : Au 1 Janvier 2006, le nombre d'habitants de la région Alsace était estimé
à 1 817 000 habitants ce qui représente 3 % de la population de France
métropolitaine. Sa santé démographique est bonne du fait de la
croissance démographique importante (+0.68% par an depuis 1999) , due
principalement au solde naturel (+0.47% par an), le reste provenant du solde
migratoire (+ 0.21% par an).
- Le
Nord-Pas-de-Calais : troisième région la plus peuplée de France, elle
est aussi l'une des plus jeunes : le taux de natalité était de 13.7 ‰ en 2005 (contre 12,6 ‰ pour l'ensemble de
la France métropolitaine). Les moins de 20 ans formaient
27,8 % de la population en 2005 (contre 25,2 % pour la Métropole).Il y a deux
raisons à sa forte densité de population de 322.7hab/km 2. D'une
part le fort excédent naturel et d'autre part la forte immigration.
L'urbanisation est importante et concerne principalement l'agglomération
lilloise. On doit admettre que le développement démographique se concentre ces
dernières décennies dans le nord de la région, autour d'un axe Lille-Calais,
bien que la capitale du Pas-de-Calais ne se trouve pas dans cette zone.
Le solde
migratoire est négatif en Lorraine et dans le Nord-Pas-de-Calais qui font
partis de la couronne des départ. L'attractivité y a beaucoup baissé.
Résumer avec l'IA :















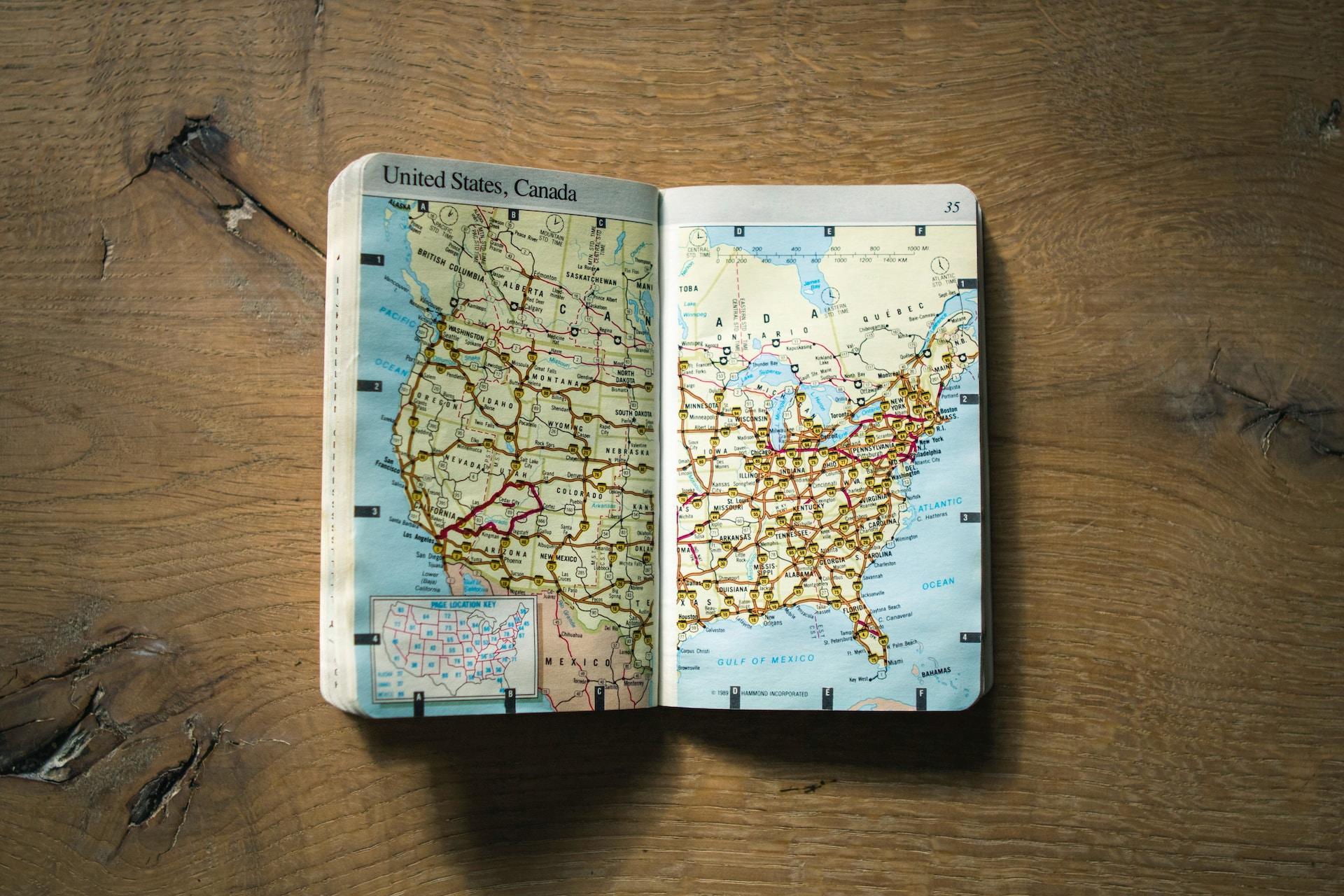

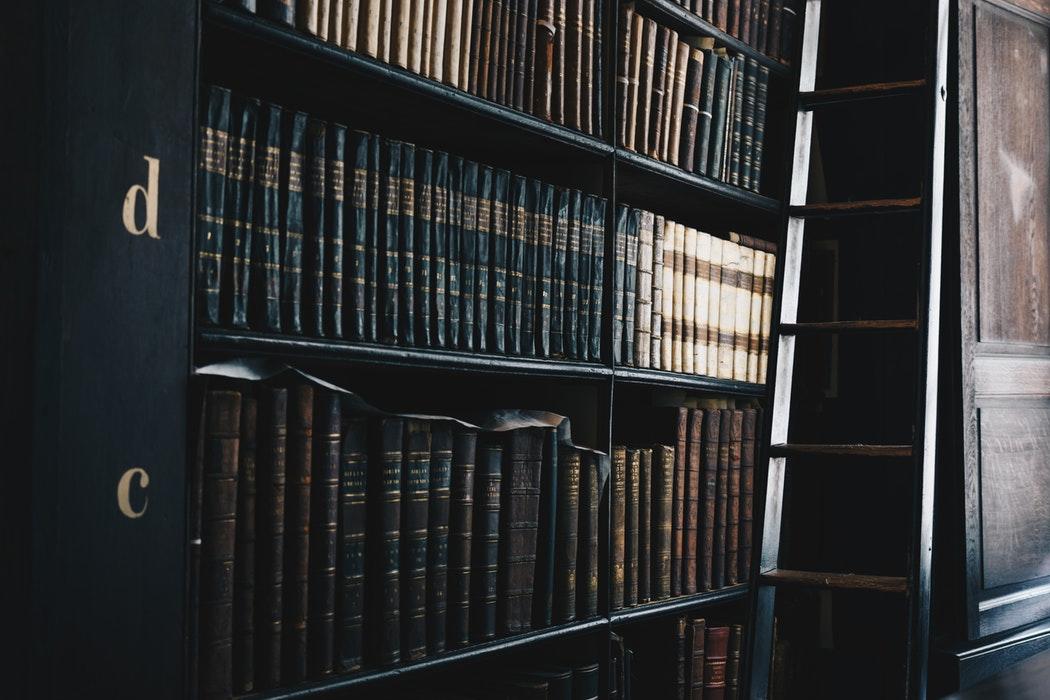



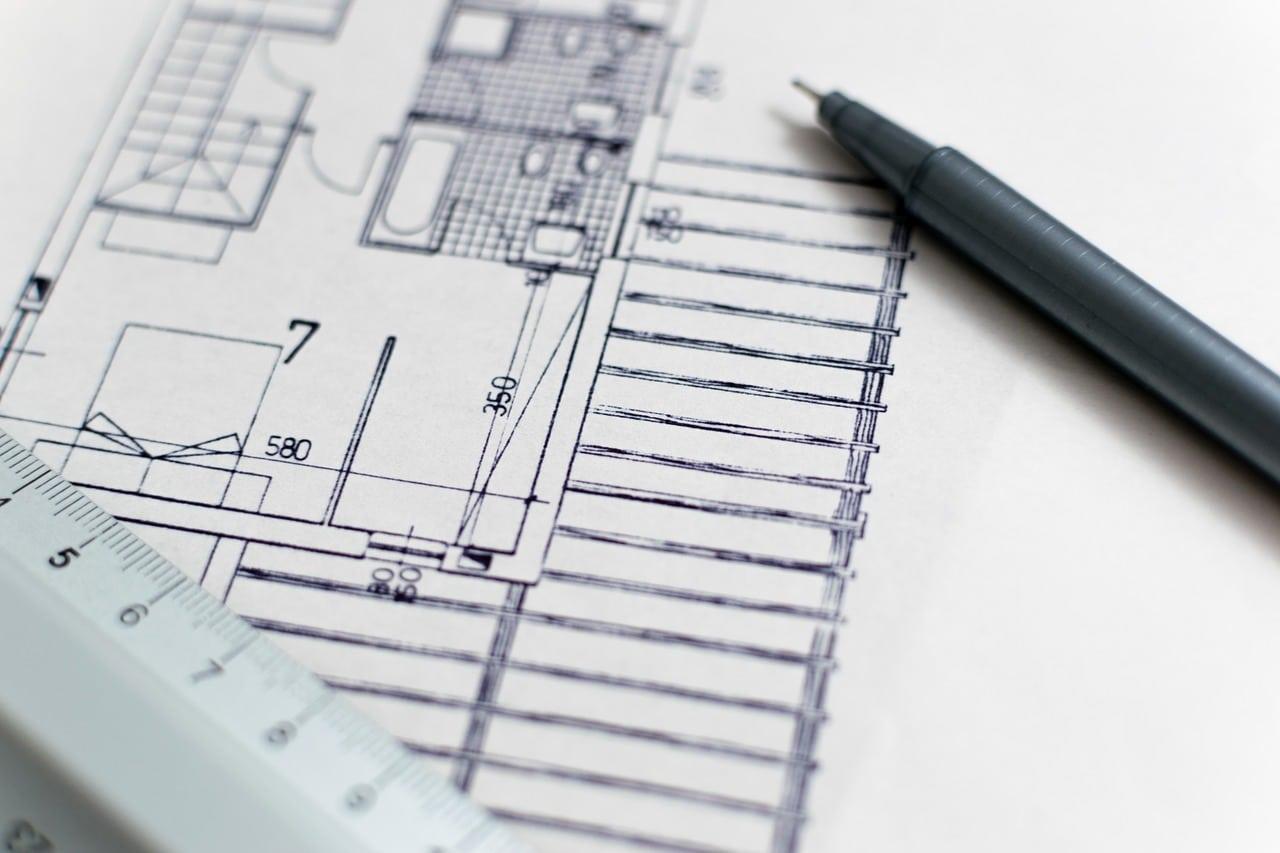

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !